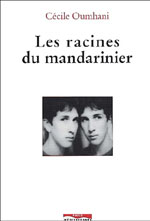|
|

Cécile
OUMHANI
Poète, nouvelliste
et romancière
Vous avez, dans plusieurs de vos ouvrages, mis en scène des personnages tunisiens. Est-ce que l'écriture est pour vous une façon d'être porte-parole ?
Même si j'ai vécu la plupart du temps en France, j'ai toujours été entre les lieux et entre les langues. Enfant je ressentais déjà très fortement la présence d'autres lieux, d'autres personnes que j'aimais beaucoup ailleurs, très loin. Et on ne pouvait pas se voir, ni se téléphoner ou encore s'envoyer des courriels... Au moment où j'ai ressenti la tristesse de l'éloignement, j'ai découvert la force des mots que l'on écrit. Il y avait les lettres et le pouvoir d'évocation d'un mot, du nom d'un lieu, ce qui s'écrivait chez nous en anglais ou en français. Cette histoire interculturelle n'a fait que continuer avec la Tunisie, un autre pays, venu se greffer aux autres... Finalement peu importe au fond l'endroit où l'on vit. Tout ce qu'on échange et qu'on partage avec un être dans le verbal ou le non-verbal, à travers un geste ou un rituel culinaire, tout cela fait qu'une osmose se crée, dès lors qu'on vit ensemble. En vérité je ne me suis pas posé vraiment la question de savoir si mes personnages appartenaient à cette rive ou à l'autre. Ils se sont imposés à moi, c'est tout. Cela correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure : pour conjurer la blessure de l'éloignement du lieu et des êtres, il y a les mots, l'écriture...
Vous ne vivez pas en Tunisie mais vous y allez régulièrement. C’est un pays que vous connaissez bien. L’écriture vous en a encore rapprochée ?
On m'a souvent dit que, tout en étant à l'intérieur de la société tunisienne, mon regard gardait assez d'extériorité pour saisir des choses qu'on ne voit pas quand on est constamment en leur présence. Et j'ai été très touchée que des lecteurs me disent que j'avais pu leur faire découvrir leur propre pays. Très touchée et en même temps étonnée que l'on puisse ressentir ainsi ce que j'écrivais. L'écriture a certainement approfondi mes liens avec toute une société, tout un pays. Il y a cette vie de l'imaginaire qui court à travers le quotidien, même lorsque je suis ici. Et quand je dis "imaginaire", je devrais préciser qu'il s'agit pour moi aussi de la connaissance de mes personnages, des émotions qui sont les leurs et qui révèlent ce qu'ils sont. Oui, ils m'habitent et ce pays aussi.
Quels rôles peuvent jouer la littérature et la fiction dans les relations interculturelles ?
Je rentre de Zagreb où je suis allée pour la parution d'une traduction des Racines du mandarinier. J'ai été très interpellée de voir que les gens là-bas s'intéressaient tant à ce livre et parlaient du message de tolérance qu'ils y lisent, de l'interculturalité aussi. J'ai pensé qu'au moment où j'écrivais ce roman, cette région du monde venait d'être déchirée par des guerres terribles. Je ne me doutais alors nullement qu'il pourrait jamais un jour toucher les gens qui les avaient vécues. Une poète est venue m'offrir une rose à l'Institut français, juste avant la présentation de mon livre. Son mari est musulman. Ils ont vécu à Sarajevo, puis à Mostar, où leur maison a été bombardée et ils sont alors allés se réfugier à Zagreb, où ils vivent encore aujourd'hui. Je pense avoir ressenti à cet instant particulier toute la force des mots, une force qu'on ne mesure pas soi-même. On dit bien que les livres vivent leur propre vie, une fois qu’on les a laissés partir vers leurs lecteurs.
Vous utilisez les mots dans leurs diverses dimensions, l’écriture poétique la poésie, la prose. Comment se détermine le choix d’une forme ou d’une autre ?
Je reste attachée à une qualité poétique de la langue, quel que soit le type de texte que j'écris, même si je différencie bien sûr poésie et prose. Selon le moment, tel ou tel type de texte s'impose à moi et j'essaie de demeurer attentive à ce qui vient, de ne pas forcer les choses. Vénus Khoury-Ghata dit qu'un recueil de poèmes annonce chez elle un roman à venir. Elle a remarqué un lien intime qui court de la poésie au roman. Un peu comme une respiration... Pour moi, l'écriture poétique est une recherche de l'essentiel, une approche du silence des choses. La densité de l'écriture y est différente. Avec la prose, je m'écarte de la solitude de l'espace poétique pour rejoindre les préoccupations de l'humain, les préoccupations des humains dans le quotidien.
Quand vous commencez un texte, est-ce les personnages, les lieux ou l’histoire qui vous donnent le point de départ ? Comment se construit votre texte ensuite ? Est-ce différent pour chaque écrit ?
Je suis le plus souvent requise par un lieu. Il s'impose à moi avec ses couleurs, ses odeurs. Et les personnages entrent en scène. Mais il m'est aussi arrivé que des bribes d'histoire me hantent très longtemps, pour m'amener ensuite à en faire une nouvelle, un roman et à l'écrire. Qu'il s'agisse d'un lieu, de fragments d'histoire qui cherchent leur place il y a un long temps de maturation où je prends beaucoup de notes dans des carnets, où je plonge dans une sorte de rêverie, en quête de mon fil d'Ariane. Une fois que je l'ai trouvé, je commence à vraiment écrire le texte. Tout cela est appelé à changer au fur et à mesure que j'avance dans l'écriture. Je tiens à rester attentive à ce qui peut survenir d'inattendu. Ces surprises de l'écriture m’entraînent parfois dans des directions auxquelles je n'avais pas pensé. Et c'est différent pour chaque écrit. Chaque texte est un territoire à explorer et il a sa spécificité ainsi que ses passerelles secrètes avec ceux qui l'ont précédé.
L’écriture est-elle pour vous une exploration de la mémoire ?
L’écriture est exploration de contrées obscures qui sommeillent au fond de nous. La mémoire en est partie prenante. Il y a une vraie lutte à mener pour exhumer ce qui est enfoui, ce que la mémoire a gommé, voire occulté. Je suis fascinée de voir combien ce qui vient s’inscrire sur la page peut aussi changer ce que l’on est, la manière dont on perçoit le monde. Ce combat pour tirer de l’obscur ce qui est enfoui est un combat avec soi-même, pour devenir soi-même.
L’exil joue aussi un rôle dans votre écriture. Il peut prendre différentes facettes. Comment le ressentez-vous ?
Absence et éloignement ont joué un rôle important dans le rapport que j’ai noué avec les mots, avec l’écriture. La page est ainsi devenue un lieu à part entière, un lieu qui transcende l’exil, ainsi que le temps et l’espace. Je crois qu’on écrit toujours un peu parce qu’on éprouve une forme d’exil, un exil intérieur, la souffrance de se sentir autre parmi les autres. On écrit parce qu’on a mal de ne pas avoir pu dire, de ne pas avoir pu partager. On écrit pour marquer une trace là où il n’y a que la transparence, l’invisibilité de ce que l’on ressent et que les autres n’entendent pas, ne voient pas.
Dans votre recueil de nouvelles Fibules sur fond de pourpre vous abordez la problématique des relations homme-femme qui sont compliquées autant pour les uns que pour les autres. Est-ce que ce recueil s’est construit à partir de témoignages ?
Ce recueil est très marqué par les pesanteurs patriarcales, c’est vrai. Des pesanteurs qui sont là, sans pourtant qu’on les dise. J’ai écrit ces nouvelles à partir de choses entrevues, ressenties, dites ou seulement juste murmurées. Le regard de celles qui sont ensuite devenues mes lectrices est là au creux de ces textes. Elles m’ont ensuite demandé d’écrire encore d’autres nouvelles qui seraient inscrites dans le même univers, le leur.
Comment s’allient les mots dans vos poèmes ?
Je dois m’effacer, m’absenter de moi-même pour écrire un poème. Il me faut devenir le seuil de ce qui va jaillir. Ensuite commence une autre phase du travail, l’impitoyable élagage, la quête du mot, des mots en écoutant ce que je ressens comme une oreille intérieure. Je suis alors à la recherche de ce qui est « juste », « juste » dans tout le prisme des tonalités, à la fois musicales, plastiques… C’est un équilibre fragile, sans cesse menacé et qui oscille entre l’abandon à ce qui vient et l’exigence. La page est elle-même un espace que les mots viennent habiter avec leur individualité, leur spécificité, dans ce qui ressemble aussi à une composition visuelle. Je vis la naissance d’un poème comme un point de convergence où l’écriture croise la musique, le dessin, la peinture.
L’écriture de la poésie se fait-elle entre deux romans ou en même temps ?
Il y a des moments où la poésie s’impose à moi, d’autres où le texte de prose m’appelle. J’aime pouvoir respecter ce rythme. Pourtant des demandes me sont faites à tel ou tel moment, sur un thème parfois défini, avec des dates à respecter. Cela pourrait paraître contraignant. Mais je me suis rendu compte que ces cadres fixés et imposés étaient parfois l’occasion d’explorer des espaces auxquels je n’aurais pas pensé.
Vous êtes à la frontière de plusieurs langues, le français, l’anglais, l’arabe. Quelle relation établissez-vous avec les langues ?
J’ai grandi entre les langues et je continue à vivre entre les langues. Très tôt on m’a incitée à lire autant en anglais qu’en français. J’ai des souvenirs de longues soirées de lecture où j’interpellais ma mère pour lui demander le sens de tel ou tel mot dans un roman de Jane Austen ou de Charlotte Brontë. Je ne voulais pas interrompre ma lecture pour aller regarder dans le dictionnaire et j’aimais ce dialogue que j’avais avec elle tout en lisant. Aujourd’hui encore j’ai un immense bonheur à lire un texte dans la langue où il a été écrit, chaque fois que c’est possible. Je le fais aussi en allemand et en arabe. C’est un émerveillement pour moi que de "plonger", de basculer dans ce flot de sonorités, de couleurs. J’emploie le mot "plonger" à dessein, parce que j’ai alors le sentiment d’être immergée. Une revue américaine m’a demandé il y a quelque temps d’écrire en anglais ce texte qui est ensuite paru en français dans Europe, « Jeune fille à la terrasse ». J’ai alors découvert la fascination de ce prisme que j’ai vu se déployer alors que j’écrivais dans une langue, qui fait certes partie de moi-même, mais que j’utilise moins au quotidien que le français. Cela ressemblait à des fils lumineux que l’on déplace juste un peu et qui s’éclairent soudain différemment alors qu’ils restent pourtant les mêmes.
Comment avez-vous commencé à écrire ?
J’ai toujours eu envie d’écrire. Enfant, j’écrivais des histoires dans des cahiers d’écolier et je les illustrais de dessins maladroits au stylo bille. Il m’a fallu longtemps pour oser passer à l’acte, m’« autoriser » en quelque sorte. J’ai d’abord commencé par des textes courts, poèmes et nouvelles. Et les revues ont joué un grand rôle pour moi en les accueillant. C’était à la fois un encouragement à continuer et l’occasion de mettre mes écrits à distance en les redécouvrant parmi d’autres, avec d’autres voix, d’autres chemins d’écriture. C’est la revue Encres vagabondes qui m’a demandé de réunir mes nouvelles pour le premier titre d’une collection commencée au Bruit des autres. J’en ai ressenti un grand bonheur mêlé d’incrédulité. C’est après ce livre que je me suis lancée dans mon premier roman, Une odeur de henné.
Vous participez régulièrement à des rencontres avec d’autres écrivains. Quel rôle jouent ces échanges dans votre parcours d’écriture ?
Je trouve très important non seulement de lire les autres écrivains, mais de les rencontrer, d’échanger avec eux. C’est ainsi que l’on peut avancer, en réfléchissant, en se remettant en question en se confrontant à d’autres approches, d’autres façons d’envisager l’écriture. J’ai été invitée à plusieurs festivals internationaux dans les Balkans ces dernières années. Ils m’ont laissé des impressions très fortes. J’ai trouvé passionnant de dialoguer sur les pratiques poétiques avec des gens d’horizons aussi variés que le Japon, l’Argentine, la Norvège ou la Croatie… Ces rencontres continuent de me nourrir.
Parlez-nous de votre nouveau roman, Plus loin que la nuit, qui vient de paraître aux éditions de l’Aube.
Il y est question d’art, de femmes et de quête de soi. J’ai voulu y mettre en regard des destins de femmes. Les choses ne sont pas faciles pour les femmes dans le Sud. Mais le sont-elles forcément toujours beaucoup plus dans le Nord ? Je crois que les pesanteurs patriarcales ont existé partout et continuent encore à des degrés divers, là où on ne les attend pas forcément. Il est beaucoup question d’art dans ce livre. Je crois que l’art est un point de rencontre universel et aussi l’espoir de naître à soi-même, de devenir ce que l’on est.
Quels sont vos projets d’écriture ?
Les éditions Elyzad m’ont demandé l’an dernier un récit pour une de leurs collections. J’étais alors poursuivie par des images ramenées des Balkans. C’est ainsi que j’ai écrit Le café d’Yllka, qui doit paraître en avril 2008. Je pense poursuivre mon voyage outre-Atlantique avec le prochain roman, une sorte de remontée vers un passé resté enfoui dans mon enfance, même si tout cela sera imaginaire.
Propos recueillis par Brigitte Aubonnet
Mise en ligne : Novembre 2007
|
|
|

(Cliquer sur la couverture
pour lire sur ce site
un article concernant
Plus loin que la nuit)
Romans
Une odeur de henné
Paris-Méditerranée,
1999
Les racines du mandarinier
Paris-Méditerranée,
2001
Un jardin à La Marsa
Paris-Méditerranée,
2003
Nouvelles
Fibules sur fond
de pourpre
Le bruit des autres,
1995
Poésie
A l’abside des hêtres
Centre Froissart
1995
Loin de l’envol
de la palombe
La Bartavelle,
1996
Vers Lisbonne,
promenade déclive
Encres vives,
1997
Des sentiers
pour l'absence
Le bruit des autres,
1998
Chant d’herbe vive
(avec des dessins de
Liliane-Eve Brendel)
Voix d’encre,
2003
Demeures de mots
et de nuit
(avec des dessins de
Myoung-Nam Kim)
Voix d’encre,
2005
Essai
A fleur de mots :
la passion de l’écriture
Chèvre-feuille Etoilée,
2004

Une odeur de henné
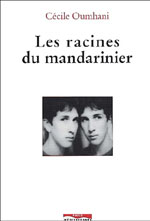
Les racines du mandarinier

Un jardin à La Marsa

Demeures de mots
et de nuit

A fleur de mots :
la passion de l'écriture





|
|