Les Papiers collés
de Claude Darras
Hiver 2020-2021
Carnet : thérapeutique
Une fois que tu as appris que tu es tuberculeux, la maladie passe mieux ! (Dimanche 10 août 1997)
(Jules Mougin, « 1912 : toutes les boîtes aux lettres sont peintes en bleu ciel », Travers 53, Philippe Marchal éditeur, 1999)
De la condition humaine
Pour peu qu’on soit un rien distrait, la journée passe comme une lettre à la poste. Et nous nous retrouvons dans la position horizontale sans avoir eu le temps de dire ouf. Il suffirait de se voir passer ainsi du jour à la nuit, dans un mouvement de bascule accéléré, pour comprendre un peu plus nettement ce qui rend notre condition incompréhensible.
(Georges Perros, « Papiers collés », 1960, Œuvres, Quarto Gallimard, 2017)
Mea culpa
Un ami marseillais s’étonne que mes « Papiers collés » regorge d’allusions historiques et littéraires qui sentent un peu trop la bibliothèque. Il a diablement raison : j’ai beaucoup lu, trop peut-être. C’est ma faute !
Aux hommes de lettres
Stéphane Mallarmé (1842-1898) a toujours pensé que les facteurs étaient des hommes de lettres. Aussi aimait-il - par sentiment esthétique, disait-il - orner de quatrains les enveloppes de ses missives. Nul doute qu’il aurait aimé le facteur-poète de Marchiennes, Jules Mougin (1912-2010), qui a repris cette tradition illustrative en mêlant mots et dessins au recto et au verso de ses lettres.
La peinture est plus forte que moi…
J’adore la boutade de Pablo Picasso (1881-1973) que Michel Leiris (1901-1990) a reproduite dans l’un de ses écrits (1963) sur le peintre : « La peinture est plus forte que moi, elle me fait faire ce qu’elle veut ».
(Samedi 26 septembre 2020)
Jean-Rémi Pecchi : un bonheur de miniaturiste
 Ces trois images du monde du travail montrent à quel point l’acuité de l’observation permet d’atteindre une vérité du visible que ne discerne pas toujours l’œil ordinaire. Dans le jeu d’orgue des tubulures, tout est fulgurance de gris. Gris ardoisé, perlé, cendré, laiteux ; gris d’argent, gris de fer, gris de pierre, gris de plomb. Regardez plus attentivement l’alignement des éoliennes : leurs pales révèlent une mécanique tranchante de couteaux prêts à fendre l’air sous l’énergie du vent.
Ces trois images du monde du travail montrent à quel point l’acuité de l’observation permet d’atteindre une vérité du visible que ne discerne pas toujours l’œil ordinaire. Dans le jeu d’orgue des tubulures, tout est fulgurance de gris. Gris ardoisé, perlé, cendré, laiteux ; gris d’argent, gris de fer, gris de pierre, gris de plomb. Regardez plus attentivement l’alignement des éoliennes : leurs pales révèlent une mécanique tranchante de couteaux prêts à fendre l’air sous l’énergie du vent.  Mélange d’hydrocarbures, c’est-à-dire de composés du carbone et de l’hydrogène, le pétrole subit différents traitements visant à générer des produits finis (carburants, combustibles, solvants, lubrifiants, etc.) adaptés aux multiples besoins de notre civilisation. Mélange d’hydrocarbures, c’est-à-dire de composés du carbone et de l’hydrogène, le pétrole subit différents traitements visant à générer des produits finis (carburants, combustibles, solvants, lubrifiants, etc.) adaptés aux multiples besoins de notre civilisation.  Sur le site Naphtachimie de Lavera à Martigues, la mise en œuvre des opérations de distillation et de raffinage du pétrole repose sur des infrastructures qui fascinent Jean-Rémi Pecchi à travers les fantastiques assemblages de canalisations et d’échafaudages, de décanteurs et de réacteurs, d’échangeurs et de fours, d’incinérateurs et de tours. Lieu de changement permanent, sans cesse en train de se défaire et de se refaire, le site usinier offre au regard acéré un bonheur de miniaturiste et dispense de nouvelles harmonies de valeurs, tout en révélant une poésie véritable. Sur le site Naphtachimie de Lavera à Martigues, la mise en œuvre des opérations de distillation et de raffinage du pétrole repose sur des infrastructures qui fascinent Jean-Rémi Pecchi à travers les fantastiques assemblages de canalisations et d’échafaudages, de décanteurs et de réacteurs, d’échangeurs et de fours, d’incinérateurs et de tours. Lieu de changement permanent, sans cesse en train de se défaire et de se refaire, le site usinier offre au regard acéré un bonheur de miniaturiste et dispense de nouvelles harmonies de valeurs, tout en révélant une poésie véritable.
Photos Jean-Rémi Pecchi © Droits réservés
Conversation
L’intelligence et l’amitié s’aiguisent dans l’exercice de la conversation.
(Dimanche 27 septembre 2020)
|
Billet d’humeur
La vallée des geysers
Haut lieu socio-culturel du Moyen Âge (dans le domaine de l’écriture et du livre), la vallée de l’Haukadalur, au sud-ouest de l’Islande, compte un des jets d’eau bouillante les plus célèbres, Geysir, qui a donné son nom à tous les phénomènes géothermiques analogues. À environ 100 km à l’est de la capitale Reykjavik, le site occupe le versant Est d’un dôme de lave appelé Laugarfall, à 187 mètres d’altitude, sur environ 3 kilomètres carrés, reliquat d’un ancien volcan comprimé entre deux rivières. Le vocable signifie « celui qui jaillit » et dérive du verbe islandais gjósa ou geysa, qui veut dire « jaillir », provenant lui-même du vieux norrois (vieil islandais) gøysa. Le geyser français, nom masculin, est un emprunt à l’anglais geyser. Les geysers naissent de sources chaudes dont l’eau, venue des profondeurs, s’accumule au centre d’un bassin, façonné en forme de dôme par des dépôts successifs de silice. Lentement chauffée au contact des roches volcaniques, l’eau atteint une température supérieure à 100° Celsius, se transforme en vapeur et, lorsque la pression devient trop forte, une colonne d’eau bouillonnante et de vapeur se forme et se propulse au-dessus de la surface de la terre en un formidable jaillissement. De nos jours, le grand Geysir ne jaillit qu’une à deux fois par an à une hauteur de 60 mètres, lorsque, à l’occasion de grands événements comme le jour de l’Indépendance, le 17 juin, on le réveille avec du savon ou du détergent. Cette pratique a pour effet de réduire la tension de surface de l’eau et permettre au geyser d’entrer en éruption. En 2000, un séisme l’a réactivé et fait rejaillir deux jours durant à 120 m de hauteur. À une cinquantaine de mètres du Geysir, un autre geyser, le Strokkur (la « Baratte »), que l’homme a créé artificiellement, est beaucoup plus actif et régulier, avec des jaillissements intermittents quasiment journaliers qui culminent à une trentaine de mètres. Les sources chaudes de la vallée ont édifié un paysage spectaculaire d’évents, de panaches de vapeur, de dépôts multicolores et de marmites de boue bouillonnantes, sonores et nauséabondes (la teneur en soufre exhale une odeur significative d’œuf pourri). Les géologues ont estimé entre 8 000 et 10 000 ans l’âge de cet immense champ geysérien. Au XIXe siècle, les sources du grand Geysir dépendaient d’un domaine agricole, la ferme Laug qui connut à partir de 1894 différents acquéreurs avant d’être légué à l’État islandais, en 1935, par l’homme d’affaires et producteur de cinéma Sigurður Jónasson. Aujourd’hui, un Comité Geysir assure la sauvegarde des lieux et se préoccupe notamment des richesses faunistiques et floristiques inventoriées dans cette région para-volcanique.
|
Lecture critique
Antoine Minaud plaide pour la langue française
 À l’exemple de Maurice Druon, Claude Duneton, Jean Dutourd et Alfred Gilder qui ont pratiqué l’exercice, Antoine Minaud énonce et dénonce le français délabré : fautes de langue, impropriétés, barbarismes, solécismes, accords fautifs, dérivations absurdes et, surtout, anglicismes. Dans un ouvrage, « La Langue française à la dérive », il lance un cri d’alarme face à la dégradation de notre langue qui intervient, selon lui, à plusieurs niveaux de la société, à l’école, à l’université, au sein des entreprises, dans la rue, dans les cabinets ministériels, chez les parlementaires, au cœur des institutions internationales. Il va jusqu’à désigner le président de la République française Emmanuel Macron, de prendre part au déclin du français avec la complicité de l’Organisation des Nations unies et de la Banque mondiale : « Ils ont eu la triste idée de nommer ce rassemblement "One Planet Summit" pour que leur langue sombre encore plus dans l’addiction à l’anglicisme. Il s’est agi tout simplement d’accréditer le fait que le français n’est plus utilisable en France et qu’il est descendu au rang d’un dialecte vieillot et sans avenir. Il semblerait qu’il faille rappeler à nos dirigeants qu’il fut naguère adopté par la diplomatie. » L’ancien administrateur des affaires maritimes de Concarneau a raison de pointer mots au sens détourné, impropriétés, clichés et tics verbaux qui multiplient l’emploi intempestif de locutions comme en termes de, en fait, de nouveautés telles préposé, hôtesse de caisse pour facteur et caissière, de mots « fourre-tout » parmi lesquels ludique, culte, communion, grand-messe, problématique, sans compter la déferlante d’anglicismes dont burn out, car jacking, coach, cocooning, come-back, fake news, prime time, story et autres black Fridays (il pourra leur ajouter cluster pour foyer de contagion…). Au fil de la plaidoirie, on retiendra quelques bribes, touchantes, de son credo : « Aimer la langue française, s’explique-t-il, c’est s’enthousiasmer de ses racines profondes. En effet elle est d’origine latine pour sa très grande partie avec apport non négligeable de termes provenant du grec. À sa façon elle contribue à ce que ces langues "mortes" ne le soient pas vraiment, à ce que leurs graines qui ont germé donnent encore des plantes, modifiées génétiquement selon une expression moderne, mais bien vivantes avec le français et ses cousines de l’Europe du Sud et de la Roumanie. » À l’exemple de Maurice Druon, Claude Duneton, Jean Dutourd et Alfred Gilder qui ont pratiqué l’exercice, Antoine Minaud énonce et dénonce le français délabré : fautes de langue, impropriétés, barbarismes, solécismes, accords fautifs, dérivations absurdes et, surtout, anglicismes. Dans un ouvrage, « La Langue française à la dérive », il lance un cri d’alarme face à la dégradation de notre langue qui intervient, selon lui, à plusieurs niveaux de la société, à l’école, à l’université, au sein des entreprises, dans la rue, dans les cabinets ministériels, chez les parlementaires, au cœur des institutions internationales. Il va jusqu’à désigner le président de la République française Emmanuel Macron, de prendre part au déclin du français avec la complicité de l’Organisation des Nations unies et de la Banque mondiale : « Ils ont eu la triste idée de nommer ce rassemblement "One Planet Summit" pour que leur langue sombre encore plus dans l’addiction à l’anglicisme. Il s’est agi tout simplement d’accréditer le fait que le français n’est plus utilisable en France et qu’il est descendu au rang d’un dialecte vieillot et sans avenir. Il semblerait qu’il faille rappeler à nos dirigeants qu’il fut naguère adopté par la diplomatie. » L’ancien administrateur des affaires maritimes de Concarneau a raison de pointer mots au sens détourné, impropriétés, clichés et tics verbaux qui multiplient l’emploi intempestif de locutions comme en termes de, en fait, de nouveautés telles préposé, hôtesse de caisse pour facteur et caissière, de mots « fourre-tout » parmi lesquels ludique, culte, communion, grand-messe, problématique, sans compter la déferlante d’anglicismes dont burn out, car jacking, coach, cocooning, come-back, fake news, prime time, story et autres black Fridays (il pourra leur ajouter cluster pour foyer de contagion…). Au fil de la plaidoirie, on retiendra quelques bribes, touchantes, de son credo : « Aimer la langue française, s’explique-t-il, c’est s’enthousiasmer de ses racines profondes. En effet elle est d’origine latine pour sa très grande partie avec apport non négligeable de termes provenant du grec. À sa façon elle contribue à ce que ces langues "mortes" ne le soient pas vraiment, à ce que leurs graines qui ont germé donnent encore des plantes, modifiées génétiquement selon une expression moderne, mais bien vivantes avec le français et ses cousines de l’Europe du Sud et de la Roumanie. »
L’avertissement est nécessaire, certes, mais l’assertion selon laquelle le français pourrait disparaître est excessive. Je dirai même que notre langue ne se porte pas si mal que ça. Grâce notamment à des écrivains aux patronymes étrangers comme Tahar Ben Jelloun, Patrick Chamoiseau, Georges Semprun, François Cheng, Emil Cioran, Milan Kundera, Hector Biancotti, Boualem Sansal, Andreï Makine, Atiq Rahimi, Akira Mizubayashi, des grands de notre littérature qui publient en français alors que ce n’est pas leur langue maternelle. « La langue française élargit ses horizons, se réjouit à cet égard Michel del Castillo, écrivain français d’origine espagnole, elle métisse ses influences, enrichit son vocabulaire et sa philosophie. Lorsqu’un étranger choisit cette langue pour écrire un roman, il me semble qu’il s’agit du plus bel hommage. »
- La Langue française à la dérive, par Antoine Minaud, éditions Yellow Concept, 166 pages, 2019.
Portrait
Franz Hellens à la découverte de la Méditerranée
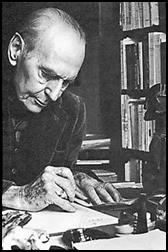 Mélusine ou la robe de saphir (1920), Réalités fantastiques (1923), Moreldieu (1946), Les Marées de l’Escaut (1953), les Mémoires d’Elseneur (1954), Arrière-saisons (poésie, 1967) valent d’être lues comme les œuvres-pivots d’un littérateur d’exception à la condition qu’on leur ajoute Le Voyage rétrospectif - Impressions d’Afrique du Nord, un récit commencé en octobre 1925 à Marseille, revu en mai 1966 à La Celle-Saint-Cloud et publié en février 2000 aux Presses universitaires Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Dans ces ouvrages, Franz Hellens (Bruxelles, 1881-1972) apparaît dans la puissance du verbe et l’originalité d’une mythologie liée à la géographie de ses pérégrinations. Familière de l’œuvre du romancier, poète, essayiste et critique d’art belge, Sourour Ben Ali (Tunis, 1972) complète à bon escient la lecture du Voyage rétrospectif par un appareil documentaire et une analyse critique d’excellent aloi. Mélusine ou la robe de saphir (1920), Réalités fantastiques (1923), Moreldieu (1946), Les Marées de l’Escaut (1953), les Mémoires d’Elseneur (1954), Arrière-saisons (poésie, 1967) valent d’être lues comme les œuvres-pivots d’un littérateur d’exception à la condition qu’on leur ajoute Le Voyage rétrospectif - Impressions d’Afrique du Nord, un récit commencé en octobre 1925 à Marseille, revu en mai 1966 à La Celle-Saint-Cloud et publié en février 2000 aux Presses universitaires Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Dans ces ouvrages, Franz Hellens (Bruxelles, 1881-1972) apparaît dans la puissance du verbe et l’originalité d’une mythologie liée à la géographie de ses pérégrinations. Familière de l’œuvre du romancier, poète, essayiste et critique d’art belge, Sourour Ben Ali (Tunis, 1972) complète à bon escient la lecture du Voyage rétrospectif par un appareil documentaire et une analyse critique d’excellent aloi.
Son nom de plume associé à un marchand de vin…
Né Frédéric van Ermenghem le 8 septembre 1881 à Bruxelles (mort dans la même ville le 20 janvier 1972), il doit son pseudonyme à un marchand de vin gantois dont l’enseigne et le patronyme avaient séduit l’adolescent de seize ans. Ses parents vivent à Wetteren, petite ville située sur l’Escaut près de Gand ; son père Émile (1851-1932) est un clinicien bactériologiste de réputation internationale qui deviendra le secrétaire perpétuel de l’Académie royale de médecine de Belgique de 1919 à sa mort. Docteur en droit (1905), le fils renonce à la carrière d’avocat pour entrer à la bibliothèque Royale Albert Ier où il a la charge des périodiques : il sera plus tard bibliothécaire en chef à la bibliothèque du Parlement. La passion dominante des belles lettres et des arts l’amène à se lier avec les prosateurs et les peintres de son temps : Louis Aragon, Henri Calet, Jean Cocteau, Paul Éluard, Michel de Ghelderode, Maxime Gorki, Maurice Maeterlinck, Vladimir Nabokov, Jean Paulhan, Francis Ponge, Jules Supervielle d’une part, Giorgio De Chirico et Amedeo Modigliani d’autre part. Son compatriote, l’écrivain et journaliste Jacques De Decker (1945-2020), se plaisait à raconter à son propos : « Il avait rencontré Gorki à Sorrente, en 1928, et l'y avait vu allumer un feu au fond d'un jardin. "Je fais cela chaque fois que le mal du pays me devient intolérable", lui avait confié l'auteur de "La Mère". Avec Maïakovski, il avait disputé, à Paris, des parties de billard passionnées. Nabokov, qu'il connut dans l'entre-deux-guerres, avait pour lui de l'affection et de l'admiration, et déclara plus tard à ses étudiants de Cornell, aux États-Unis, que Robbe-Grillet était sans intérêt, mais que son ami Hellens était, lui, un des plus grands écrivains contemporains. »
L’œuvre d’un styliste
En 1920, il devient revuiste en créant Le Disque vert qui publia les premiers textes d’auteurs devenus par la suite célèbres dont les poètes russes Sergueï Essenine et Vladimir Maïakovski. Abondante et protéiforme, son œuvre (quelque cent vingt titres dont une vingtaine de recueils de poésie) circonscrit volontiers les territoires du « fantastique réel » : cette expression qui est la sienne atteste des réalités singulières, étranges, paradoxales, parfois excentriques, du quotidien de ses contemporains soumis aux lois du hasard. Pérégrination initiatique ou révélation spirituelle, la découverte de la Méditerranée s’apparente chez lui à un conte oriental où il reconnaît n’avoir pour rôle que celui d’un spectateur étonné. 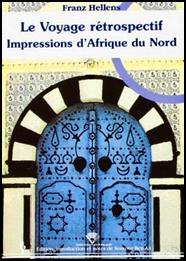 De Tunis à Kairouan, de Constantine à Biskra, ses récits recèlent autant de bonheurs d’écriture que d’une pertinence d’analyse des lieux et des hommes. De Sidi-Bou-Saïd, il rapporte qu’« on y boit le thé aux pignons, et des enfants viennent vous proposer des bouquets de jasmins, enroulés dans des feuilles de figuier ». À Marseille, les ruelles regorgent de surprises et de rencontres fortuites : « D’autres mendiants, masculins ou féminins, tout le long des couloirs, au soleil et à l’ombre, confondus avec l’ordure, devenus ordures et tout brillants d’ordure, chantent ou se taisent, tendent des mains ou demeurent sans bouger et comme indifférents à ce qui se passe. Ils ont l’air de dormir. Ils prient ou ils rêvent. Plusieurs sont aveugles. Quelques-uns beaux comme des Rembrandt. » Dans le désert, « le chameau offre une première idée du Sahara. Cet animal semble construit de toutes pièces pour résister au sable. Ses larges pieds d’abord faits pour ne pas s’enfoncer, la souplesse de son architecture, le dos comme un pont d’osier, les pattes longues et fines, et le balancement du ventre comme une outre toujours gonflée. Il y a aussi ce long cou majestueux de cygne sec, cette tête surtout, ce visage, cette bouche, ces yeux. » « D’Alger je n’ai retenu que le tableau du quai, aperçu du bateau, au départ, avec ses grandes masses blanches, cubes d’une pureté de lignes parfaite, ses arcades en arpèges et quelques notes pointues ou arrondies : les mosquées. » Quel styliste ! De Tunis à Kairouan, de Constantine à Biskra, ses récits recèlent autant de bonheurs d’écriture que d’une pertinence d’analyse des lieux et des hommes. De Sidi-Bou-Saïd, il rapporte qu’« on y boit le thé aux pignons, et des enfants viennent vous proposer des bouquets de jasmins, enroulés dans des feuilles de figuier ». À Marseille, les ruelles regorgent de surprises et de rencontres fortuites : « D’autres mendiants, masculins ou féminins, tout le long des couloirs, au soleil et à l’ombre, confondus avec l’ordure, devenus ordures et tout brillants d’ordure, chantent ou se taisent, tendent des mains ou demeurent sans bouger et comme indifférents à ce qui se passe. Ils ont l’air de dormir. Ils prient ou ils rêvent. Plusieurs sont aveugles. Quelques-uns beaux comme des Rembrandt. » Dans le désert, « le chameau offre une première idée du Sahara. Cet animal semble construit de toutes pièces pour résister au sable. Ses larges pieds d’abord faits pour ne pas s’enfoncer, la souplesse de son architecture, le dos comme un pont d’osier, les pattes longues et fines, et le balancement du ventre comme une outre toujours gonflée. Il y a aussi ce long cou majestueux de cygne sec, cette tête surtout, ce visage, cette bouche, ces yeux. » « D’Alger je n’ai retenu que le tableau du quai, aperçu du bateau, au départ, avec ses grandes masses blanches, cubes d’une pureté de lignes parfaite, ses arcades en arpèges et quelques notes pointues ou arrondies : les mosquées. » Quel styliste !
Franz Hellens © Photo X. droits réservés
- Le Voyage rétrospectif - Impressions d’Afrique du Nord, par Franz Hellens, édition, introduction et notes de Sourour Ben Ali, Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 104 pages, 2000 ;
- Le Double et autres contes fantastiques choisis, par F. Hellens, Espace Nord, 313 pages, 2009 ;
- Mélusine ou la robe de saphir, Espace Nord, 365 pages, 2019.
Varia : hommage à Susan Sontag (1933-2004)
« Susan Sontag va à l’encontre d’un certain nombre de positions, dont celle des philosophes français dont elle épingle ce qui, à ses yeux, reste une mystification intellectuelle. Point de vue inacceptable et qui relève "d’un provincialisme stupéfiant" que celui d’occidentaux spectateurs aguerris, pour qui aucune souffrance n’est réelle, puisque médiatisée, surtout lointaine.  Pour se protéger de la douleur des autres, il importe de regarder de loin des images de guerre et de catastrophe, car l’autre, sa douleur, son image ne nous touche que s’il nous est proche et, par conséquent, réel. Si on lui dénie toute réalité, nous voilà protégés ! Pour se protéger de la douleur des autres, il importe de regarder de loin des images de guerre et de catastrophe, car l’autre, sa douleur, son image ne nous touche que s’il nous est proche et, par conséquent, réel. Si on lui dénie toute réalité, nous voilà protégés !
« Il est aussi absurde, conclut Susan Sontag, de réduire le monde à celui des pays riches que de refuser de croire à la compassion ou à l’empathie de millions de spectateurs qui sont "loin d’être immunisés contre ce qu’ils voient à la télévision.". Ce qui relève de la condescendance des pays riches, ici mis en accusation ; mais Sontag pointe aussi du doigt l’éducation qui nous pousserait à "considérer avec cynisme la possibilité de la sincérité". Pour ne pas être victimes de manipulation, nous suspectons les photographes qui ramènent ces images de guerre en remettant en question leur légitimité. Dès lors, l’appétit pour ces sortes d’images est montré du doigt par les intellectuels comme "un appétit vulgaire, une faim commerciale de morbidité".
« Alors, comment regarder, se tenir devant ces images ?
« Pour Sontag, elle ne le nie pas, il y a nécessité des images, de voir les images, mais aussi de penser ce que l’on voit, en se demandant dans quel espace ces images sont vues. Trop souvent visibles dans des lieux marchands (centres commerciaux, mais aussi aéroports ou encore musées), les images n’auraient-elles pas besoin d’un espace spécifique, équivalent des temples et des églises pour la religion ? Car, selon le lieu où elles sont visibles, leur signification change, ce qui démontre l’impact du lieu où on les regarde, j’allais écrire, où on les consomme… La violence du visible ne se trouve pas dans le contenu seulement, mais aussi dans le dispositif. Ce qui rapproche Susan Sontag de la philosophe française Marie-José Mondzain pour qui il y a nécessité de penser l’image à la fois dans son contenu et dans son dispositif. Pour elle, "il n’y a que ce qui rend bête qui rend méchant".
« Devant l’image qui montre la douleur des autres, il reste à lutter contre plusieurs attitudes : la défection morale mais aussi la naïveté de qui croit découvrir l’horreur ou le cynisme de celui qui la voit comme une représentation et rien d’autre. »
Extrait d’un texte de Sylvie Durbec, « Devant Susan Sontag, écrire ? », issu d’un dossier consacré à Susan Sontag (1933-2004), revue « Les Carnets d’Eucharis », éditée par L’Atelier les Carnets d’Eucharis/éditions Gaussen, 206 pages, 2013.
Carnet : De profundis
Peu de gens à la cérémonie funèbre au crématorium. Le défunt ne manquait pas d’ennemis. Mais, comme disait le romancier Henry de Montherlant (1895-1972) : « N’avoir que des amis est une obligation de commerçant ; se faire des ennemis est une occupation d’aristocrate. »
Chauve avec des lunettes…
Alec Guinness (1914-2000) a raconté comment, en déposant son manteau dans un vestiaire, l’employée lui fit savoir qu’il n’avait pas besoin de lui dire son nom. Flatté d’avoir pour une fois été reconnu, l’acteur britannique retrouva plus tard dans sa poche un petit papier sur lequel la dame du vestiaire avait écrit « chauve, avec des lunettes ».
(Lundi 12 octobre 2020)
Communication
Un zeste de littérature pour respirer, un éclat de Deleuze. Il date de 1990 : « Nous ne souffrons pas d’incommunication, mais au contraire de toutes les formes qui nous obligent à nous exprimer quand nous n’avons pas grand-chose à dire. (…) Créer n’est pas communiquer mais résister. »
(Mercredi 14 octobre 2020)
Les monarques de la Toussaint
Les gens de la région de Michoacan, au Mexique, connaissent la présence hivernale des papillons depuis toujours. Comme les monarques arrivent massivement à peu près pour la Toussaint, ils sont censés incarner les âmes des morts, revenus dire bonjour à leurs familles, et on leur fait fête sur la place d’Angangueo, en fanfare pétaradante et costumes orange et noir.
(Mardi 20 octobre 2020)
Gourmandise
Un livre de recettes, avec ses coulis, ses amourettes, fricandeaux, veloutés, aspics et autres fricots, se conjugue avec la même jubilation que des noms de fleurs ou certains poèmes. Nulle convivialité sans le manger et le boire. Les meilleures conversations, les plus savoureuses scènes de famille se cristallisent souvent autour d’une table.
(Jeudi 5 novembre 2020)
|
Billet d’humeur
La barbe !
Dans sa « Pogomologie ou Histoire philosophique de la barbe » (1786), Jacques-Antoine Dulaure (1755-1835) enseigne que la mode de se raser fut apportée de Sicile en Italie en 296 avant Jésus-Christ par le sénateur romain Ticinius Mena, qui amena avec lui une compagnie sicilienne de barbiers, corporation inconnue jusque-là. Général et homme d’État romain, Scipion l’Africain (236-183 av. J.-C.) aurait été le premier à se servir, tous les jours à Rome, d’un rasoir en bronze. Dans un ouvrage, l’archéologue et historien clermontois rappelle que les premiers chrétiens condamnaient le menton lisse et le visage glabre sous le prétexte que l’absence de pilosité témoignait des mauvais penchants de l’intéressé. Le chroniqueur s’amuse à l’évocation de la levée de taxes pour port de la barbe par les monarques Henri VIII (1491-1547), roi d’Angleterre, et Pierre le Grand (1672-1725), tsar de Russie ! Il se félicite qu’au XVIIIe siècle, les barbiers anglais et français aient enfin renoncé à leur droit de pratiquer la chirurgie et la dentisterie…
Savez-vous que l’écrivain André Gide (1869-1951) qui n’était pas barbu s’est coupé les moustaches trois jours avant de fonder la Nouvelle Revue française ? Il anticipait par son geste toute la modernité de son roman « Les Caves du Vatican » qu’admireront tant les surréalistes dont la binette était dépourvue de poils… Son confrère Guy de Maupassant (1850-1893) s’est accidentellement brûlé la barbe le 5 octobre 1875 ; il fut littéralement terrorisé par l’image que lui renvoya après l’incident le verre poli de son miroir. L’auteur de « Bel-Ami » (1885) prit alors la décision de ne garder qu’une moustache, attribut avec lequel il passera à la postérité.
|
Lecture critique
Le Père Tanguy, le broyeur de couleurs des Impressionnistes
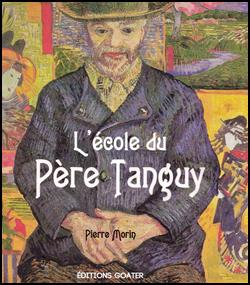 Il est à la fois juste et louable que Pierre Morin (Saint-Brieuc, 1939) ait rendu à son ancêtre l’hommage et la place qui lui sont dus. Dans « L’École du Père Tanguy », le peintre raconte la vie peu banale de Julien Tanguy (Plédran, 28 juin 1825- Paris, 6 février 1894) qui fut davantage qu’un simple broyeur de couleurs au point d’être associé au fameux groupe pictural des Impressionnistes (1874-1886). L’auteur qui compte parmi la parentèle de son « modèle » par Jeanne Tanguy, sa grand-mère paternelle, voue une affectueuse admiration à son ascendant dont il retrace assez fidèlement, semble-t-il, et très sobrement les épisodes les plus caractéristiques de la carrière. Il est à la fois juste et louable que Pierre Morin (Saint-Brieuc, 1939) ait rendu à son ancêtre l’hommage et la place qui lui sont dus. Dans « L’École du Père Tanguy », le peintre raconte la vie peu banale de Julien Tanguy (Plédran, 28 juin 1825- Paris, 6 février 1894) qui fut davantage qu’un simple broyeur de couleurs au point d’être associé au fameux groupe pictural des Impressionnistes (1874-1886). L’auteur qui compte parmi la parentèle de son « modèle » par Jeanne Tanguy, sa grand-mère paternelle, voue une affectueuse admiration à son ascendant dont il retrace assez fidèlement, semble-t-il, et très sobrement les épisodes les plus caractéristiques de la carrière.
Paysan-tisserand puis plâtrier à La Touche-Jaguay, le hameau de Plédran où il est né, dans les Côtes-d’Armor, le Père Tanguy quitte la Bretagne pour Paris en 1860 avec sa femme née Renée-Julienne Briend et leur fille Mathilde âgée de cinq ans. Une place de concierge au 10 de la rue Jean-Pierre Cortot, sur la butte Montmartre (Paris, IXe arr.), lui permet de s’adonner à sa passion : broyer les pigments en poudre de couleur plus ou moins affinée. Il se donne sept années d’apprentissage avant de devenir producteur indépendant. Mais, déjà, il rejoint les peintres qui travaillent sur le motif dans la campagne d’Île-de-France et qu’il fournit : la qualité de ses couleurs est attestée par plusieurs de ses « clients » en dépit de l’invention récente de la peinture en tube. La guerre de 1870, le régime de la Commune et son incarcération au camp de Satory imposent à l’artisan communard une interruption de trois années. En 1873, Camille Pissarro (1830-1903), de retour d’exil en Angleterre, l’aide à reconstituer sa clientèle en le conseillant à de nombreux confrères. En quelques mois, l’atelier-boutique de la rue Bertrand Clauzel va devenir une sorte de galerie où le Père Tanguy expose Alfred Sisley, Auguste Renoir, C. Pissarro, Claude Monet, Frédéric Bazille et Johan-Barthold Jongkind, jeunes peintres le plus souvent désargentés et dont la majorité ont voulu rompre avec l’académisme dominant. Paul Cézanne et Vincent Van Gogh ont intégré eux aussi le cénacle. « Si un amateur se présentait pour un Cézanne, relate Pierre Morin, le Père Tanguy le conduisait dans l’atelier du peintre dont il avait la clé ». « Le jeune et fougueux Van Gogh suivra Gauguin et Lautrec dans la vie artistique de Montmartre, narre encore l’auteur, et descendra comme tous dans la boutique du "Socrate de la rue Clauzel" pour y voir la peinture nouvelle et en particulier des Cézanne. » Son intention de faire se rencontrer les deux hommes sera par contre un échec. Le verdict sera cuisant : « Vous faites une peinture de fou ! » lança le maître aixois à son cadet, ce qui n’affectera pas l’admiration de Van Gogh pour son glorieux aîné. « Vincent Van Gogh peindra au moins trois portraits de Julien Tanguy, signale P. Morin, dont deux s’enrichissent d’estampes japonaises en arrière-plan » : la mode des porcelaines japonaises est intervenue au moment où Julien Tanguy commençait son métier de broyeur de couleurs. C’est d’ailleurs lors d’une vente d’œuvres organisée par le comité de soutien au Père Tanguy (présidé par le peintre Pierre Puvis de Chavannes), au lendemain de la mort de l’artisan, que le sculpteur Auguste Rodin acquit d’un des portraits du Père Tanguy peint, en 1886, par Vincent Van Gogh.
- L’École du Père Tanguy, de Pierre Morin, éditions Goater, 128 pages, 2019.
Portrait
Le hérisson d’Europe est en danger !
 De la garrigue méditerranéenne aux côtes norvégiennes, dans toute l’Europe occidentale en fait, le hérisson d’Europe s’est installé facilement. « À l’origine, remarque Christine Wuillemin, maître d’œuvre du dossier « Hérisson mon héros » de la revue « Salamandre », Erinaceus europaeus (Linné, 1758) se limitait aux clairières et lisières des forêts qui ont recouvert le continent à la fin des glaciations. Puis, là où les humains ont abattu les arbres pour leurs cultures et pâturages enserrés de haies protectrices, les hérissons se sont multipliés, profitant de l’essor de l’agriculture traditionnelle qui lui offrait des terrains de chasse ouverts et des cachettes toutes proches. » De la garrigue méditerranéenne aux côtes norvégiennes, dans toute l’Europe occidentale en fait, le hérisson d’Europe s’est installé facilement. « À l’origine, remarque Christine Wuillemin, maître d’œuvre du dossier « Hérisson mon héros » de la revue « Salamandre », Erinaceus europaeus (Linné, 1758) se limitait aux clairières et lisières des forêts qui ont recouvert le continent à la fin des glaciations. Puis, là où les humains ont abattu les arbres pour leurs cultures et pâturages enserrés de haies protectrices, les hérissons se sont multipliés, profitant de l’essor de l’agriculture traditionnelle qui lui offrait des terrains de chasse ouverts et des cachettes toutes proches. »
L’homme a réduit son espace vital
Dès les années 1950, les nouvelles conditions d’exploitation agricole avec l’utilisation de machines de plus en plus larges ont érodé l’espace dévolu au piqueux et l’emploi inconsidéré de pesticides a réduit ses effectifs et ceux de ses proies. En moins de vingt ans, les populations de hérisson ont diminué de 60 à 75 % dans les campagnes, en France, en Suisse et en Grande-Bretagne. Dans certaines villes et banlieues en revanche, l’animal semble se maintenir. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’a pas conquis les cités, ce sont elles qui ont poussé autour de lui, l’obligeant à se retrancher dans les squares, jardins et friches urbaines. « Le hérisson ne s’approprie pas de territoires précis en le marquant, comme le castor, explique la rédactrice en chef adjointe de "La Salamandre". En revanche, il défend un espace vital où il ne tolère aucun congénère. Son étendue varie selon les individus. Une femelle a besoin d’une zone de 0,1 à 0,2 km2, tandis qu’un mâle vise plutôt un espace de 0,32 à 0,5 km2. Certains casaniers arpentent toute leur vie les mêmes lisières, les mêmes jardins, les mêmes bosquets, alors que d’autres vadrouillent en permanence. »
Chez les hérissons, la femelle copule avec cinq ou six mâles différents. De la femelle fécondée naîtront, aveugles et sans piquants saillants, quatre à cinq bébés, après une gestation de trente-cinq jours en moyenne. Moins d’un mois après leur naissance, les petits hérissons se dispersent. Ils profitent de l’automne pour s’engraisser, trouver un gîte hivernal et se socialiser. Lorsque les températures rafraîchissent et que les proies se raréfient, le hérisson entre en hibernation, ce qui implique la réduction de son rythme cardiaque et de sa respiration et l’arrêt de son cycle digestif.
Le mammifère capte les ultrasons
La taille de ce mammifère à poils durs est de 22,5 à 27,5 cm, soit le gabarit d’un cochon d’Inde ; il pèse 450 à 680 grammes à un an et il peut vivre entre 4 et 8 ans. Il file incroyablement vite pour sa morphologie, jusqu’à atteindre des pointes à 7,2 km/h. Semi-nocturne, il est aussi capable de nager et d’escalader murs et clôtures.  En partie recouvertes d’une jupe de poils, les quatre pattes robustes de ce plantigrade sont pourvues de cinq doigts. Ses membres postérieurs disposent d’une plante allongée, d’un talon saillant et de longues griffes. Ses paluches antérieures ressemblent à des mains arrondies avec des griffes plus courtes, mais plus puissantes, qui lui permettent de creuser efficacement la terre. Peu sensibles aux basses fréquences (moins de 2 kHz), ses oreilles rondes ne réagissent pas à un bruit de pas, mais elles captent très bien les hautes fréquences (entre 7,6 et 84 kHz) et donc les ultrasons, ce qui lui permet de reconnaître les stridulations d’un grillon ou le bruissement d’une aile de papillon. Un adulte possède 36 dents avec des molaires pointues : sa dentition définitive est complète à un an environ. Son alimentation se compose essentiellement de vers, d’escargots, de limaces, de coléoptères, de fruits et de champignons. Il lui arrive aussi de croquer des œufs, serpents, lézards, grenouilles, rongeurs, oisillons et charognes. Des expériences ont montré qu’il supportait des quantités élevées de venin et de poison qui lui seraient injectés par des prédateurs : il survit par exemple à des doses 7 000 fois plus importantes de bactéries tétaniques que l’être humain. Il gobe même le méloé, un scarabée bleu dont le poison dosé à 4 mg tuerait un homme de 80 kg ! L’odorat est le sens le plus aiguisé de ce fin limier : il peut repérer un ver de terre enfoui à 3 cm de profondeur. En partie recouvertes d’une jupe de poils, les quatre pattes robustes de ce plantigrade sont pourvues de cinq doigts. Ses membres postérieurs disposent d’une plante allongée, d’un talon saillant et de longues griffes. Ses paluches antérieures ressemblent à des mains arrondies avec des griffes plus courtes, mais plus puissantes, qui lui permettent de creuser efficacement la terre. Peu sensibles aux basses fréquences (moins de 2 kHz), ses oreilles rondes ne réagissent pas à un bruit de pas, mais elles captent très bien les hautes fréquences (entre 7,6 et 84 kHz) et donc les ultrasons, ce qui lui permet de reconnaître les stridulations d’un grillon ou le bruissement d’une aile de papillon. Un adulte possède 36 dents avec des molaires pointues : sa dentition définitive est complète à un an environ. Son alimentation se compose essentiellement de vers, d’escargots, de limaces, de coléoptères, de fruits et de champignons. Il lui arrive aussi de croquer des œufs, serpents, lézards, grenouilles, rongeurs, oisillons et charognes. Des expériences ont montré qu’il supportait des quantités élevées de venin et de poison qui lui seraient injectés par des prédateurs : il survit par exemple à des doses 7 000 fois plus importantes de bactéries tétaniques que l’être humain. Il gobe même le méloé, un scarabée bleu dont le poison dosé à 4 mg tuerait un homme de 80 kg ! L’odorat est le sens le plus aiguisé de ce fin limier : il peut repérer un ver de terre enfoui à 3 cm de profondeur.
Le blaireau et le hibou, ennemis mortels
La cuirasse épineuse du hérisson et sa capacité à se mettre en boule - en pelote d’épingles - constituent l’un des systèmes défensifs les plus élaborés chez les mammifères terrestres. « L’animal possède entre 3 500 et 7 500 piquants érectiles, apprenons-nous à la lecture dudit dossier de "La Salamandre", selon qu’il s’agit d’un jeune à peine sevré ou d’un gros mâle. Ces aiguillons sont en fait des poils améliorés, composés de kératine. Mesurant entre 2 et 3 cm de long pour 1,5 mm de diamètre, ils sont ancrés dans la peau et poussent par groupe de trois, chacun orienté dans une direction différente. Si leur base est épaisse, leur sommet est très effilé et pointu, ce qui leur permet de se loger dans un museau menaçant. L’épine est creuse pour rester légère tout en étant consolidée par un réseau de cannelures qui empêchent les déformations. La durée de vie d’un piquant ne dépasse pas un an et demi. Passé ce délai, il tombe et un autre le remplace. »
Le blaireau et le hibou grand-duc sont les principaux ennemis mortels du hérisson. Le premier peut introduire ses longues griffes dans l’unique orifice de la carapace, avant de peler sa victime comme une banane. Le rapace use de ses serres et de son bec pour arracher la peau épineuse.
Récemment, on rangeait encore le hérisson dans l’ordre des insectivores avec la taupe et la musaraigne, ses cousins les plus proches. La génétique moléculaire lui a attribué aujourd’hui un ordre qui lui est propre : les érinacéomorphes.
Hérisson d’Europe © Photo X. droits réservés
- Revue Salamandre, la revue des curieux de nature, Hérisson mon héros, un dossier de Christine Wuillemin, éditions de la Salamandre à Neuchâtel, n° 257, avril-mai 2020, 66 pages.
Varia : Une bourse aux fleurs artificielles en Chine
Alberto Baraya, artiste né à Bogotá (Colombie) en 1968 : « La majorité des plantes que je collecte provient des usines chinoises de la ville de Yiwu, pas très loin de Shanghai. Les plantes artificielles représentent un marché énorme. En 2012, j’ai pu visiter un gigantesque centre commercial chinois spécialisé dans le marché des plantes artificielles, une "bourse aux fausses plantes", où l’on pouvait trouver aussi bien de minuscules pistils de marguerites que des étamines d’orchidées ou encore des palmiers grandeur nature. Chaque stand avait sa spécialité : roses de velours, pelouses artificielles vendues au mètre, plantes grimpantes, succulentes, etc. L’un d’eux vendait uniquement de fausses orchidées, pour la plupart asiatiques, mais certaines présentaient des motifs et des formes qui avaient évolué suivant l’imagination du dessinateur et ses représentations de l’exotisme. » […]
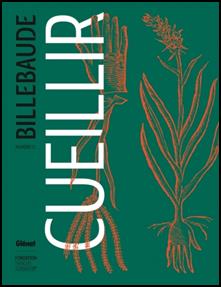 Joshua de Paiva : « Pour revenir au présent, dans un contexte de sixième extinction de masse des espèces, quel est le sens de cet herbier de plantes en plastique, manufacturées, faites de la main de l’homme ? Sommes-nous en train d’imaginer un monde dans lequel il ne resterait plus que des fleurs en plastique… pollinisées par des abeilles robotiques ? Joshua de Paiva : « Pour revenir au présent, dans un contexte de sixième extinction de masse des espèces, quel est le sens de cet herbier de plantes en plastique, manufacturées, faites de la main de l’homme ? Sommes-nous en train d’imaginer un monde dans lequel il ne resterait plus que des fleurs en plastique… pollinisées par des abeilles robotiques ?
Alberto Baraya : « Oui, il s’agit de l’une des idées que peut soulever mon herbier. Lorsque j’ai commencé à parler de ce projet d’exploration de la "fausse nature", on m’a tout de suite demandé : "Mais qu’est-il arrivé à la vraie nature ?" En fait, ce n’est pas le nombre de plantes artificielles qui serait, en lui-même, inquiétant : si on pousse cette logique jusqu’au bout, il faut se rappeler que la part de fausses plantes représente moins de 0,000001 % de l’ensemble des plantes de la planète ! Mais, bien sûr, si l’on se réfère aux annonces quasi messianiques d’apocalypse et de fin du monde, qui seraient, à l’ère de l’anthropocène, causées principalement par les activités humaines, on peut dire qu’il y a quelque chose de symboliquement fort dans le fait d’aller chercher des plantes artificielles à la frontière d’une des dernières forêts tropicales primaires, dans le bassin amazonien (2004). On peut être tenté d’aller jusqu’à décrire mon Expédition amazonienne comme une sorte de condamnation morale ou de mise en garde écologico-morale… Pourtant, ce n’était pas mon intention. Quoi qu’il en soit, il est vrai que la production de fausses plantes augmente à un rythme effréné, au fil des collections qui sortent chaque année en Chine. On pourrait y voir une sorte de symptôme symbolique de remplacement du monde naturel par sa représentation, du "vrai" par le "factice" ou l’artificiel. Ce qui est en jeu, je crois, ce n’est pas tant de considérer ce commerce de plantes artificielles comme une conséquence, à strictement parler, de la destruction du monde ; plus profondément, il dit quelque chose de notre manière de nous rapporter au monde. Il est révélateur des pulsions humaines modernes de domination, de possession et de contrôle qui passent souvent par la représentation et la reproduction du monde naturel. C’est pourquoi je ne cherche pas tant à répéter une sorte de message apocalyptique sur la disparition du monde naturel, qu’à proposer des voies de réflexion pour interroger les liens entre représentation et domination de ce dernier par les humains. »
Extrait de « Histoires d’herbiers », entretien avec Marc Jeanson (botaniste, responsable de l’herbier national au Muséum national d’histoire naturelle de Paris) et Alberto Baraya par Joshua de Paiva, issu de la revue « Billebaude », n° 12, printemps-été 2018, dossier « Cueillir » dirigé par Anne de Malleray, éditions Glénat et fondation Sommer pour la chasse et la nature, 96 pages.
Carnet : notations en clef de sol
Leoš Janáček (1854-1928), « ce petit homme moustachu », nous dit Milan Kundera (Brno, 1929), « se promène, un carnet ouvert à la main, et écrit en notes de musique les propos qu’il entend dans la rue. C’est sa passion : mettre la parole vivante en notation musicale ». Le compositeur tchécoslovaque cherchait à percer le mystère de la réalité immédiate et fuyante qui déserte tant notre quotidien.
(Mardi 10 novembre 2020)
|
Billet d’humeur
Les chiens et les chats des écrivains
Paul Valéry (1871-1945) dessinait des chiens pendant ses loisirs, et André Malraux (1901-1976) des chats durant les séances du conseil des ministres. À chacun son bestiaire et ses fantaisies. Les chiens étaient une énigme pour l’auteur de « Monsieur Teste » (1896). Sans doute s’interrogeait-il sur le mystère des relations que l’espèce humaine entretient avec la gent canine. Poète sombre et solitaire, Charles Baudelaire (1821-1867) trouvait un réconfort, presque une complicité dans la compagnie des chats. Guillaume Apollinaire (1880-1918) ne se lassait pas de regarder passer son chat Pipo parmi les livres de sa bibliothèque. Arrêté au Danemark, Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) cacha le sien, qu’il avait baptisé Bébert, dans le placard de sa chambre, à l’hôpital de la prison où il était détenu. Dans « Messagerie intime » (1869), Théophile Gautier (1811-1872) loue l’indépendance, le mystère et le ronronnement familier de ses chats (qu’il nomme Cléopâtre, Éponine, Gavroche et Séraphita) : « Conquérir l’amitié d’un chat est chose difficile, écrit-il. C’est une bête philosophique (…) qui ne place pas ses affections à l’étourdie. Il veut bien être votre ami si vous en êtes digne, mais pas votre esclave ». Indécrottable misanthrope, Paul Léautaud (1872-1956) adorait les chats. En cinquante ans, il en recueillit plus de 300 dans sa maison de Fontenay-aux-Roses, en banlieue parisienne ! « Ma moyenne, disait-il, c’était une trentaine de chats. Tous sont morts de leur belle mort, chez moi, et ils sont tous enterrés dans le jardin. » Sur le feuillet d’un grand cahier, l’écrivain avait projeté un plan avec les noms et les emplacements des tombes de chaque animal… Plus dramatique en revanche est l’anecdote rapportée par le philosophe Emmanuel Levinas (1906-1995) : il raconte que, dans l’Allemagne nazie, seuls les chiens errants regardaient encore les déportés comme des hommes.
|
Lecture critique
Raspail, farouche républicain et médecin des pauvres
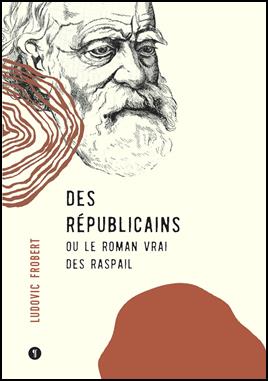 Envisagée dès 1876, deux années avant la mort du chimiste et homme politique, la rétrospection de la vie de François-Vincent Raspail (Carpentras, 25 janvier 1794-Arcueil, 7 janvier 1878) met en lumière les multiples facettes d’un personnage épris tout à la fois de justice sociale, de progrès démocratique et d’assistance médicale aux plus démunis. Sur les bases d’un récit factuel, l’ouvrage de l’historien et économiste Ludovic Frobert, « Des Républicains, ou le roman vrai des Raspail », suppose les commentaires d’un narrateur qui n’est autre que le fils aîné de la fratrie, Benjamin (1823-1899), artiste peintre de son état. Le récit romancé projette tout aussi librement les interventions de l’épouse et mère, Henriette-Adélaïde Troussot, de leur fille Marie-Apolline (1836-1876) et des trois frères de Benjamin - un cinquième étant mort en bas âge : Camille (1827-1893), médecin, Émile (1831-1887), ingénieur chimiste, et Xavier (1840-1926), médecin amateur d’ornithologie. Les cinq enfants ont assisté continûment leur père dans son engagement républicain dans la maison familiale d’Arcueil et souvent même à la tribune de l’assemblée. Envisagée dès 1876, deux années avant la mort du chimiste et homme politique, la rétrospection de la vie de François-Vincent Raspail (Carpentras, 25 janvier 1794-Arcueil, 7 janvier 1878) met en lumière les multiples facettes d’un personnage épris tout à la fois de justice sociale, de progrès démocratique et d’assistance médicale aux plus démunis. Sur les bases d’un récit factuel, l’ouvrage de l’historien et économiste Ludovic Frobert, « Des Républicains, ou le roman vrai des Raspail », suppose les commentaires d’un narrateur qui n’est autre que le fils aîné de la fratrie, Benjamin (1823-1899), artiste peintre de son état. Le récit romancé projette tout aussi librement les interventions de l’épouse et mère, Henriette-Adélaïde Troussot, de leur fille Marie-Apolline (1836-1876) et des trois frères de Benjamin - un cinquième étant mort en bas âge : Camille (1827-1893), médecin, Émile (1831-1887), ingénieur chimiste, et Xavier (1840-1926), médecin amateur d’ornithologie. Les cinq enfants ont assisté continûment leur père dans son engagement républicain dans la maison familiale d’Arcueil et souvent même à la tribune de l’assemblée.
Le récit commence au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, le 17 décembre 1876, où ont lieu les obsèques de Marie-Apolline, morte de la tuberculose. Quelques mois plus tôt, F.-V. Raspail, âgé de 82 ans, a inauguré la première session de la nouvelle Chambre des députés en sa qualité de doyen. Sous la monarchie de Juillet, le quarante-huitard grandiloquent et inflexible défend avec pugnacité les principes républicains qui lui valent d’être poursuivi, condamné, emprisonné plusieurs fois, et exilé en Belgique. Ancien séminariste (Avignon, 1810-1812) venu à Paris en 1816 pour étudier le droit et les sciences naturelles, il a engagé ce combat en 1821 à la Charbonnerie, société secrète préparant le renversement de la tyrannie, et il le prolonge avec la même ténacité en prenant part à la révolution de 1830. Candidat socialiste à la présidence de la République contre Louis Napoléon Bonaparte en décembre 1848, il n’obtient qu’un peu plus de 36 000 suffrages. L’arène politique ne se limite pas à l’enceinte parlementaire : les tribulations des révolutionnaires fomentent les grands meetings de campagne du printemps 1869 et les protestations des militants républicains et ouvriers contre le régime à Marseille et surtout à Lyon où F.-V. Raspail est considéré comme un tribun remarquablement doué. C’est ce socialiste sans système a priori qui demande le premier l’arbitrage entre patrons et ouvriers et l’impôt progressif sur les fortunes ; c’est lui qui dénonce le sort réservé aux prisonniers et les conditions du travail industriel ; c’est encore lui qui défend les filles-mères et les enfants naturels et abandonnés. Ironie du sort : opposé à la lutte des classes, il sera finalement repoussé par la bourgeoisie et les… socialistes ! À partir de 1824, F.-V. Raspail étudie la médecine et publie, en 1830, un « Essai de chimie organique » qui fera date. Suivront d’autres ouvrages de référence : « Cours élémentaire d’agriculture et d’économie rurale » (1831), « Nouveau Système de physiologie végétale » (1837), « Histoire naturelle de la santé et de la maladie chez les végétaux et les animaux en général et en particulier chez l’homme », « Le Médecin des familles », « La Pharmacie portative » (1843), « Le Manuel annuaire de la santé » (1845) et « La Lunette du donjon de Vincennes, almanach démocratique et socialiste de l’Ami du peuple pour 1849 » (1848). Il exerce gratuitement la médecine « au bénéfice des travailleurs qui ne bénéficient d’aucune protection sociale à une époque où la maladie les privait du revenu nécessaire à leur survie » (Pierre Bezbakh, maître de conférences à Paris-Dauphine). Parmi ses très nombreux ouvrages et revues (il fonda les journaux Le Réformateur en 1834 et L’Ami du peuple en 1848), nous sommes sidérés par l’étendue de ses compétences et de ses connaissances dans des domaines aussi variés que la géologie, la paléontologie, la botanique, la physiologie, la chimie, la médecine (et la médecine légale), l’histoire, la théologie, les mathématiques, l’astronomie, la météorologie et l’agriculture.
|
F.-V. Raspail, lexicographe de la langue verte
« En 1834, François-Vincent Raspail reçoit la visite de son ami René-Théophile Gillard de Kersausie (1798-1874), qui vient lui proposer 100 000 francs prélevés sur sa fortune personnelle pour fonder un journal, qui prend le nom de "Le Réformateur" et dont le premier numéro sort de presse le 8 octobre 1834, l’audience étant immédiatement très large. "Le Réformateur" publie les lettres sur les prisons où Raspail demande une réforme parce qu’il connaît bien la question ayant été jusqu’à apprendre l’argot avec les détenus de droit commun, ce qui lui permet de composer un petit lexique de la langue verte. Le journal vécut deux ans d’une existence très agitée. »
(Henri Dubled, "François-Vincent Raspail et sa famille - Manuscrits, lettres, tableaux, objets divers", catalogue d’exposition, musée Comtadin, Carpentras, juin-octobre 1978)
|
- Des Républicains ou le roman vrai des Raspail, par Ludovic Frobert, directeur de recherche au CNRS (Triangle et Maison française d’Oxford), éditions Libel, Lyon, 288 pages, 2019.
Lectures complémentaires :
- François-Vincent Raspail (1794-1878) et sa famille - Manuscrits, lettres, tableaux, objets divers, catalogue d’exposition, présentation par Henri Dubled, conservateur de la Bibliothèque Inguimbertine, des archives et des musées de Carpentras, et Jean Bernhardt, chargé de recherches au Centre national de la recherche scientifique, musée Comtadin, Carpentras, juin-octobre 1978 ;
- François-Vincent Raspail, médecin des pauvres, par Pierre Bezbakh, maître de conférences à Paris Dauphine, quotidien Le Monde, Économie/Expertises, mercredi 15 avril 2009.
Portrait
François Dubreil : une autre histoire des reliques de la Passion
Pour s’approprier la Sainte Couronne d’épines de Jésus Christ, le roi Saint-Louis dépense une fortune, cent trente-cinq mille livres tournois, c’est-à-dire l’équivalent d’une année du budget du royaume de France ! De surcroît, il fait édifier sur l’île de la Cité, à côté de son palais, la Sainte-Chapelle, un sanctuaire gothique apte à conserver le plus fameux des reliquaires. Vénérée à Jérusalem dès les premiers temps du christianisme, la sainte relique est vouée à la destruction lorsque les révolutionnaires, en 1793, 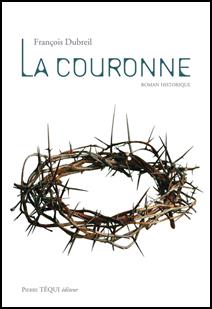 commencent à pourchasser les catholiques et à piller tout insigne du culte associé, selon eux, à des rituels fanatiques. Deux moines bénédictins audacieux, Hugues Renou et Lancellin, parviennent à subtiliser la couronne christique dans la basilique de Saint-Denis où elle a été remisée. Dom Lancellin est tué durant une traque infernale ; grièvement blessé, son partenaire est secouru par les rebelles vendéens à qui il remet la précieuse relique de la Passion. Deux officiers vendéens, Jean Brouard et Arnaud Beauvillain de Montfort, deviennent, avec Dom Renou, les dépositaires de la couronne sainte. Futur ministre de la Police sous le Directoire, Joseph Fouché qui se révèle un des plus féroces agents de la déchristianisation, lance ses enquêteurs à la poursuite du trio, en France, en Angleterre, en Prusse et en Russie. En vain : à la Restauration, la couronne rallie l’abri secret de l’église angevine de Béhuard, bâtie au XVe siècle sur un rocher surplombant une île au milieu de la Loire, non loin de Rochefort. Constellée de multiples rebondissements, l’affaire, remarquablement contée par l’historien François Dubreil (né en 1973) dans « La Couronne », se prolonge jusqu’aux deux guerres mondiales sous la garde d’un tandem formé par les descendants de Jean Brouard et d’Arnaud de Montfort. C’est cette odyssée de deux siècles qui est relatée en 1997 par Gabriel Brouard à Karol Wojtyla alias Jean-Paul II. À Paris pour les Journées mondiales de la jeunesse, le pape de l’Église catholique confesse à l’ancien pilote de chasse de la guerre 1939-1945 avoir été mêlé à cette extraordinaire aventure ! commencent à pourchasser les catholiques et à piller tout insigne du culte associé, selon eux, à des rituels fanatiques. Deux moines bénédictins audacieux, Hugues Renou et Lancellin, parviennent à subtiliser la couronne christique dans la basilique de Saint-Denis où elle a été remisée. Dom Lancellin est tué durant une traque infernale ; grièvement blessé, son partenaire est secouru par les rebelles vendéens à qui il remet la précieuse relique de la Passion. Deux officiers vendéens, Jean Brouard et Arnaud Beauvillain de Montfort, deviennent, avec Dom Renou, les dépositaires de la couronne sainte. Futur ministre de la Police sous le Directoire, Joseph Fouché qui se révèle un des plus féroces agents de la déchristianisation, lance ses enquêteurs à la poursuite du trio, en France, en Angleterre, en Prusse et en Russie. En vain : à la Restauration, la couronne rallie l’abri secret de l’église angevine de Béhuard, bâtie au XVe siècle sur un rocher surplombant une île au milieu de la Loire, non loin de Rochefort. Constellée de multiples rebondissements, l’affaire, remarquablement contée par l’historien François Dubreil (né en 1973) dans « La Couronne », se prolonge jusqu’aux deux guerres mondiales sous la garde d’un tandem formé par les descendants de Jean Brouard et d’Arnaud de Montfort. C’est cette odyssée de deux siècles qui est relatée en 1997 par Gabriel Brouard à Karol Wojtyla alias Jean-Paul II. À Paris pour les Journées mondiales de la jeunesse, le pape de l’Église catholique confesse à l’ancien pilote de chasse de la guerre 1939-1945 avoir été mêlé à cette extraordinaire aventure !
Égrenant des situations les plus extraordinaires les unes que les autres, mettant en scène des acteurs historiques et des personnages fictifs, 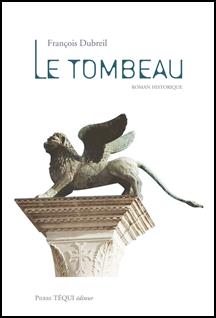 à l’exemple du premier volet de la trilogie, « Le Tombeau » narre les tribulations de Paul Brouard (enseignant à l’École pratique des hautes études de Paris) dans la quête des restes de saint Marc après son martyr à Bucoles, petit port de pêche proche d’Alexandrie, en Égypte, vers 68-75. En juin 2017, Jorge Mario Bergoglio - le pape François - sollicite le gardien de la couronne d’épines du Christ afin de retracer le parcours desdites reliques, de les récupérer (elles ont été volées le mois précédent à Venise) et de recouvrer le tombeau de l’évangéliste. On sait qu’au neuvième siècle des marchands vénitiens avaient dérobé les reliques sacrées dans la chapelle de Bucoles, transformée en une cathédrale au IVe s. au bénéfice des patriarches d’Alexandrie, successeurs de Marc. Le doge de Venise, Giustiniano Participazio, fit construire la basilique Saint-Marc pour y abriter le corps du prédicateur. Prêtres issus de la lignée d’Aaron (frère de Moïse), crues du Nil prenant leur source dans les pleurs versés par Isis sur le corps d’Osiris, intervention de l’organisation internationale de police criminelle Interpol, implication délictueuse de la confrérie des gardiens du corps, recherches sous-marines : la réalité des faits historiques et la part fictive du récit partagent les mêmes ressorts rocambolesques tout en se développant sur la trame de péripéties trop véridiquement invraisemblables. Le lecteur sera donc attentif à l’enseignement de l’historien et à l’invention du romancier en s’efforçant d’écarter l’ivraie du bon grain… Événements, époques et personnages s’entrechoquent dans cette saga épique qui prend fin à la basilique Saint-Marc où la dépouille retrouvée d’Alexandre le Grand est replacée dans son tombeau sous le maître autel, à côté de l’urne funéraire de l’évangéliste. En devenant le protecteur du corps d’Alexandre, conquérant de l’univers et disciple d’Aristote, Saint Marc a lié le royaume du Christ à l’héritage du monde grec. à l’exemple du premier volet de la trilogie, « Le Tombeau » narre les tribulations de Paul Brouard (enseignant à l’École pratique des hautes études de Paris) dans la quête des restes de saint Marc après son martyr à Bucoles, petit port de pêche proche d’Alexandrie, en Égypte, vers 68-75. En juin 2017, Jorge Mario Bergoglio - le pape François - sollicite le gardien de la couronne d’épines du Christ afin de retracer le parcours desdites reliques, de les récupérer (elles ont été volées le mois précédent à Venise) et de recouvrer le tombeau de l’évangéliste. On sait qu’au neuvième siècle des marchands vénitiens avaient dérobé les reliques sacrées dans la chapelle de Bucoles, transformée en une cathédrale au IVe s. au bénéfice des patriarches d’Alexandrie, successeurs de Marc. Le doge de Venise, Giustiniano Participazio, fit construire la basilique Saint-Marc pour y abriter le corps du prédicateur. Prêtres issus de la lignée d’Aaron (frère de Moïse), crues du Nil prenant leur source dans les pleurs versés par Isis sur le corps d’Osiris, intervention de l’organisation internationale de police criminelle Interpol, implication délictueuse de la confrérie des gardiens du corps, recherches sous-marines : la réalité des faits historiques et la part fictive du récit partagent les mêmes ressorts rocambolesques tout en se développant sur la trame de péripéties trop véridiquement invraisemblables. Le lecteur sera donc attentif à l’enseignement de l’historien et à l’invention du romancier en s’efforçant d’écarter l’ivraie du bon grain… Événements, époques et personnages s’entrechoquent dans cette saga épique qui prend fin à la basilique Saint-Marc où la dépouille retrouvée d’Alexandre le Grand est replacée dans son tombeau sous le maître autel, à côté de l’urne funéraire de l’évangéliste. En devenant le protecteur du corps d’Alexandre, conquérant de l’univers et disciple d’Aristote, Saint Marc a lié le royaume du Christ à l’héritage du monde grec.
Dernier terme de la trilogie, « Le Linceul » dispute de l’authenticité du saint Suaire, un drap de lin jauni de 4,42 mètres de long sur 1,13 mètre de large conservé depuis 1578 dans la cathédrale de Turin (Italie) que l’on dit avoir servi à ensevelir Jésus-Christ après sa crucifixion. Plus précisément, la nouvelle requête du souverain pontife auprès de Paul Brouard entend invalider la thèse d’un magnat australien des médias, Jonas Trust, qui considère le fameux linceul « comme le symbole d’une imposture multiséculaire ». De son siège londonien, ce dernier orchestre une formidable campagne internationale visant à discréditer les docteurs de la foi catholique à cet égard, recourant souvent à des moyens délictueux sinon criminels. Composée équitablement d’experts accrédités par le Vatican et de scientifiques désignés par le magnat australien, une commission paritaire est constituée en février 2019 afin d’établir le protocole d’une nouvelle et définitive datation, datation que des études au carbone 14 en 1988 ont fixée au Moyen Âge, semant le trouble parmi la communauté ecclésiale. L’émissaire et enquêteur papal revisite la chronologie des faits avérés depuis les premières mentions reconnues  du Suaire au Xe s. à l’église Sainte-Marie des Blachernes à Constantinople, au monastère de Daphni près d’Athènes au XIIIe s., puis en Champagne, au début du XIVe s., lorsque le pape Clément VII penche pour l’authenticité de l’étoffe sacrée acquise par Geoffroy de Charny, conseiller des rois Philippe VI et Jean II. La reconnaissance officielle de son culte par l’Église interviendra au XVIe s. après le passage de la relique aux mains de la Maison de Savoie. Les ostensions (présentations) du Suaire tombent en désuétude du XVIIe au XIXe s. « Jusqu’au coup de tonnerre de 1898, rappelle l’auteur angevin, lorsque le négatif de la première photographie réalisée par Secondo Pia [un photographe amateur d’Asti] lors du jubilé conjoint de la cathédrale de Turin et de la constitution sarde révèle l’image du corps [sur le linge] de façon beaucoup plus nette. » Dans ses pérégrinations, Paul Brouard reçoit l’aide précieuse de la comtesse Julia von Hohenwald, professeur d’histoire des religions à l’université Louis-et-Maximilien de Munich. La recherche des indices et le recueil des témoignages auxquels se livrent les deux enquêteurs sont semés d’embûches invraisemblables et de disparitions suspectes. Dans la narration, tout est vrai, et tout est faux. À l’exemple des deux premiers corpus, l’intrigue est truffée d’imprévus et de coups de théâtre : la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) se mêle de l’instruction du dossier et l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en avril 2019, est même attribuée à un des protagonistes ! Il reste une histoire palpitante, racontée avec une sûreté et une précision de détails où éclate l’érudition de l’historien et l’imagination créatrice du romancier. du Suaire au Xe s. à l’église Sainte-Marie des Blachernes à Constantinople, au monastère de Daphni près d’Athènes au XIIIe s., puis en Champagne, au début du XIVe s., lorsque le pape Clément VII penche pour l’authenticité de l’étoffe sacrée acquise par Geoffroy de Charny, conseiller des rois Philippe VI et Jean II. La reconnaissance officielle de son culte par l’Église interviendra au XVIe s. après le passage de la relique aux mains de la Maison de Savoie. Les ostensions (présentations) du Suaire tombent en désuétude du XVIIe au XIXe s. « Jusqu’au coup de tonnerre de 1898, rappelle l’auteur angevin, lorsque le négatif de la première photographie réalisée par Secondo Pia [un photographe amateur d’Asti] lors du jubilé conjoint de la cathédrale de Turin et de la constitution sarde révèle l’image du corps [sur le linge] de façon beaucoup plus nette. » Dans ses pérégrinations, Paul Brouard reçoit l’aide précieuse de la comtesse Julia von Hohenwald, professeur d’histoire des religions à l’université Louis-et-Maximilien de Munich. La recherche des indices et le recueil des témoignages auxquels se livrent les deux enquêteurs sont semés d’embûches invraisemblables et de disparitions suspectes. Dans la narration, tout est vrai, et tout est faux. À l’exemple des deux premiers corpus, l’intrigue est truffée d’imprévus et de coups de théâtre : la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) se mêle de l’instruction du dossier et l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en avril 2019, est même attribuée à un des protagonistes ! Il reste une histoire palpitante, racontée avec une sûreté et une précision de détails où éclate l’érudition de l’historien et l’imagination créatrice du romancier.
- La Couronne, par François Dubreil, Pierre Téqui éditeur, 592 pages, 2018 ;
- Le Tombeau, par F. Dubreil, Pierre Téqui éditeur, 264 pages, 2019 ;
- Le Linceul, par F. Dubreil, Pierre Téqui éditeur, 410 pages, 2020.
Varia : le roman des momies
« La médecine a emprunté à la science arabe le mot de momie (mūmiya), qui viendrait du persan mūm, cire ou bitume, décrivant d’abord les substances utilisées par les Anciens pour conserver leurs morts. On tirait des momies, réduites en poudre, un remède appelé mummia, dont les vertus thérapeutiques étaient très populaires depuis les Croisades ; on dit d’ailleurs que le roi François Ier avait toujours un sachet de cette poudre sur lui. Les momies étant rares, on vit les faux médicaments se multiplier, et entretenir la confusion entre asphalte et véritable chair momifiée. […]
« Les plus anciennes momies traitées intentionnellement, il y a près de 7 000 ans, sont celles du peuple Chinchorro, une culture précolombienne située dans l’actuel désert d’Atacama au nord du Chili. […]
« Si l’Égypte ne détient donc pas le palmarès de l’ancienneté pour la momification, cette technique y est attestée beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait, comme l’a récemment montré l’égyptologue australienne Jana Jones, en mettant en évidence la présence de résines et de baumes (d’où le terme d’embaumement) aux propriétés antiseptiques sur des linges funéraires du Néolithique final (notamment au Badarien, vers 4 200 ans avant notre ère) et sur un corps d’époque chalcolithique (époque prédynastique Nagada, vers 3 500 ans avant notre ère) conservé au musée de Turin. Le site également prédynastique de Nekhen (ou Hiérakonpolis) a aussi révélé la présence de résines et de baumes. […]
 « Si les vestiges en ont rarement conservé la trace, hommes et femmes étaient souvent maquillées lors de leur momification ; de même, ils étaient souvent parés, comme en témoigne la momie d’une chanteuse prêtresse de la région de Thèbes, décédée entre 35 et 49 ans. Son abdomen ne contient que quelques amulettes, mais plusieurs petites boules de métal (probablement en or, réputé imputrescible) étaient disséminées sur son corps. Sa tenue funéraire était sans doute composée d’habits somptueux et de parures précieuses, et la jeune femme était probablement maquillée et enduite d’huiles et de parfums. Pour souligner le contour de ses yeux et les faire paraître plus grands, cette chanteuse utilisait du khôl (fabriqué à partir de galène ou de vert malachite), un fard aux propriétés antibactériennes qui repoussait le mauvais œil. Elle ornait peut-être son corps de simples parures en os ou de colliers multicolores extravagants. Les bijoux servaient à chasser les esprits malins. Faisant partie de l’élite, les chanteurs et prêtres portaient des perruques et gardaient leurs cheveux très courts, voire rasés, la pilosité corporelle étant considérée comme impure. » « Si les vestiges en ont rarement conservé la trace, hommes et femmes étaient souvent maquillées lors de leur momification ; de même, ils étaient souvent parés, comme en témoigne la momie d’une chanteuse prêtresse de la région de Thèbes, décédée entre 35 et 49 ans. Son abdomen ne contient que quelques amulettes, mais plusieurs petites boules de métal (probablement en or, réputé imputrescible) étaient disséminées sur son corps. Sa tenue funéraire était sans doute composée d’habits somptueux et de parures précieuses, et la jeune femme était probablement maquillée et enduite d’huiles et de parfums. Pour souligner le contour de ses yeux et les faire paraître plus grands, cette chanteuse utilisait du khôl (fabriqué à partir de galène ou de vert malachite), un fard aux propriétés antibactériennes qui repoussait le mauvais œil. Elle ornait peut-être son corps de simples parures en os ou de colliers multicolores extravagants. Les bijoux servaient à chasser les esprits malins. Faisant partie de l’élite, les chanteurs et prêtres portaient des perruques et gardaient leurs cheveux très courts, voire rasés, la pilosité corporelle étant considérée comme impure. »
Extraits d’un dossier intitulé « Le roman des momies », par Alain Froment, du musée de l’Homme, avec la collaboration d’Éléonore Fournié, rédactrice en chef adjointe (Des momies parées et maquillées), dossier issu de la revue « Archéologia », n° 581, novembre 2019, éditions Faton, Dijon.
Carnet : rendons à Scylax…
Le genre - la biographie - n’a rien de neuf, et si le mot n’apparaît qu’au début du XVIIIe siècle, repris d’un mot grec attesté tardivement (vers 500), le récit d’une vie, comme le fait de l’écrire, remonte à l’Antiquité. À l’obscur navigateur carien Scylax, auteur d’une vie du tyran Héracléidès, rédigée en grec au VIe siècle avant notre ère, semble-t-il. Sans doute est-il issu de l’épigraphie funéraire, de l’éloge funèbre ou du goût dynastique des puissants pour célébrer, détailler et recomposer leur généalogie.
(Samedi 21 novembre 2020)
Dis-moi qui je suis !
« Lorsqu’on me demande quelle est ma profession, écrit Pierre Centlivres (Mont-la-Ville, Suisse, 1933) dans l’ouvrage "Chroniques afghanes 1965-1993)", je traduis "ethnologie" par le mot persan bashararshinasi, connaissance de l’être humain ; il arrive alors que mon interlocuteur me rétorque : "Eh bien ! dis-moi qui je suis !" Bien entendu je patauge comme un étudiant collé à l’oral. »
La chasse aux bicyclettes
Les étudiants en théologie ont interdit les femmes d’éducation et font la chasse aux bicyclettes de peur que leurs rayons ne se transforment en antennes diaboliques.
(Mercredi 25 novembre 2020)
Hommage aux traducteurs
Les traducteurs ne devraient pas disparaître derrière leurs traductions comme de timides violettes.
(Jeudi 26 novembre 2020)
L’art de Francis Bacon
« L’art de Francis Bacon [peintre britannique, 1909-1992], totalement amoral, n’est chargé d’aucun message et ne prétend ni commenter les malheurs du temps, ni refléter la nature intime des choses : que l’image sortie de sa tête et de ses mains affirme énergiquement sa présence, un point c’est tout. » (Michel Leiris, Bacon le hors-la-loi).
(Mercredi 16 décembre 2020)
Le duende du flamenco et de Garcia Lorca
« Tout ce qui a des sonorités noires a du duende » écrit Michel Dieuzaide citant Garcia Lorca dans un livre de photographies noires, très noires, destiné à ceux que font vibrer les rythmes complexes frappés par les gitans sur le sol de certaines bodegas andalouses pour accompagner un chant aux sonorités gutturales et des danses où le poignet se brise et le corps se cabre cependant que le visage exprime dans la violence de ses expressions la tension d’un perpétuel face à face avec la mort, seule raison d’être de la corrida et du flamenco.
(Jeudi 17 décembre 2020)
|
Billet d’humeur
Métro, Boulot, Dodo
Pierre Béarn, de son vrai nom Louis-Gabriel Besnard (Bucarest, 15 juin 1902-Paris, 27 octobre 2004), invente l’expression « Métro-boulot-dodo » en 1968 à partir d’un poème de son recueil « Couleurs d’usine » paru en 1951 chez l’éditeur Pierre Seghers. Poète, romancier et fabuliste, il a été timonier sur le cuirassé Jean-Bart, sténodactylo, mécanicien des taxis de la Marne, résistant du réseau de Brétigny-sur-Orge, secrétaire de Curnonsky (journaliste et écrivain en passe d’être élu « prince des gastronomes »), bouquiniste au Quartier latin (à l’enseigne du Zodiaque), journaliste radiophonique (à Paris-Inter), critique gastronomique (au quotidien Paris-Soir) et revuiste (créateur de La Passerelle). Le poète Paul Fort (1872-1960), les écrivains Pierre Mac Orlan (1882-1970) et Pierre Véry (1900-1960) comptent parmi ses plus chers amis. De parents champenois, son père est chef cuisinier du Premier ministre roumain, Alexandru Marghiloman, sous le règne de Carol Ier. Revenu en France, le fils passe son enfance d’avant 1914 à Paris. Ainsi, dès l’âge de 9 ans, il se met à écrire en argot, sa langue « naturelle » apprise dans les rues et parmi les clients du restaurant de son père. À 14 ans, il devient ouvrier mécanicien afin d’aider sa mère financièrement, son père ayant mis fin à ses jours en 1915 à l’âge de 51 ans. Sa vie d’ouvrier lui a inspiré le poème « Couleurs d’usine » dont une strophe décrit la monotonie quotidienne du travail en usine : « Au déboulé garçon pointe ton numéro/Pour gagner ainsi le salaire/D’un énorme jour utilitaire/Métro, boulot, bistrot, mégots, dodo, zéro. » Tiré à 2 000 exemplaires au théâtre de l’Odéon à la mi-mai 1968, le texte est distribué à la foule des étudiants qui occupent la place du théâtre parisien dans le 6e arrondissement. Quelques meneurs d’opinion expurgent le dernier vers du poème de trois mots pouvant être mal interprétés : bistrot, mégots, zéro. Reste la trilogie qui va enrichir les graffiti peints sur les murs de Paris, résumant le cercle infernal propre à des millions de travailleurs : « Métro, boulot, dodo ». On rêve forcément d’une autre vie : c’est l’une des raisons de l’explosion sociale de Mai 68. Voilà comment l’expression est devenue un slogan fétiche de Mai-68.
|
Lecture critique
À La Couronne, une roche raconte le bâti marseillais
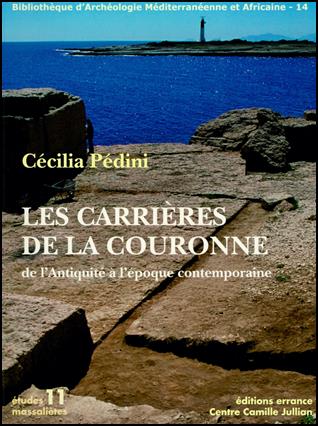 L’exploitation des carrières de La Couronne et de Carro, hameaux de Martigues (Bouches-du-Rhône) situés sur la bande côtière qui fait face à Marseille, s’étale sur deux millénaires, de l’Antiquité grecque au XIXe siècle. L’appellation de ces carrières se réfère à la topographie des lieux : Verdon 1, Verdon 2 et Verdon 3, Baou Tailla, Pointe de Carro, Couronne-Vieille, la Beaumaderie, Sainte-Croix, la Pinède, le Sémaphore, les Pignons d’olive, Notre-Dame, fontaine Saint-Jean, les Auffans, les Arqueirons, Arnette. La plus ancienne est située à la pointe de l’Arquet où des dalles plates (15-20 cm x 40-50 cm et 50-70 cm) témoignent d’une extraction pratiquée au Ve s. av. J.-C. ! Calcaire du miocène (étage burdigalien, entre 15,8 et 20,3 millions d’années), cette roche sédimentaire demi-ferme, à grain fin, parfois grossier est facile à extraire et à mettre en œuvre ; elle peut contenir de nombreuses coquilles, parfois entières (des huîtres notamment) et, si elle est le plus souvent de couleur rose (en raison de la quantité d’oxydes métalliques qu’elle contient), elle présente des variations de colorations, jaune, orangée, beige ou grise, selon les dix-sept carrières recensées à ce jour et les gisements mis au jour par les archéologues et les géologues. L’exploitation des carrières de La Couronne et de Carro, hameaux de Martigues (Bouches-du-Rhône) situés sur la bande côtière qui fait face à Marseille, s’étale sur deux millénaires, de l’Antiquité grecque au XIXe siècle. L’appellation de ces carrières se réfère à la topographie des lieux : Verdon 1, Verdon 2 et Verdon 3, Baou Tailla, Pointe de Carro, Couronne-Vieille, la Beaumaderie, Sainte-Croix, la Pinède, le Sémaphore, les Pignons d’olive, Notre-Dame, fontaine Saint-Jean, les Auffans, les Arqueirons, Arnette. La plus ancienne est située à la pointe de l’Arquet où des dalles plates (15-20 cm x 40-50 cm et 50-70 cm) témoignent d’une extraction pratiquée au Ve s. av. J.-C. ! Calcaire du miocène (étage burdigalien, entre 15,8 et 20,3 millions d’années), cette roche sédimentaire demi-ferme, à grain fin, parfois grossier est facile à extraire et à mettre en œuvre ; elle peut contenir de nombreuses coquilles, parfois entières (des huîtres notamment) et, si elle est le plus souvent de couleur rose (en raison de la quantité d’oxydes métalliques qu’elle contient), elle présente des variations de colorations, jaune, orangée, beige ou grise, selon les dix-sept carrières recensées à ce jour et les gisements mis au jour par les archéologues et les géologues.
« Le matériau affleure en bancs massifs, explique Cécilia Pédini, archéologue du bâti qui lui a consacré une monographie quasiment exhaustive, depuis le fort de Bouc jusqu’à La Beaumaderie, mais aussi dans l’anse de Sainte-Croix, à Carry-le-Rouet et plus au nord dans les terres comme à Saint-Julien-les-Martigues. Néanmoins, l’appellation calcaire de La Couronne est utilisée pour désigner les matériaux extraits essentiellement des carrières des deux villages côtiers de La Couronne et de Carro. » Le calcaire de La Couronne a été très largement utilisé durant 2 200 ans en raison des nombreux usages qu’il autorise, à l’exception toutefois de la sculpture. Il se révèle de surcroît d’un grand intérêt pour l’étude archéologique et historique du bâti marseillais. « Ce matériau est utilisé, presque exclusivement, ou du moins très majoritairement, observe C. Pédini dans l’ouvrage "Les Carrières de La Couronne de l’Antiquité à l’époque contemporaine", pour la construction monumentale publique depuis l’Antiquité grecque, comme c’est le cas du rempart hellénistique ou des caves de Saint-Sauveur, mais aussi à l’époque romaine (thermes, gradins du théâtre, quais du port). » La pierre extraite à La Couronne apparaît dans les premiers édifices chrétiens de Marseille : Vieille-Major, Saint-Victor et Malaval. Elle est aussi utilisée pour la conception du mobilier funéraire : façonnés au Ve siècle, 160 sarcophages en calcaire de La Couronne ont été inventoriés à Marseille et ses alentours (Roquevaire, La Ciotat, Saint-Jean de Garguier…). Le même matériau est à nouveau employé à partir du XIIe s. dans la construction religieuse (Vieille-Major et Saint-Laurent) et militaire (Tour du Lauret, Tour du roi René, Château d’If). Cet usage se poursuit à l’époque moderne (forts, Hôtel de Ville, Vieille-Charité, etc.), mais s’étend également au domaine privé (Hôtel de Cabre, Maison Diamantée). Il se manifeste dès le début du XVIe s. hors des limites de la cité phocéenne, lors de la construction de l’église de La Cadière d’Azur, dans le Var, en 1508. Le calcaire de La Couronne est utilisé aux XVIe et XVIIe s. dans la région toulonnaise : Tour royale, corderie de l’arsenal de Toulon, fort de l’Éguillette et église Notre Dame du Bon Voyage à La Seyne-sur-Mer. Son emploi décline cependant au XIXe s. en raison de la concurrence d’autres pierres de la région (Cassis, Calissanne, Fontvieille, Saint-Rémy, Beaucaire, etc.). Plus économique et plus sûr, le transport maritime, par cabotage suivant le littoral méditerranéen, est préféré au charroi à l’intérieur des terres. Sur une période de 1 000 ans d’exportations, les navigateurs n’ont déploré que la perte de seulement quatre navires lapidaires sur une côte où les épaves sont pourtant assez nombreuses (Carry-le-Rouet, les Laurons à Martigues, le Frioul à Marseille). L’activité intensive des carrières a des conséquences directes sur la population des agglomérations de La Couronne et de Carro. De nombreux carriers s’y sont installés à partir des années 1660 pour les besoins des grands chantiers de Louis XIV et beaucoup se sont sédentarisés. Rassemblés au sein de la confrérie des traceurs de pierre de La Couronne, ils exercent une seconde, voire une troisième activité au cours de leur vie : ils sont souvent cultivateurs, parfois pêcheurs et deviennent douaniers avec l’implantation des douanes à La Couronne. Pendant l’Antiquité, les carrières seraient la propriété de Massalia. Du début du Xe s. au XVIIe s., le territoire de La Couronne appartient à l’abbaye de Montmajour. Au XIXe s., la commune de Martigues est propriétaire de la plupart des carrières, les autres demeurant des concessions privées. Vers 1912-1915, leur exploitation cesse parce qu’elles ne sont plus du tout rentables.
Selon Cécilia Pédini, de nouvelles prospections sont souhaitables afin de compléter l’inventaire des exploitations lapidaires de La Couronne-Carro, aussi bien au nombre des carrières littorales que des exploitations de plaine. Transformées en pinèdes, les carrières terrestres ont été protégées par la végétation qui en a recouvert les traces. Le riche passé des carrières de Martigues n’a pas livré tous ses secrets.

L’église de La Couronne dont le clocher édifié en 1859 est fait de calcaire rose a reçu un bossage de type « rustique », c’est-à-dire qu’il présente un aspect brut. On trouve peu de bâtis en calcaire de La Couronne à Martigues, en raison de la présence de carrières de pierre dans la ville dont les qualités sont comparables (pierre de la Baume).
Photo J. Cros © Collection Michel Lopez
- Les Carrières de La Couronne de l’Antiquité à l’époque contemporaine, par Cécilia Pédini, éditions Errance/Centre Camille Jullian, Bibliothèque d’archéologie méditerranéenne et africaine - 14, Études massaliètes 11, 320 pages, 2013.
|
Strabon parlait déjà des carrières…
Selon Cécilia Pédini, le géographe grec Strabon évoque entre 15/10 av. J.-C. et 24 ap. J.-C. l’existence des exploitations martégales, lorsqu’il décrit la bordure méditerranéenne. « La direction de la côte vers l’ouest tend au contraire à devenir plus marquée ; mais un peu plus loin que Massalia, à 100 stades environ de la ville et à partir d’un grand promontoire qu’avoisinent des carrières de pierre, elle commence à décrire une courbe pour former avec l’Aphrodisium, extrémité du mont Pyréné, le golfe Galatique ou Massaliotique » (Strabon, Géographie (tome IV, livre VI), traduction de François Lasserre, collection des universités de France, publiée sous le patronage de l’association Guillaume Budé, Paris, 1966).
|
Portrait
Les carnets illustrés de Paul Janin durant la Grande Guerre
L’histoire militaire a longtemps pâti de sa réputation d’être à l’Histoire ce que la musique militaire est à la musique : pompeuse, excessive et parfois partisane, vouée à l’exaltation du sentiment national et au culte des héros. Certes, en héritière des historiographes officiels et des journaux de chefs de guerre, elle s’est souvent rangée à la fois aux formes obligées d’un récit événementiel et héroïque et aux attentes de l’institution militaire elle-même, qui suscitait de multiples monographies de régiments ou biographies de généraux et organisait ses propres services historiques. Mais, depuis plusieurs années déjà, d’importants ouvrages  sont venus corriger cette réputation. Aussi l’ouvrage qui rassemble les carnets, les dessins et les peintures de guerre de Paul Janin (Cluny, 4 mars 1890-Lyon 19 décembre 1973) occupe-t-il une place particulière parce qu’il ne ressemble à aucune livraison du genre. Deux raisons soutiennent et confirment cette assertion. D’abord la probité du prosateur, ensuite le talent de l’artiste : les mots et les dessins dénoncent avec panache et crudité une guerre dont la grandeur se mesure à la violence du conflit et à la multitude des victimes et des drames qu’il a causés. sont venus corriger cette réputation. Aussi l’ouvrage qui rassemble les carnets, les dessins et les peintures de guerre de Paul Janin (Cluny, 4 mars 1890-Lyon 19 décembre 1973) occupe-t-il une place particulière parce qu’il ne ressemble à aucune livraison du genre. Deux raisons soutiennent et confirment cette assertion. D’abord la probité du prosateur, ensuite le talent de l’artiste : les mots et les dessins dénoncent avec panache et crudité une guerre dont la grandeur se mesure à la violence du conflit et à la multitude des victimes et des drames qu’il a causés.
Exempté du service militaire à la déclaration de guerre en raison d’une santé défaillante, il est cependant appelé, en février 1915, au 334e régiment d’infanterie (R.I.) avant d’être affecté en juillet à l’infanterie de première ligne au 152e R.I. Le mois suivant, il reçoit son baptême du feu au Hartmannswillerkopf, en pleine forêt de sapins du massif vosgien, puis combattra en Alsace, en Champagne (à Verdun) et dans la Somme. Soldat de 1re classe, agent de liaison, puis sergent-pionnier, il est profondément marqué par les combats qu’il compare, à Sailly-Saillisel, dans la Somme, à une éruption volcanique. Remarqué par sa hiérarchie, il est invité à la fin de la guerre par l’état-major du 7e corps d’armée, en Belgique puis à Besançon, pour y illustrer des diplômes de citations. Autodidacte - son père ayant refusé qu’il intègre, adolescent, l’école des Beaux-Arts, l’homme révèle très tôt de rares aptitudes dans les arts du dessin, la peinture de chevalet et la technique de la miniature sur ivoire.
Dessins au trait, aquarelles, gravures ont été réalisés durant le Première Guerre mondiale ou après le conflit (il dessinait encore sur le sujet deux mois avant sa mort !), des œuvres produites sur des carnets de différentes dimensions (la majorité au format 10 x 15 cm). Superbes mines de plomb représentant les soldats Danon, Muller et Payronard (1915), dramatiques aquarelles et mines de plomb intitulées Retour d’attaque et Des hommes sortent de l’enfer (1970). Ces carnets le suivaient partout sur le front et il les expédiait à sa famille une fois terminés. « Il ne s’agit pas ici de faire œuvre historique, littéraire encore moins, explique-t-il. Non plus un "Journal de marche", ni des mémoires. Mais d’essayer d’approfondir ses propres pensées sur les événements vécus qu’il faut pouvoir décrire sans vains détours, sans palabres, avec franchise. »
Préfacier de l’ouvrage, le colonel François-Régis Dabas, considère avec beaucoup de clairvoyance que « Paul Janin, placé dans des circonstances extraordinaires au cours de sa vie de soldat, fut un témoin direct de ce que l’homme a de meilleur, mais aussi de pire, de ses hauteurs et de ses abîmes, de ses fulgurances et de ses folies ». Le lecteur pensera à un des récits de Jean Giono lorsque le diariste assure : « Rien ne peut lier des hommes comme les épreuves communes et cela seul suffirait à expliquer la cohésion de ce que 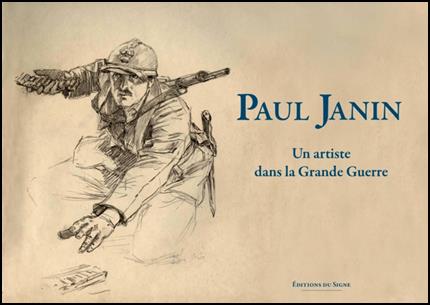 l’on peut appeler le "troupeau" et qui s’étend parfois à son "berger". Les "bergers" ne vivaient alors entre eux qu’à la popote, hors du danger et cela est une autre histoire, créatrice de solidarité parfois mais aussi de bagarres silencieuses ou violentes ». Il manifeste la même implacable dureté quand il avoue : « Dans certaines circonstances, le désir de tuer était violent et facile à accomplir… Il n’a pas dû l’être aussi souvent qu’on le dit. Mais qu’il ait été fréquemment mûri d’avance, oui, je le crois. Fort heureusement, dans le danger commun, où il était facile à réaliser impunément, la pitié reprend ses droits, chez l’homme de troupe au moins… Beaucoup de choses seraient ici à approfondir. Le révolver de l’officier a plus souvent menacé les subordonnées que les ennemis ». l’on peut appeler le "troupeau" et qui s’étend parfois à son "berger". Les "bergers" ne vivaient alors entre eux qu’à la popote, hors du danger et cela est une autre histoire, créatrice de solidarité parfois mais aussi de bagarres silencieuses ou violentes ». Il manifeste la même implacable dureté quand il avoue : « Dans certaines circonstances, le désir de tuer était violent et facile à accomplir… Il n’a pas dû l’être aussi souvent qu’on le dit. Mais qu’il ait été fréquemment mûri d’avance, oui, je le crois. Fort heureusement, dans le danger commun, où il était facile à réaliser impunément, la pitié reprend ses droits, chez l’homme de troupe au moins… Beaucoup de choses seraient ici à approfondir. Le révolver de l’officier a plus souvent menacé les subordonnées que les ennemis ».
Au gré de ses carnets, la franchise acerbe du grand témoin qu’il fut est heureusement tempérée par les élans de sympathie et d’affection qui le portent vers des combattants plus humains que les autres.
Paul Janin © Photo X. droits réservés
- Paul Janin - Un artiste dans la Grande Guerre, notes, réflexions, dessins et peintures de Paul Janin, préface du colonel François-Régis Dabas, commandant du 152e régiment d’infanterie de Colmar, éditions du Signe, 308 pages, 2017.
Varia : de la révolution des livres électroniques
« Les traducteurs resteront des figures centrales de l’industrie de la librairie. Leur rôle de médiateurs entre langues et cultures différentes a toujours été fondamental dans les diverses civilisations. Au point que souvent, et légitimement, les traducteurs furent vénérés comme des saints (l’Église arménienne, par exemple, a une fête des Saints Traducteurs). Même si nous devions tous un jour, comme c’est arrivé pour le latin dans l’Antiquité, parler et lire en anglais, le rôle des traducteurs, face à quatre mille ans d’histoire passée, serait de toute façon nécessaire (et, aussi bien, parce que les pays anglo-saxons continuent à être avares de traductions, et, dans la majeure partie des cas, peu attentifs à la fidélité à l’original). […]
« On verra paraître sur le devant de la scène une génération habituée à travailler avec des livres immatériels, et qui n’aura aucune nostalgie du papier, pour la simple raison qu’elle n’aura pas eu l’habitude de le manier. Déjà la génération prochaine étudiera presque exclusivement sur des supports informatiques. Pour les élèves, le gain économique sera grand, et la santé y gagnera aussi (on évitera aussi les scolioses dues aux sacs trop lourds). Les livres électroniques rendront enfin possible la lecture de tous les textes : car avec l’eBook (comme déjà sur l’écran d’un ordinateur), les caractères du livre peuvent s’agrandir ou se réduire comme on veut. […]
 « Le succès des livres électroniques aura des conséquences visibles jusque sur les étagères de nos maisons, où, depuis des années, ne figurent déjà plus de disques - avec un nombre toujours décroissant de cd - ni de vidéocassettes, désormais obsolètes. L’électronique videra mélancoliquement les maisons (et surtout les bibliothèques), mais en épargnant la cellulose, laissera de la place aux forêts (on vend aujourd’hui dans le monde environ 3 milliards de livres par an, ce qui implique indirectement l’abattage de9 316 770,1 arbres, si l’on considère la moyenne de 250 pages par livre). « Le succès des livres électroniques aura des conséquences visibles jusque sur les étagères de nos maisons, où, depuis des années, ne figurent déjà plus de disques - avec un nombre toujours décroissant de cd - ni de vidéocassettes, désormais obsolètes. L’électronique videra mélancoliquement les maisons (et surtout les bibliothèques), mais en épargnant la cellulose, laissera de la place aux forêts (on vend aujourd’hui dans le monde environ 3 milliards de livres par an, ce qui implique indirectement l’abattage de9 316 770,1 arbres, si l’on considère la moyenne de 250 pages par livre).
« Le défi auquel sont appelés tous ceux qui, à des titres divers, travaillent dans l’édition, est celui de la qualité et de la rigueur, pour éviter que les lecteurs ne soient entraînés dans un tourbillon chaotique de matériaux. La seule façon de sauver la culture est d’améliorer et d’affiner la qualité des contenus et des formes. Il faut produire des textes et des livres soumis à un souci rédactionnel scrupuleux, avec une grande attention à la langue (qui ne devra jamais tomber ni dans la négligence, ni dans la banalité), à la précision des notes et à l’exactitude des références bibliographiques, dans le cas où celles-ci sont prévues.
« Le vainqueur sera celui qui saura et voudra produire des livres électroniques fiables et de grande qualité éditoriale (au sens ancien du terme). En effet, les livres ayant disparu dans l’immatérialité du web, le risque est de voir se perdre l’autorité des textes, fruit d’une sélection fondée sur une évaluation esthétique ou scientifique. La toile est par nature "démocratique", mais tout ce qui s’y trouve n’a pas la même valeur. »
Extraits d’un texte de Francesco M. Cataluccio, « Quelle fin pour les livres ? », issu de la revue « Conférence », n° 34, printemps 2012, 496 pages, dans un dossier intitulé « Mesure et démesure : le droit, les livres, le numérique ».
|





