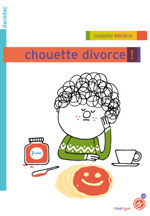Dans Je suis très sensible, le lecteur en sait plus que le personnage principal Grégoire qui est un être "décalé" par rapport à la réalité. En tant que lecteur, nous comprenons la situation mieux que lui qui est un peu "naïf". En quoi cette posture vous intéresse-t-elle dans l’écriture d’un roman ?
En fait, je ne l’ai pas fait exprès – mais je l’ai revendiqué ensuite, quand je m’en suis aperçue.
Le côté décalé de Grégoire m’a passionnée. Je pense que c’est la logique du personnage, et la logique du texte, qui m’ont amenée au fait que le lecteur en sache plus sur le personnage que le personnage lui-même. Cela arrive parfois, dans la vie, d’avoir l’impression de connaître quelque chose à propos de quelqu’un (ou d’en avoir la forte intuition, disons), alors que ça semble échapper à la personne concernée.
Cet aspect-là est peut-être inspiré par des expériences personnelles, mais ça n’est pas conscient au moment de l’écriture. Je crois qu’on écrit beaucoup plus avec son inconscient, son imaginaire, qu’avec son conscient. Ça nous échappe. Ça échappe au raisonnement, ça n’est pas calculé. Et c’est aussi ce qui fait le charme de l’écriture – en tout cas pour moi.
Dans votre roman Cette nuit-là vous évoquez la problématique d’une femme qui subit l’humiliation infligée par son mari et dans votre roman suivant Un couple ordinaire c’est l’inverse c’est le mari qui subit le pouvoir de sa femme. Comment sont nés ces deux romans ?
Un livre est né de l’autre. Après avoir publié Cette nuit-là, j’ai rencontré beaucoup de lecteurs, car j’ai été associée à la campagne d’Amnesty International contre la violence faite aux femmes.
Plusieurs hommes m’ont interpellée sur le fait que les hommes aussi vivaient des situations de violence (plus souvent psychologiques que physiques), qu’ils en souffraient beaucoup sans se sentir soutenus et compris. J’avais déjà constaté cela, en regardant autour de moi, en observant certains couples. Et l’idée est née. Pourquoi pas un personnage masculin malmené par sa compagne, subissant une violence verbale, psychologique ?
Il s’est passé du temps, des mois (et de l’observation en attendant), puis le personnage de Benjamin est né dans ma tête. Il a insisté, alors je l’ai écrit. Ensuite il m’a raconté son histoire, je l’ai écoutée.
Dans Cette nuit-là nous vivons l’introspection de la femme manipulée par son mari. Le point de vue est intéressant car elle analyse sa situation et son propre comportement. Pour vous la littérature est-elle un moyen de parler des problèmes de société ?
Au fond, je pense que la littérature est la façon le plus édifiante, la plus démonstrative, pour parler des tourments que l’être humain éprouve.
Un essai, une analyse, une thèse universitaire peuvent être très intelligents, très bien menés – je lis beaucoup d’essais, ça me nourrit aussi, j’ai besoin de ces lectures-là. Mais la littérature dit les choses autrement, de façon plus forte, plus intense. Le pouvoir de la fiction… Raconter ou écouter une histoire, c’est souvent plus fort qu’une analyse. Là je pense par exemple à Proust, nous faisant ressentir la jalousie à travers son narrateur, ou à Madame Bovary qui nous fait vivre son ennui et sa désespérance. L’empathie pour le personnage nous permet de le suivre, de le comprendre, bien autrement qu’une analyse, même très savante – du moins à mon avis.
Le point de vue que vous choisissez est important. Comment concevez-vous ce choix ?
Par chance (ou par incapacité ?) je ne choisis pas.
Je prends le point de vue qui me vient, celui qui s’impose. Et chaque fois que j’ai voulu changer de point de vue, parler à la troisième personne plutôt qu’à la première, par exemple, ça s’est mal passé… et je suis revenue à l’intuition de départ. Donc maintenant, avec un peu d’expérience, je ne me pose plus la question, je prends le point de vue qui s’impose, aussi bien pour les romans pour la jeunesse que pour les autres textes.
Pour moi, le point de vue qui s’impose c’est celui de l’inconscient, de l’imaginaire, et je crois que mon inconscient est plus futé que moi, plus malin, plus intuitif… C’est une croyance, mais elle me va bien, je la suis.
Quel rôle jouent les objets dans vos romans ? Dans Un couple ordinaire la table basse va révéler bien des dysfonctionnements.
Là encore, je ne décide pas grand-chose. L’objet intervient au fil de la plume, sans préméditation. La seule décision (pas toujours facile) : garder ou ne pas garder. Effacer les pages écrites ou pas.
J’accorde une grande confiance au premier jet, où s’exprime quelque chose qui m’échappe – cette dimension inconsciente, imaginaire.
Ça n’empêche pas, ensuite, de se pencher sur le texte de façon plus « raisonnable », pour le modifier, l’améliorer…
Sinon, je pense que les objets jouent le rôle de symboles ; par exemple le choix de la table basse dans Un couple ordinaire met en scène les relations de pouvoir au sein du couple.
Les rapports au sein du couple sont-ils toujours des rapports de pouvoir ?
Je n’aime pas beaucoup le mot « toujours », qui fige les choses, installe une sorte de fatalité. Non, les relations dans un couple ne sont pas toujours des rapports de force, même si c’est quelque chose que l’on observe souvent – le dominant et le dominé, le fort et le doux, etc.
Dans beaucoup de liens humains, il y a cette tentation de puissance, de pouvoir. Ça ne me va pas ; on n’est pas obligé. On peut s’opposer à ça. Essayer autre chose.
C’est bien pourquoi c’est si important de pouvoir parler, communiquer sur la relation, s’exprimer, dire ce que l’on ressent et ce que l’on attend de l’autre, etc. Mais là, c’est ma casquette de psy qui revient au galop, alors j’arrête là !
Pour vous, comment les titres de chapitres interviennent-ils dans vos romans ?
Merci d’avoir remarqué ces titres de chapitres ! (Je me demande parfois s’ils passent inaperçus ou pas.)
Là, je dois beaucoup à John Irving, que j’ai beaucoup lu à une époque, et beaucoup aimé. Irving donne un titre à chacun de ses chapitres. Un titre intriguant, le plus souvent, ou drôle, espiègle ; une sorte de résumé énigmatique du chapitre qui va suivre.
Et puis il y a Don Quichotte ! Cervantès use de titres de chapitres très savoureux…
Voilà, j’ai été influencée (et j’ai beaucoup de gratitude envers ces lectures qui m’ont imprégnée). Ça me plaît beaucoup de "titrer" mes chapitres ; ça donne à chacun d’eux une allure de nouvelle, or j’aime la nouvelle, la boucle est bouclée.
Vous avez écrit des recueils de nouvelles, Maison buissonnière, Mon amoureux et moi, comment s’inscrivent-ils dans votre parcours littéraire ?
J’aime la nouvelle, en lire, en écrire. En fait je suis peut-être nouvelliste avant tout : même mes romans sont brefs, dans d’autres pays ils seraient nommés "novella". J’aime la forme brève, ce n’est pas tellement un choix, c’est ce qui me vient. J’ai été très contente de publier ces deux recueils, ainsi que Ce que le temps a fait de nous, au Chemin de Fer, qui est justement une novella ; j’en ai plusieurs dans mes tiroirs, qui verront peut-être le jour, car cette forme entre roman et nouvelle me plaît beaucoup. Elle correspond aussi à la vie actuelle, la disponibilité d’esprit, le partage entre le travail et le temps passé à écrire… et sans doute à une disposition personnelle : j’aime la nouveauté, varier, changer… La nouvelle et la longue nouvelle permettent de changer de personnage, de situation.
Plusieurs romans parlent du rapport au père et à sa mort. Est-ce que la mort d’un des parents est un révélateur pour les enfants devenus adultes ?
Là, l’inspiration est nettement autobiographique : quand j’étais enfant, mon père était très malade, sa vie était en danger ; j’avais très peur qu’il meure – ce qui a fini par arriver. J’ai eu conscience très tôt de l’éphémère des moments vécus : tout était en sursis, la vie était fragile.
Alors, oui, la mort d’un parent peut continuer à accompagner la vie adulte, comme d’autres pertes, d’autres chagrins. Je pense qu’on écrit avec nos douleurs, nos failles, nos pertes, nos fragilités, nos tourments, tout ce bazar-là…
L’écriture est-elle un moyen de se révéler soi-même ?
C’est pour moi un moyen de s’exprimer, d’exprimer ce qu’on ne dirait pas sinon. Le plus étrange, c’est de s’exprimer à travers une fiction, là où apparemment on n’est pas concerné personnellement. On parle d’un autre, et ce faisant on s’exprime. J’éprouve beaucoup cela dans mes romans pour la jeunesse, et je ne suis plus un enfant. Mais l’enfant, en moi, en profite bien : il s’exprime, et il jubile de pouvoir le faire !
Dans les ateliers d’écriture, ou rencontres avec des lecteurs, j’ai à cœur de dire cette chose-là : écrire, c’est s’exprimer. C’est dire ce qui ne se dirait pas autrement… et ce faisant rejoindre les autres, rejoindre l’humain, les préoccupations humaines : c’est quoi d’être un être humain, jeté sur la terre, sans savoir quel sens donner à tout ça, et avec la fin promise à tous, comment se débrouiller avec tout ça ?
Dans vos écrits, ce que disent ou pensent vos personnages peut paraître cruel. Expriment-ils ce qui en principe reste caché ?
Merci de cette question, qui me touche ; je pense que oui, c’est ça, mes personnages expriment des choses qu’on ne dit pas habituellement. Je pense que la fiction, les personnages nous offrent cette magnifique occasion : dire ce qui ne se dit pas d’habitude.
On pourrait y voir un côté rebelle, un peu facile. Pour moi, c’est plus profond que ça.
J’ai été très touchée par le discours de Modiano pour son prix Nobel ; il a grandi à une autre époque, un temps très marqué par la guerre, et que je n’ai pas connu, et j’ai pourtant ressenti la même chose quand j’étais enfant : pas le droit à la parole. Il fallait être sollicité(e) pour parler à un adulte, répondre à des questions, mais de façon convenue (je suis en telle classe, je vais en colo, j’ai tel âge, seulement des infos).
J’ai eu conscience, très tôt, de ce manque : ne pas dire, ne pas s’exprimer, je ressentais ça comme un manque, très profond. Alors écrire, oui, c’est une revanche, quelqu’un va bien finir par m’écouter !
Donc il est bien possible que l’enfant en moi, et l’adolescente aussi jubilent de s’exprimer et de dire ce qui ne se dit pas d’habitude.
Vous parlez de thèmes graves avec humour, un humour parfois grinçant. Est-ce que c’est essentiel pour vous d’aborder ces sujets en prenant du recul, sans pathos ?
Je ne sais pas si c’est l’essentiel, mais j’aime bien ça : parler des choses graves de façon légère. Je n’y arrive pas toujours – dans Cette nuit-là, la légèreté ne m’est pas venue, ou très peu, et j’ai suivi le personnage. L’authenticité du texte est très importante pour moi, infiltrer de l’humour quand ça ne s’y prête pas, quand je ne le sens pas, me paraîtrait artificiel… et en contradiction avec ce besoin de s’exprimer.
Je pense que l’humour, la légèreté (quand on peut), la distance, sont une façon de prendre le tragique de l’existence avec plus d’élégance. Mais j’ai bien conscience que c’est une défense. La politesse du désespoir ?
Et puis, très simplement, tout bêtement, j’aime bien plaisanter, j’aime bien rigoler, ça rend la vie la plus douce.
Vos écrits en littérature jeunesse évoquent des problèmes de société comme le divorce, un enfant qui a deux pères ou des problèmes plus émotionnels comme la colère, le sentiment de n’être pas aimé. Comment avez-vous été amenée à écrire pour la jeunesse ? Quel rôle joue la littérature jeunesse pour vous ?
J’ai été amenée à la littérature jeunesse par l’enfant que j’étais, je crois bien. Et par les enfants que j’ai connus de près, mes enfants, leurs amis, les enfants de mon entourage. Et puis, les enfants dans les livres, l’enfance dans la littérature, ce n’est pas rien ; il suffit de penser à Jules Renard et son Poil de carotte, ou à un autre Jules, Jules Vallès et L’enfant, ou encore à Romain Gary parlant de sa mère dans La promesse de l’aube, au petit Marcel Proust attendant le baiser de sa maman, au Livre de ma mère d’Albert Cohen, au Château de ma mère, de Pagnol… un paquet de gamins, dans les bouquins…
Petite, j’avais l’impression que les adultes avaient oublié qu’ils avaient été d’abord des enfants, et je m’étais promis de ne pas tomber dans la même amnésie : « Tu te rappelleras ! » je me disais ; et comme j’avais peur d’oublier ma promesse, je me la répétais souvent. Mes livres jeunesse s’enracinent sans doute là.
La littérature jeunesse n’est pas une sous-littérature, j’y apporte le même soin, avec une exigence de clarté, de simplicité, et de subtilité : les gamins sont malins, faut pas les prendre pour des abrutis ! (La gamine en moi se souvient : on était souvent pris pour des idiots, ce n’était pas juste !)
Les livres pour les enfants sont réjouissants à écrire, ils me viennent comme ils me viennent, je ne force rien ; soudain un personnage d’enfant me vient, une petit bonhomme ou une petite bonne femme, je lui prends la main, je m’attache, et je l’écris… Je viens d’écrire un petit Rémi, qui m’est apparu un soir en m’endormant, dans un demi sommeil, je ne vous dis pas comme il est mignon, malin, attachant. Mais chut, c’est encore dans mes tiroirs.
Quels sont vos projets d’écriture ?
Mes projets d’écriture : ce roman jeunesse que je viens d’évoquer ; un roman adulte qui se situe dans mon nouveau quartier à Paris, un roman sur la solitude et l’optimisme (les deux !), des novellas… et ce que le temps m’apportera. On verra.