







 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Retour à l'accueil du site |
|
Donnie Parascandolo, flic ripoux et violent qui en extra fait l’homme de main pour Big Time Tommy Ficalora, l’un des deux chefs de bande du quartier, est au centre de cette histoire qui se déroule en juillet 1993 à Brooklyn. Un prologue nous donne le contexte : en 1991, lors d’une mission confiée par Big Time Tommy consistant à mettre la pression sur Giuseppe Baldini, professeur italien lui ayant emprunté 25000 dollars, pour qu’il commence à rembourser sa dette, Donnie fortement alcoolisé décide, par haine ou par jeu et contre l’avis de ses deux acolytes Sottile et Pags, de jeter du haut d’un pont ce joueur minable qui ne se défend même pas au lieu d’appliquer la graduation habituelle des avertissements et sanctions qui aurait consisté à donner au mauvais payeur une bonne raclée voire à lui casser quelques doigts pour se faire mieux comprendre. On retrouvera le corps un peu plus loin le lendemain ou surlendemain. Cet acte vaut à Donnie une sévère engueulade du patron qui n’aime pas que ses agents improvisent et suppriment inutilement ses débiteurs à leur guise. Quant à la police locale qui laisse volontiers les Italiens régler leurs comptes à leur façon sans s’en mêler outre mesure, elle se satisfera de la thèse du suicide sans mener la moindre enquête. Outre ces personnages, ce prologue évoque aussi très brièvement l’ex-femme de Donnie (Donna), sa maîtresse (Suzy), Antonina (jeune adolescente) et Mickey (étudiant punk). On se retrouve ensuite deux ans plus tard, presque date à date, dans le même quartier où Donnie Parascandolo, Ralph Sottile et Tony Pagnanelli (dit Pags) effectuent toujours des missions spéciales pour Big Time Tommy. Donnie par contre s’est fait virer de la police pour avoir agressé physiquement son supérieur un soir de beuverie. Si La cité des marges semble initialement s’inscrire dans la lignée des purs polars américains avec ses flics corrompus, la pègre qui œuvre dans l’ombre avec ses règlements de comptes et ses recouvrements de dettes violemment persuasifs, le roman de William Boyle bascule assez rapidement dans le récit plus social du quartier italien de l’arrondissement de Brooklyn où s’est installée une petite classe moyenne issue de l’immigration qui à force de travail a réussi à se faire une place et à se sentir partie prenante du rêve américain même si la vie y est rude et la rue tenue par la mafia (également d’origine italienne) souvent insécure. Dans cette petite Italie, les mamas que sont ici Rosemarie et Ava, femmes soumises à leur époux, perpétuent à travers la vie ordinaire du foyer, par leurs expressions, leur cuisine, leur comportement avec leur progéniture et leurs chansons, le souvenir de cette Italie qui, même si elles n’y ont personnellement jamais mis les pieds et qu’elles ne la connaissent que par les récits et traditions familiales, constitue leur identité profonde. Les parents économisent pour permettre à leurs enfants (ainsi Nick, Mickey et Antonina) d’étudier à l’université afin de se garantir un avenir plus confortable. Encadré par un prologue centré sur l’assassinat de Giuseppe Baldini par Donnie Paranscadolo en juillet 1991 et un épilogue où interviennent Nick Bifulco, Antonina Divino et Mickey Baldini (la jeune génération donc) en décembre 1994, ce roman choral se construit autour de quarante et un courts chapitres concernant ce mois de juillet 1993, portés chacun alternativement par l’un des sept protagonistes essentiels que sont Donnie mais aussi Ava et Nick Bifulco, Rosemarie et Mickey Baldini, Donna Rotante et Antonina Divino, nous rapportant leurs actes, leurs propos mais aussi leurs pensées intimes. Le lecteur qui découvre le récit de chacun des personnages en sait donc plus par cette lecture active et globale que chacun d’entre eux. À travers ces aller-retours qui constituent une fresque vivante et foisonnante où les personnages se croisent et interfèrent les uns avec les autres, Alice, petite amie de Nick, et Phil Puzzo, l’écrivain à succès, ne nous apparaîtront qu’à travers les propos du fils de Rosemarie, Giuseppe, qu’en souvenir à travers les propos de sa femme et son fils, Ralph à partir de ceux d’Antonina. Et ce n’est qu’à travers ses dialogues avec Donnie, Ralph et Pags, Rosemarie et Mickey que le mafieux Big Time Tommy Ficalora, doté d’une vraie personnalité derrière la caricature première, aura la parole. La mort violente est toujours, partout, ici en suspens. Si par moments le lecteur pressent le drame, à d’autres elle s‘impose sans qu’on l’ait vue venir. Les deuils du passé aussi font ici sujet, celui d’un époux aimé pour Rosemarie et Ava, celui d’un enfant et d’une épouse pour Ralph, d’un enfant pour Donna, d’un fils adolescent pour Donnie. L’auteur en explorant les blessures profondes et encore ouvertes de ses personnages avec respect et tendresse, même pour l’affreux Donnie, parvient alors à éveiller chez le lecteur au fil de leurs différentes interventions une forme d’empathie avec ces êtres, bourreaux ou victimes, qui vivent en permanence au bord d’un gouffre et peuvent à tout moment basculer. Il est vrai que le Brooklyn de William Boyle entre violence et ennui a un goût d’enfer et son roman un air de tragédie. Certains, murés dans l’immobilité, rêvent d’une vie meilleure de l’autre côté du pont sans jamais oser partir et si des jeunes attendant avec impatience l’université pour s’évader s’installent sur place et ne reviennent plus qu’occasionnellement visiter leurs parents, d’autres rentrent chez leur mère une fois leurs études finies. Enfin il y a ceux, acculés, que seules des circonstances extérieures poussent à fuir ou à s’enterrer là. L’intrigue de La cité des marges est bien construite, portée par un rythme vif, émaillée de très nombreux dialogues. Le style de William Boyle est à la fois très oral et visuel. Son écriture est empreinte d’autant de sensibilité que d’humour. L’auteur qui est né et a grandi à Brooklyn où il a exercé le métier de disquaire spécialisé dans le rock américain indépendant, jalonne ses chapitres de multiple références musicales (entre autres : Bruce Springsteen, Garland Jeffreys, Otis Redding, Neil Young, Patti Smith, Joni Mitchell…). Grand amateur de cinéma il y évoque aussi Tarentino, Scorsese (Mean Streets), Polanski (Frantic)… sans oublier pour la littérature un hommage à Hunter S. Thompson et à Herbert George Wells. Dominique Baillon-Lalande (20/06/22) |
Sommaire Noir & polar 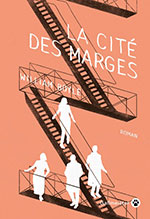 Gallmeister 432 pages - 24,40 € Traduit de l‘américain par Simon Baril
Bio-bibliographie sur Wikipédia |
||||||