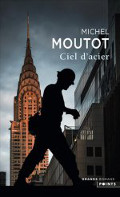Les Mohawks canadiens ou américains, nation amérindienne de langue iroquoise, vivent dans des réserves près de Montréal ou à la frontière avec les États-Unis.
Quand, déjà sollicitée pour la construction du pont Victoria au-dessus du fleuve Saint-Laurent pour laquelle les Indiens avaient été pris comme journaliers en 1860, la compagnie ferroviaire accompagnée d'un ingénieur sollicite à nouveau la collaboration du chef de Kahnawake pour la construction d'un nouveau pont, celui-ci en référera à son conseil en ces termes : « Nous ne vivons plus de la chasse et du transport des fourrures pour les Français. Les troncs d'arbres vont bientôt descendre vers Québec sur des wagons et non plus sur le fleuve. Je pense que nous devons accepter ce pont et tenter d'en tirer le meilleur parti, comme nos ancêtres l'ont fait en commerçant avec les premiers Blancs venus d'Europe, plutôt que de les combattre. Faute de quoi nous seront balayés, nos réserves transformées en mouroirs comme c'est le cas dans l'Ouest des États-Unis. » Il négociera par la suite non seulement l'utilisation des carrières de son territoire exploitées par les Mohawks pour la fourniture des matériaux mais aussi que d'autres membres de la communauté, reconnue par tous les Iroquois pour le savoir-faire de ses charpentiers, soient « formés à l'art d'assembler le fer avec des clous brûlants » et intègrent les équipes spécialisées du chantier.
De leur côté, les contremaîtres s'étaient vite rendu compte que les Indiens escaladaient les poutres d'acier en hauteur sans la moindre hantise, qu'ils étaient costauds et, qu'en équipe, ils étaient particulièrement performants. « Leurs ancêtres, excellents charpentiers, bâtissaient des maisons de 200 pieds de long. Construire fait partie de leur identité tribale. » « La légende, fausse bien sûr, veut qu’ils ne connaissent pas le vertige. » En fait, « ils ont appris de père en fils à apprivoiser la peur, à respecter le danger, à vivre et travailler là où les autres ne peuvent pas s’aventurer et marchent comme des chats sur des poutres de trente centimètres de large à des hauteurs vertigineuses. »
À partir de cette date et pendant une petite centaine d'années, chaque famille Mohawk de Kahnawake a fourni son lot d'ironworkers (travailleur de l'acier nommés aussi charpentiers du ciel) pour la construction des ponts ou buildings de l'Amérique du Nord,
L'effondrement du pont Québec lors de sa construction en 1907, faisant 96 morts dont 35 Mohawks soit « la moitié des monteurs d'acier que comptait la réserve à l'orée du vingtième siècle », ne changea pas le cours des choses.
Le travail, qui consiste à assembler les poutres métalliques pour former le squelette des tours ou des ponts, est pourtant dur. Il leur faut, sous le soleil cuisant, la pluie ou la neige, à des centaines de mètres de hauteur (417m pour le World Trade Center), fixer avec d'énormes boulons des poutres de cinq à vingt tonnes posées par d'immenses grues.
Certes les salaires attractifs pour du personnel sans qualification assuraient à la communauté le revenu familial annuel le plus élevé de toutes les collectivités autochtones au Canada, mais surtout les Indiens de Kahnawake appréciaient ce métier à risques qu'ils considéraient comme « noble, libre et excitant », y trouvant la fierté d'appartenir ainsi personnellement et collectivement aux héros bâtisseurs des temps modernes.
Effectivement, pas une seule construction de ces buildings vertigineux et historiques qui, dès les années vingt, façonnaient la nouvelle silhouette de New-York (Empire State Building, tour Chrysler, World Trade Center…) n’a été réalisée sans la participation d'équipes d'assembleurs Mohawks maintenant regroupés dans un syndicat attitré.
Les Mohawks de la réserve ont tous grandi dans l’ombre des Twin Towers, mais pour John, avec la mort de son père, Jack LaLiberté dit Tool, alors ouvrier sur le chantier et frappé puis précipité dans le vide par la foudre en 1970, les tours font intégralement partie du patrimoine familial.
Elles sont à la fois cercueil et génératrices de gloire, les anciens ayant fait du défunt la fierté et la légende du clan. John apprendra plus tard que la « clef à mâchoire » et le « tomahawk » de l'accidenté avaient été cachés au sommet de la tour Nord juste avant la fin des travaux, lors d'une cérémonie rituelle organisée par l'équipe Mohawk du chantier.
Le 11 septembre 2001, au moment où les Twins Towers s’effondrent, John LaLiberté, devenu ironworker comme son père, travaille sur le chantier d'un nouveau building à Manhattan. Il assiste en direct au passage très bas d’un Boeing au-dessus de sa tête, à l’impact contre la première des tours jumelles et à son effondrement. Passé l'incroyable moment de stupeur, abandonnant son chantier, il se précipite sur les lieux du désastre dans l'atmosphère de guerre qui envahit alors toute la ville comme des dizaines d’ironworkers pour participer aux côtés des sauveteurs au déblaiement des gravats et permettre le sauvetage d'éventuels survivants.
« Les hommes blancs nous voient sur les gratte-ciel en construction [...] mais la plupart ne savent pas que nous les déconstruisons aussi, les découpons en morceaux quand il faut les faire disparaître. Juste après la catastrophe, nous avons compris qu'ils allaient avoir besoin de nous » dira John aux policiers qui bloquent l'entrée du site pour qu'ils le laissent passer.
« Quand nous avons vu les tours s'écrouler, d'abord nous sommes restés pétrifiés devant la télé. Puis nous avons appelé les fils, les neveux, les jeunes. Au Canada et ailleurs. Nous leur avons dit : prenez vos outils, les chalumeaux et partez pour New-York. Les Twin Towers sont à nous. C'est nous qui les avons construites. A vous de les mettre en terre. Et de marcher dans le ciel, de boulonner les poutres, d'honorer les ancêtres quand il sera temps de les reconstruire. [...] En s'attaquant au World Trade Center, c'est aussi à nous que ces fumiers de terroristes s'en sont pris » raconte de son côté le chef du Conseil des anciens de Kahnawake.
Ce sera finalement « une cinquantaine d'Indiens [...] venus des réserves Kahnawake, Akwesasne, Oneida et Onondaga » qui assisteront les pompiers durant plusieurs mois à Ground Zero.
« Nous travaillons dans les ruines du World Trade Center, qu'ils appellent Ground Zero, dans un effroyable et indescriptible champ de ruines, au premier déblaiement des gravas en vue de sauver d'hypothétiques survivants. [...] Nous découpons l'acier, les milliers de tonnes de poutres tordues et de ferraille entassées à la place des deux tours. [...] Dedans, c'est dur, épuisant, effrayant, dangereux, mais nous nous sentons plus qu'utiles : indispensables, admirés, investis d'une mission patriotique, sacrée, presque divine ! »
« Les dizaines de feux qui couvent sous les décombres, les jets des lances à incendie, [...] l'orage qui s'apaise, tout fait monter au-dessus du magma un mélange de fumées blanches, grises, par endroits plus foncées. » « Les structures de métal sont tellement enchevêtrées qu'on dirait un plat de spaghettis géant, avec des angles et des morceaux coupants partout. [...] comme tout est connecté, il faut éviter de faire s'écrouler un amas qui pourrait ensevelir les dix gars que l'on entend creuser de l'autre côté mais qu'on ne voit pas. Tordues comme des trombones, des poutres de telles sections accumulent de l'énergie : difficile de deviner ce qui va se passer quand tu en coupes un morceau. Ça peut sauter en l'air, s'effondrer, tout ravager sur son passage. »
« Le retour à la vie ordinaire est déroutant, frustrant, décevant. Difficile de l'avouer [...] Ground Zero a commencé à agir sur certains d'entre nous comme une drogue. »
Dans l’effroyable magma de métal et de feu, John va aussi tenter, sans y croire, de retrouver la « clef à mâchoire » et le « tomahawk » de son père...
Huit mois plus tard, la dernière poutre, « la B 1001, s'incline lentement jusqu'à l'horizontale. Le grutier la pose en douceur sur quatre chevrons au sol. [...] Les feutres sortent des poches. Chaque centimètre est couvert de signatures, dates, maximes. Certains cherchent un espace libre pour y noter le nom d'un collègue, d'un parent, d'un ami disparu. Un capitaine des pompiers, qui a perdu un fils dont rien n'a été retrouvé, tapote le métal comme s'il caressait la joue d'un enfant. [...] Une housse de tissu noir et une grande bannière étoilée ont été découpées aux mesures de la dernière poutre. Nous la couvrons de son linceul. [...] je ne suis pas sûr de vouloir être là demain pour leur cirque avec le maire, le gouverneur et les huiles. C'est fini. »
Dix-huit mois plus tard, John assistera à la mort d'un de ses amis proches atteint d'une fibrose pulmonaire due à l'amiante, à la poussière de ciment et aux saloperies respirées à Ground Zero. Un cas fréquent. « Un poison violent, un mélange comme je n'en ai jamais vu en trente ans de carrière » dira à John le médecin spécialement affecté à ce programme de suivi sanitaire des « héros ».
Quand la construction de la Liberty Tower débutera en 2008 sur l'emplacement des anciennes Twins Towers, John en sera. Son dernier chantier avant la retraite, plus comme ironworker mais comme contremaître. Ce « nouveau phare pour la démocratie, hommage aux héros et au courage de l'Amérique », atteindra, quand l'antenne sera posée, 1776 pieds (en rappel de la date de la déclaration de l'Indépendance).
Le premier septembre 2012, à « une heure du matin, quatre cents mètres au-dessus de Manhattan », John rendra un dernier hommage à son père au sommet de la tour édifiée sur les ruines de la tour Nord, joignant à une vieille photo de Tool prise au sommet d'un building en construction difficilement identifiable, une patte d'ours, du tabac mais aussi sa propre « clef à mâchoire », « sa ceinture wampum » symbolisant son clan et son badge nominatif d’accès à Ground Zero lors du drame.
Ce roman polyphonique de 520 pages s'articulant autour de 25 chapitres croise trois thématiques majeures : la construction du nouveau New-York avec son urbanisme audacieux et ses tours, avec ses assembleurs de poutres métalliques en hauteur, selon un mode essentiellement documentaire BTP, l'approche de la communauté Mohawk qui par son travail et son courage s'est fait sa place dans cet univers de ferraille et de béton sans renier sa culture, selon un mode ethnologique, et la catastrophe du 11 septembre 2001 selon un mode journalistique. Les trois sujets s'entrecroisent souvent.
Pour « fictionner » l'ensemble l'auteur, journaliste ayant couvert sur place la catastrophe de l'attentat des Twins Towers, fait lien entre ces trois pôles par la famille LaLiberté et plus particulièrement avec le personnage de John que nous pouvons suivre de l'enfance (quand il est sur un échafaudage et qu'il est pris par le vertige) au seuil de la retraite. Mais ce n'est pas là que l'écrivain est le plus convaincant. Nous ne saurons pas grand-chose du caractère et de la psychologie du protagoniste qui reste plus figé dans une représentation de son peuple que personnalisé. De ce fait, l'épisode amoureux qu'il vit avec une des bénévoles de la Croix Rouge semble sans ressort et assez convenu. Car l'humanité ici n'est pas individuelle mais collective, dans la communauté ouvrière du chantier et des ironworkers, dans celle qui anime la société démocratique des Mohawks, et dans la solidarité qui réunit pompiers, ironworkers, grutiers, associations humanitaires et populations captives de la zone de Ground Zero, lors de la recherche des survivants puis des corps sous les décombres.
Mais la vraie force de ce texte est ailleurs. Elle vient à partir du World Trade Center, pivot réel du récit de cette opposition transfigurée et presque mystique entre le ciel et l'enfer.
En haut, se trouve l'univers des tours en construction, avec le vent qui vient caresser ou bousculer les bâtisseurs à l’œuvre, la fierté qu'ils ressentent, le challenge technique et humain que leur entreprise représente, la lumière qui vient baigner le ciel quadrillé de poutres en plein air. Un monde au-dessus des préoccupations quotidiennes et de l'agitation de la ville, de ses rues, de ses commerces, ses banques et son business, de la circulation automobile dont même les bruits sont étouffés. Un tableau qui donne lieu à une vision édulcorée d'une population multiculturelle mais portée par le même élan, comme une icône symbolisant la puissance et le rêve américain.
Mais le 11 septembre, un démon venu du ciel a précipité les plus hautes tours du monde vers le vide et l’abîme, transformant le rêve en enfer. À Ground Zero, l'air est chargé de fumées toxiques, le feu détruit tout sur son passage, les poutres rectilignes qui défiaient les lois de la pesanteur se tordent comme des serpents et s’enchevêtrent faisant obstacle à la lumière, puis s'effondrent écrasant les corps. C'est avec la chute de l'ange, le symbole même de la puissance nord-américaine, sa fierté nationale, qui se trouvent meurtris par cet attentat terroriste meurtrier, engloutis sous l'amas de pierre et de fer avec les victimes. La stupeur ressentie par tous devant l'effondrement des tours et la vague humaine qui émerge aussitôt pour proposer de l'aide, sont à mesurer à l'aune de la violence ressentie par tous en cet instant.
La description de l'évacuation des ruines de Ground Zero avec ces tôles tourmentées et ces corps fragmentés, nous plonge dans l'horreur avec encore plus de force et nous saisit, nous mêmes suspendus au-dessus du monde, dans la perspective lumineuse de la prouesse technologique et de la puissance humaine.
Et on se demande alors si l'ensemble du roman ne serait pas justement construit, avec une maîtrise avérée du jeu des contrastes, uniquement dans le but de nous faire ressentir de plus près l'incrédulité et l'effroi ressentis par la population devant cette vision apocalyptique des attentats du 11 septembre, pour incarner au plus près la violence ressentie par tous en cet instant.
Plus que dans l'essai d'habiter son récit documentaire par un personnage, ou par ses détours par la réserve Mohawk, c'est par cette incarnation symbolique même du Word Trade Center que, pour moi, l'auteur fait acte ici de littérature, avec un souffle épique à vous donner des frissons.
Surprenant !
Dominique Baillon-Lalande
(02/02/15)