Les Papiers collés
de Claude Darras
Été 2022
Carnet : la Loire en tubes…
Tuyau de Pont-à-Mousson : 6 mètres de long 0,60 de large Poids 1 100 kilos. Ils partent de Tours. Ils sont arrivés à Chemellier. Ils continueront jusqu’à Niort. Quand ces tubes, monstrueux, seront enfouis, coulera, dedans, la Loire ! Voilà.
La Poésie ? on s’en fout ! Vive le maïs ! Lettre à Claude Billon, mercredi 6 septembre 1995.
(Jules Mougin, « 1912 : toutes les boîtes aux lettres sont peintes en bleu ciel », Travers 53, Philippe Marchal éditeur, 1999)
Humilité
Est-ce que je lirais ce que j’écris, si je n’en étais pas l’auteur, donc, un peu forcé ? J’en doute.
(Georges Perros, « Carnet 1965 », Œuvres, Quarto Gallimard, 2017)
La charité, m’sieurs dames !
Déchirante, l’image de cette mère au visage anguleux couleur de terre brûlée et de son enfant grêle, tous deux affalés sur une couverture à l’entrée du supermarché. Elle tend et le regard et la main aux clients pressés et indifférents poussant leur chariot débordant tandis que sa fille regarde autour d’elle les yeux ronds dans l’attente d’un sourire.
Vœu pieux
Pionnier des lignes aériennes françaises, Didier Daurat prescrivait en bon docteur ès optimisme : « Donnez aux hommes un but collectif, et placez ce but à une hauteur presque inaccessible. Bloquez tous les efforts dans une émulation sans fin, et vous ferez de la molle pâte humaine une substance de qualité. Elle offrira alors ce qu’elle contient de meilleur. » L’invite vaut pour toute équipe, sportive, associative ou gouvernementale.
(Jeudi 24 mars 2022)
 Cimaises Cimaises
Le dessous des cartes de FO2
Sans être géographe ou cartographe, Jean-François Dougnalo alias FO2 a la passion des mappemondes, ces projections planes des deux hémisphères du globe terrestre où les continents, les îles et les archipels se détachent dans un dégradé de jaune au rose, de vert au marron figurant les reliefs, les forêts et les plaines sur le bleu azuréen des mers et des océans. Lyonnais d’adoption né à Dakar (Sénégal) le 8 mars 1963,  le plasticien allie la structure fragmentée des planisphères à des matériaux composites et des objets de rebut (bois, sable, tissu, métal) faisant naître un bestiaire énigmatique et singulier. Aigle, buffle, cerf, chien, coq, lévrier, lion, poisson, rhinocéros, vautour sont ainsi modelés dans les trois dimensions en victimes expiatoires de l’avidité et de la bêtise humaines. Écologiste avant la lettre, il arpente du même coup l’imaginaire ancestral de ses aïeux pour recouvrer les couleurs des pagnes qu’ils ajustaient autour des hanches. Les inventions contemporaines comme l’automobile et la photographie sont également prises en compte dans une création à haute teneur politique.
le plasticien allie la structure fragmentée des planisphères à des matériaux composites et des objets de rebut (bois, sable, tissu, métal) faisant naître un bestiaire énigmatique et singulier. Aigle, buffle, cerf, chien, coq, lévrier, lion, poisson, rhinocéros, vautour sont ainsi modelés dans les trois dimensions en victimes expiatoires de l’avidité et de la bêtise humaines. Écologiste avant la lettre, il arpente du même coup l’imaginaire ancestral de ses aïeux pour recouvrer les couleurs des pagnes qu’ils ajustaient autour des hanches. Les inventions contemporaines comme l’automobile et la photographie sont également prises en compte dans une création à haute teneur politique. Aux observateurs attentifs de l’œuvre peint et sculpté, il n’échappera pas que ce qui se joue aux quatre coins de la Terre nous concerne tous. La dénonciation de FO2 exclut tout appel : les crimes contre la nature compromettent l’équilibre climatique et la biodiversité de la planète. Nous ressentons ici à quel point l’artiste opère dans un état d’inquiétude. Mais pourquoi FO au carré ? Parce qu’en langue wolof Fofo signifie grand-frère et que plus d’une communauté patriarcale en terre ouest-africaine respectent l’aîné de la fratrie à l’égal du patriarche.
Aux observateurs attentifs de l’œuvre peint et sculpté, il n’échappera pas que ce qui se joue aux quatre coins de la Terre nous concerne tous. La dénonciation de FO2 exclut tout appel : les crimes contre la nature compromettent l’équilibre climatique et la biodiversité de la planète. Nous ressentons ici à quel point l’artiste opère dans un état d’inquiétude. Mais pourquoi FO au carré ? Parce qu’en langue wolof Fofo signifie grand-frère et que plus d’une communauté patriarcale en terre ouest-africaine respectent l’aîné de la fratrie à l’égal du patriarche.
Henri Mitterand n’est plus
Spécialiste reconnu d’Émile Zola dont il édita les œuvres complètes, Henri Mitterand est mort le 8 octobre 2021, à Paris, à l’âge de 93 ans. Né en Bourgogne, à Vault-de-Lugny, dans l’Yonne, près d’Avallon, le 7 août 1928, il était le petit-fils d’un sabotier morvandiau. Son père, Joseph, était cheminot, sa mère, Hélène, couturière. Brillant universitaire, il a enseigné à Paris et hors de France, à Toronto et à Columbia. Chercheur boulimique, il s’est intéressé à l’œuvre de Louis Aragon et de Julien Gracq, de Claude Simon et de Philip Roth.
(Jeudi 31 mars 2022)
|
Billet d’humeur
Des passereaux truffiers !
Pour trouver les précieuses truffes, noires, blanches ou grises, le trufficulteur requiert la collaboration d’un « nez ». Celui d’une truie ou celui d’un chien, plus spécialement dressés à l’exercice. Divers indices signalent la présence de Tuber melanosporum (la truffe noire du Périgord), Tuber brumale (la Vermande du Poitou), Tuber magnatum pico (la Blanche du Piémont), Tuber uncinatum (la truffe grise de Bourgogne) et Tuber aestivum (la truffe d’été) : le « brûlé », ou rond truffier, no man’s land stérile où le champignon règne en maître, ainsi que la présence de Suillia gigantea, une mouche qu’attirent les effluves soufrés (diméthyl-sulfure) provenant des composés volatils de l’arôme de truffe. La mouche au dos roussâtre et aux yeux orangés n’a pas son pareil pour flairer les truffes et se poser à leur aplomb sur le brûlé où elle a coutume de pondre ses œufs. Outre porcins, canidés et diptères, des oiseaux disposent d’un puissant odorat pour dénicher le faux parasite qui vit en symbiose avec les racines de plusieurs fagacées, chênes kermès, pédonculé, chevelu, rouvre, tauzin ou brosse. À la faveur de prospections commencées en 2018, une équipe américano-chilienne de scientifiques a découvert dans les forêts tempérées du sud du Chili deux espèces de passereaux qui dispersent les spores de diverses espèces de truffes à travers leurs déjections, le chucao tapaculos (Scelorchilus rubecula) et le huet-huet à gorge noire (Pteroptochos tarnii). Les truffes ainsi dispersées sont associées de façon symbiotique avec les arbres de la famille des nothofagacées (hêtres notamment) qui dominent en Patagonie. Ces feuillus fournissent du sucre aux champignons en échange d’éléments minéraux que ceux-ci leur procurent au niveau des racines. Certaines des truffes inventoriées de part et d’autre de la cordillère des Andes produisent des sortes de baies, bleues, rouges et violettes. Ces mêmes baies dont se délectait, paraît-il, le moa géant (Dinornis robustus), un oiseau coureur dont neuf espèces vivaient au pléistocène supérieur en Nouvelle-Zélande. Des paléontologues ont constaté la présence de spores de champignons truffiers dans les crottes fossiles du volatile qui a complètement disparu il y a six cents ans : il ressemblait à une autruche croisée avec un kiwi !
|
Lecture critique
La truite des frères Massé
 Œuvre lyrique, « Lam, la truite » (en catalan, lam désigne « l’éclair ») témoigne du goût affiné de Ludovic Massé (Évol, 1900-Perpignan, 1982) pour les paraboles, cette manière de décrire plus en images qu’en préceptes le monde familier et méconnu de sa Catalogue natale. L’histoire d’une truitelle née dans l’eau douce et tumultueuse du torrent Asglaï, au cœur des montagnes karstiques de la vicomté de Vallespir, passionne son lectorat sans manquer d’être une œuvre d’écrivain qui sait donner aux aventures vécues par la population subaquatique cette ampleur sans quoi la fable animalière ne serait qu’addition d’anecdotes dont on se lasse. L’instituteur écrivain tient cette histoire de son frère aîné Sylvain (Évol, 1888-1971). Commis des PTT et collaborateur de la revue Prolétariat (1933-1934), c’est lui qui présenta Henry Poulaille (1896-1980), le chef de file des écrivains prolétariens, à Ludovic. Si l’on en croit le poète et essayiste Joël Cornuault (Paris, 1950) qui préface le livre, le cadet était à la fois fasciné et horrifié par l’eau, un fait qu’il tient de Bernadette Vidal-Truno, biographe avertie de Ludovic Massé. Pêcheur émérite et théoricien exigeant, Sylvain avait d’ailleurs intégré le comité de rédaction de revues halieutiques de référence. Ouvrage à deux plumes, « Lam, la truite » raconte une tranche de vie des salmonidés qui montent et descendent les cours d’eau torrentueux de la vallée des Oubells pour frayer : « La frayère était vaste, lit-on. Les trois mille œufs de Marta s’y étaient rangés au hasard. Ils formaient un dépôt laiteux, semé de points nacrés où le torrent Asglaï insinuait ses frémissements et qui vivait de la vie tremblotante des gelées. » Marta, la truite noire, a donné le jour à Lam, née au quatre-vingt-treizième jour de l’incubation, « à l’écart, entre deux cailloux où un destin singulier avait fait rouler l’œuf femelle qui la contenait en germe. » Les auteurs évoquent les jeux dans la frayère, les combats entre jeunes rivaux, la quête de la subsistance, la menace de volatiles marins, un quotidien qui laisse apercevoir dans l’obscurité des roches et des berges où pullulent larves, alevins et végétaux, les autres habitués des eaux noires : l’éphémère gris qui répond au surnom de Nymphéo, l’arachnide Aragne qui se repaît de moucherons, Bouffot, le rat d’eau qui pactise avec Lam, le martin-pêcheur Saphir, aussi rustaud que criard, et Négrenque, la vache noire assoiffée qui traverse le gué, en robe luisante, sur ses escarpins fourchus… Au fil de l’eau fraîche et des quatre saisons du Gouffre noir de Caralbe, la population animale admet de mauvaise grâce l’homo sapiens en la personne du gitan Fraï : « Il pêchait avec des gaules qu’il préparait lui-même, des bambous chapardés aux parcs. Son sens de l’eau, son calme, son opportunité, lui donnaient une maîtrise étonnante. Il soulevait les truites en pleine révolte, au bout de ses leurres éprouvés, et leur vol venait se terminer sur sa poitrine où sa main libre les plaquait. » Plus maligne que le pêcheur, Lam échappe à ses pièges et s’en va visiter les fonds ténébreux où elle sait débusquer le petit chevesne d’argent et le barbillon roux. Chaque fois, selon la blancheur du sable, le bleu des gravières ou la mousse de la roche, elle change de robe : « Chaque événement des eaux ou du ciel, chaque changement d’affût la trouvait en toilette nouvelle », nous enseignent les Massé. « Le jour approchait où Lam mettrait sa robe de noces… nous préviennent-ils plus loin. Cependant que le mâle rutilerait dans son habit, éclatant comme sa passion, elle se vêtirait de sa robe la plus terne et elle se préparerait à la maternité comme à un deuil… » Aux dernières lignes du récit, Sylvain et Ludovic Massé s’accordent à penser que Lam peut espérer devenir la reine de la Teste, enrichir de récits l’imagination des riverains, passer dans les rêves de Fraï le gitan, faire planer sur le fleuve sa réputation de corsaire… Œuvre lyrique, vous disais-je, à la dramaturgie intime qui nous rend la faune aquatique des Pyrénées orientales à une douce et enfantine humanité. Œuvre lyrique, « Lam, la truite » (en catalan, lam désigne « l’éclair ») témoigne du goût affiné de Ludovic Massé (Évol, 1900-Perpignan, 1982) pour les paraboles, cette manière de décrire plus en images qu’en préceptes le monde familier et méconnu de sa Catalogue natale. L’histoire d’une truitelle née dans l’eau douce et tumultueuse du torrent Asglaï, au cœur des montagnes karstiques de la vicomté de Vallespir, passionne son lectorat sans manquer d’être une œuvre d’écrivain qui sait donner aux aventures vécues par la population subaquatique cette ampleur sans quoi la fable animalière ne serait qu’addition d’anecdotes dont on se lasse. L’instituteur écrivain tient cette histoire de son frère aîné Sylvain (Évol, 1888-1971). Commis des PTT et collaborateur de la revue Prolétariat (1933-1934), c’est lui qui présenta Henry Poulaille (1896-1980), le chef de file des écrivains prolétariens, à Ludovic. Si l’on en croit le poète et essayiste Joël Cornuault (Paris, 1950) qui préface le livre, le cadet était à la fois fasciné et horrifié par l’eau, un fait qu’il tient de Bernadette Vidal-Truno, biographe avertie de Ludovic Massé. Pêcheur émérite et théoricien exigeant, Sylvain avait d’ailleurs intégré le comité de rédaction de revues halieutiques de référence. Ouvrage à deux plumes, « Lam, la truite » raconte une tranche de vie des salmonidés qui montent et descendent les cours d’eau torrentueux de la vallée des Oubells pour frayer : « La frayère était vaste, lit-on. Les trois mille œufs de Marta s’y étaient rangés au hasard. Ils formaient un dépôt laiteux, semé de points nacrés où le torrent Asglaï insinuait ses frémissements et qui vivait de la vie tremblotante des gelées. » Marta, la truite noire, a donné le jour à Lam, née au quatre-vingt-treizième jour de l’incubation, « à l’écart, entre deux cailloux où un destin singulier avait fait rouler l’œuf femelle qui la contenait en germe. » Les auteurs évoquent les jeux dans la frayère, les combats entre jeunes rivaux, la quête de la subsistance, la menace de volatiles marins, un quotidien qui laisse apercevoir dans l’obscurité des roches et des berges où pullulent larves, alevins et végétaux, les autres habitués des eaux noires : l’éphémère gris qui répond au surnom de Nymphéo, l’arachnide Aragne qui se repaît de moucherons, Bouffot, le rat d’eau qui pactise avec Lam, le martin-pêcheur Saphir, aussi rustaud que criard, et Négrenque, la vache noire assoiffée qui traverse le gué, en robe luisante, sur ses escarpins fourchus… Au fil de l’eau fraîche et des quatre saisons du Gouffre noir de Caralbe, la population animale admet de mauvaise grâce l’homo sapiens en la personne du gitan Fraï : « Il pêchait avec des gaules qu’il préparait lui-même, des bambous chapardés aux parcs. Son sens de l’eau, son calme, son opportunité, lui donnaient une maîtrise étonnante. Il soulevait les truites en pleine révolte, au bout de ses leurres éprouvés, et leur vol venait se terminer sur sa poitrine où sa main libre les plaquait. » Plus maligne que le pêcheur, Lam échappe à ses pièges et s’en va visiter les fonds ténébreux où elle sait débusquer le petit chevesne d’argent et le barbillon roux. Chaque fois, selon la blancheur du sable, le bleu des gravières ou la mousse de la roche, elle change de robe : « Chaque événement des eaux ou du ciel, chaque changement d’affût la trouvait en toilette nouvelle », nous enseignent les Massé. « Le jour approchait où Lam mettrait sa robe de noces… nous préviennent-ils plus loin. Cependant que le mâle rutilerait dans son habit, éclatant comme sa passion, elle se vêtirait de sa robe la plus terne et elle se préparerait à la maternité comme à un deuil… » Aux dernières lignes du récit, Sylvain et Ludovic Massé s’accordent à penser que Lam peut espérer devenir la reine de la Teste, enrichir de récits l’imagination des riverains, passer dans les rêves de Fraï le gitan, faire planer sur le fleuve sa réputation de corsaire… Œuvre lyrique, vous disais-je, à la dramaturgie intime qui nous rend la faune aquatique des Pyrénées orientales à une douce et enfantine humanité.
- Lam, la truite - Livre de nature et poème de la rivière, par Sylvain et Ludovic Massé, présentation Joël Cornuault, éditions Pierre Mainard, 160 pages, 2017.
Lectures complémentaires :
- Ludovic Massé, un aristocrate du peuple, par Bernadette Truno, mare nostrum éditions, 290 pages, 1996 ;
- Papiers collés n° 3, automne 2012, Les paraboles de Ludovic Massé (1900-1982).
Portrait
La condition humaine selon Régis Jauffret
Quelle invention ! Onze ans après ses premières « Microfictions », placées sous l’épigraphe « Je est tout le monde et n’importe qui », Régis Jauffret (Marseille, 1955) récidive avec « Microfictions 2018 », un volume qui comporte en exergue « Toutes les vies à la fois » et contient comme le précédent cinq cents récits d’une page et demie à la première personne du singulier, des fictions classées par thème et par ordre alphabétique de titres. De la même façon qu’en 2007, sa plume le porte à révéler la face cachée du quotidien d’une population apparemment banale mais affectée de pathologies mentales ou d’anomalies héréditaires. Physiques ou intellectuelles, ces tares constituent les éléments les plus précieux de son  invention avec les personnages qui en sont atteints. Écrivains déséquilibrés, journalistes sadiques, flics débiles, amantes perverses, pères de famille assassins, enfants désaxés se racontent à travers leurs secrets et leurs desseins les plus inavouables. En vérité, c’est l’auteur qui endosse l’identité ainsi que les faits et les gestes de chacun d’eux. L’horreur et la barbarie dominent ces histoires de crimes et de suicides qui se déroulent le plus souvent dans l’intimité familiale et domestique de l’habitat collectif ou dans le huis clos des entreprises de nos contemporains. Un romanesque sordide, une réalité abominable, des situations obscènes qui seraient insupportables sans l’ironie souvent grinçante de l’écrivain et son sens aigu de la dérision. Une satire de la condition humaine qui ne tempère pas toujours l’outrance du propos. Dans « Auges caritatives » par exemple : « De nos jours, les malheureux pullulent comme jamais depuis la crise de 1929. Toutefois, nourris aux auges caritatives, ils ont bonne mine et bon sang tant que les nuits d’hiver à la belle étoile n’ont pas éreinté leur organisme au point de ne générer plus qu’une sève cadavérique dont ne voudrait pas une chauve-souris. » Le trait est tout aussi mordant dans « Contrebalancer nos garçons » : « Ma mère n’est pas morte, mais elle a le regard vague depuis son attaque et à chaque fois que je la vois je ne peux m’empêcher de fixer longuement ses mollets en me demandant lequel de ses pieds a déjà disparu dans la tombe. » Autre pépite fielleuse : « Dans notre famille nous invention avec les personnages qui en sont atteints. Écrivains déséquilibrés, journalistes sadiques, flics débiles, amantes perverses, pères de famille assassins, enfants désaxés se racontent à travers leurs secrets et leurs desseins les plus inavouables. En vérité, c’est l’auteur qui endosse l’identité ainsi que les faits et les gestes de chacun d’eux. L’horreur et la barbarie dominent ces histoires de crimes et de suicides qui se déroulent le plus souvent dans l’intimité familiale et domestique de l’habitat collectif ou dans le huis clos des entreprises de nos contemporains. Un romanesque sordide, une réalité abominable, des situations obscènes qui seraient insupportables sans l’ironie souvent grinçante de l’écrivain et son sens aigu de la dérision. Une satire de la condition humaine qui ne tempère pas toujours l’outrance du propos. Dans « Auges caritatives » par exemple : « De nos jours, les malheureux pullulent comme jamais depuis la crise de 1929. Toutefois, nourris aux auges caritatives, ils ont bonne mine et bon sang tant que les nuits d’hiver à la belle étoile n’ont pas éreinté leur organisme au point de ne générer plus qu’une sève cadavérique dont ne voudrait pas une chauve-souris. » Le trait est tout aussi mordant dans « Contrebalancer nos garçons » : « Ma mère n’est pas morte, mais elle a le regard vague depuis son attaque et à chaque fois que je la vois je ne peux m’empêcher de fixer longuement ses mollets en me demandant lequel de ses pieds a déjà disparu dans la tombe. » Autre pépite fielleuse : « Dans notre famille nous 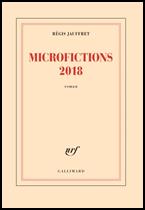 avons le cœur maigre. Le peu de générosité dont nous nous targuons est imaginaire. Les billets de cinquante euros que nous donnons à la quête sont des photocopies. Nous serions des imbéciles de ne pas profiter de la naïveté du curé de Saint-Philippe-du-Roule qui n'équipe pas ses quêteurs de détecteurs de faux comme il en existe à Notre-Dame et à la Sainte-Chapelle. avons le cœur maigre. Le peu de générosité dont nous nous targuons est imaginaire. Les billets de cinquante euros que nous donnons à la quête sont des photocopies. Nous serions des imbéciles de ne pas profiter de la naïveté du curé de Saint-Philippe-du-Roule qui n'équipe pas ses quêteurs de détecteurs de faux comme il en existe à Notre-Dame et à la Sainte-Chapelle.
– Nos enfants seront pingres. » (dans « Fricassée de virus »).
Il se plaît à user dans ses propos du tiret conclusif (ou oppositif) qui annonce une conclusion, un nouvel éclairage ou renforce l’argumentaire. Justement, ici, l’écriture est sublimée, truffée de vocables désuets et constellée de métaphores. « Rien ne se passe comme dans les contes, avertit-il (« Pleurer des bulles »), l’imagination est une menteuse et la réalité une condamnation à perpétuité. » Quel style cultive cet écrivain-là ! L’élégance semble lui venir toute seule.
Régis Jauffret en 2017 © Photo Francesca Mantovani
éditions Gallimard
- Microfictions, par Régis Jauffret, éditions Gallimard, Collection Blanche, 1040 pages, 2007 ;
- Microfictions 2018, par R. Jauffret, éd. Gallimard, col. Blanche, 1024 pages, 2018.
Varia : vedette des herbes marines, la posidonie de Méditerranée
 « La vedette de ces grandes herbes marines, c’est la posidonie de Méditerranée. Cette espèce qui appartient bel et bien aux plantes à fleurs forme d’immenses peuplements. Certes, elle ne couvre que 3% de la surface de la Grande Bleue, mais c’est elle qui en constitue l’écosystème majeur. Les herbiers de posidonies fournissent le gîte et le couvert à d’innombrables organismes et assurent une protection essentielle contre l’érosion des côtes. Sans insectes à séduire, plus besoin de couleurs ni de parfums. Ce végétal fleurit discrètement en automne les années où l’eau est assez chaude. Ses fruits flottants appelés olives de mer se détachent au printemps suivant. En se décomposant, ils libèrent une graine unique qui coule et peut-être, avec beaucoup de chance, qui prendra racine sur le fond. « La vedette de ces grandes herbes marines, c’est la posidonie de Méditerranée. Cette espèce qui appartient bel et bien aux plantes à fleurs forme d’immenses peuplements. Certes, elle ne couvre que 3% de la surface de la Grande Bleue, mais c’est elle qui en constitue l’écosystème majeur. Les herbiers de posidonies fournissent le gîte et le couvert à d’innombrables organismes et assurent une protection essentielle contre l’érosion des côtes. Sans insectes à séduire, plus besoin de couleurs ni de parfums. Ce végétal fleurit discrètement en automne les années où l’eau est assez chaude. Ses fruits flottants appelés olives de mer se détachent au printemps suivant. En se décomposant, ils libèrent une graine unique qui coule et peut-être, avec beaucoup de chance, qui prendra racine sur le fond.
« Dans l’eau, les posidonies ont réappris à absorber les nutriments par les feuilles. Le dense treillis formé par leurs rhizomes ligneux stabilise les pentes sableuses. Des espaces entre leurs cellules permettent des échanges gazeux entre feuilles, tiges et racines… Que de belles adaptations ! Dommage qu’elles régressent pour de multiples raisons au fur et à mesure que se développent les activités humaines.
« Ceintures vertes
« Contrairement aux posidonies qui n’existent qu’en Méditerranée et au sud de l’Australie, les zostères fleurissent dans la plupart des mers du monde… quoique leurs fleurs verdâtres soient réduites au strict minimum. Ces plantes aquatiques forment également des herbiers très riches en biodiversité. On en trouve aussi bien dans la Grande Bleue que sur le littoral atlantique. En grec, zostère veut dire ceinture, allusion à la forme de ses longues feuilles.
« 80 000 à 200 000 ans
« C’est l’âge estimé d’un gigantesque individu de posidonie découvert en 2006 grâce à des marqueurs génétiques. Avec son réseau de racines, ce plant colonial s’étend sur plus de 8 km entre les îles d’Ibiza et de Formentera dans les Baléares. Ce serait l’un des plus grands êtres vivants connus.
« Comme une forêt
« Les herbiers de posidonies sont colonisés à tous les étages par d’autres plantes et par de nombreux animaux. C’est une pouponnière pour plein de poissons. L’un des habitants les plus visibles de ces forêts qui s’étendent de 1 à 40 m de profondeur est la saupe, un herbivore rayé qui se déplace en bancs placides. »
Extraits de « Planète algue », un dossier de Julien Perrot avec Nathalie Tordjman et Sacha Bollet, issu de la revue Salamandre, n° 260, octobre-novembre 2020, éditions de la Salamandre, Neuchâtel (Suisse), 66 pages.
Carnet : Remonte-moi !
Quel délice cette pâtisserie ! C’est une ancienne recette toscane qui voulait qu’aux convalescents on serve un jaune d’œuf battu avec du sucre auquel on ajoutait un peu de café et quelques gouttes d’alcool. Signifiant littéralement « remonte-moi le moral » ou « tire-moi vers le haut », le « tiramisù » impose néanmoins l’ajout de deux autres spécialités transalpines : le pan di spagna et le mascarpone. Le premier est une génoise typique qu’on peut remplacer par des biscuits à la cuillère ; le mascarpone, quant à lui, est le roi des fromages frais italiens.
L’épée et le tire-bouchon
L’épée pour les ennemis, le tire-bouchon pour les amis. (Léonce Bourliaguet, De sel et de poivre, éditions Magnard, 1963)
(Mercredi 13 avril 2022)
Égalité
« Le défaut de l’égalité, c’est que nous ne le voulons qu’avec nos supérieurs. » (Henry Becque [1837-1899], Notes d’album, 1837-1899)
Morale
Patron pêcheur et technicien à l’Aéropostale, mon beau-père, Hippolyte Blanchard, était un sage. Ainsi savait-il qu’il ne faut jamais paraître plus doué que les autres. Car on vous pardonne plus volontiers vos faiblesses. De surcroît, cela grandit votre entourage.
(Jeudi 14 avril 2022)
L’économie du bonheur
L’économie inquiète tout le monde, mais n’intéresse personne. « On évalue la richesse d’un pays à son PIB, convient Jacques Marseille (1945-2010), le produit intérieur brut. Je plaide pour un autre "agrégat" de la comptabilité nationale : le BNB, le "bonheur national brut". » Apparu durant les années 50 en France, le PIB n’est pas la mesure idéale du progrès. L’historien et économiste privilégie l’IDH, l’indice de développement humain, plus pertinent et calculé par la Banque mondiale, parce qu’il prend en compte la scolarisation et l’espérance de vie.
(Mercredi 20 avril 2022)
|
Billet d’humeur
La croix des princes
Aux XIIe et XIIIe siècles, les comtes de Toulouse comptent parmi les princes les plus puissants du royaume. Le revers de leurs sceaux qui fixe l’identité politique et sociale bâtie par les sigillants (ceux que le sceau représente) les montre comme des chefs de guerre armés, des princes chevaliers lancés au galop contre leur ennemi, d’authentiques souverains ; l’avers, qui les représente en majesté, c’est-à-dire trônant avec les attributs symboliques de leur pouvoir, est singulier parce que cette figuration était jalousement dévolue aux rois. Dès la seconde moitié du XIe siècle, les comtes de Toulouse préconisent d’inscrire une croix sur leurs blasons, celle qu’ils avaient prise en prenant part à la première croisade en Terre sainte. Universellement connue comme la « croix occitane », fièrement arborée par la famille du peintre Toulouse-Lautrec et actuel emblème de la région Occitanie, cette croix était au Moyen Âge le signe concret du culte voué par les comtes de Toulouse à la relique de la sainte Croix, dont la cité d’Avignon conservait un irremplaçable fragment. La dynastie raymondine disposait avec cet insigne d’un lien fort et privilégié avec le sacré, profondément enraciné dans un vaste territoire qu’elle disputait fièrement au roi d’Aragon. Porteuse d’une signification mémorielle et identitaire forte, la croix raimondenque signifiait aux voisins du comté les prétentions territoriales, politiques et idéologiques d’une lignée princière qui disparut avec l’intégration de ses terres au royaume de France entre 1226 et 1249. Il est resté la majesté, la fierté des comtes raymondins et surtout leur croix, un des plus précieux joyaux du patrimoine historique et culturel de notre pays.
|
Lecture critique
La droite extrême en France, des Bourbons aux Le Pen
Descendants de Louis XVI, les Bourbons ont longtemps porté en France les espoirs d’une droite dure et extrême, qui croyait possible le retour à l’ordre politique et social d’avant la Révolution. La proclamation de la IIIe République en 1870 a compromis l’éventualité d’une restauration monarchique. Une décennie plus tard, les nostalgiques de l’Ancien Régime célébrent l’avènement du nationalisme à l’extrême droite de l’échiquier politique. Un général qui sera ministre de la Guerre, Georges Boulanger, bouscule les assises de la Troisième République en réunissant, dans un mouvement, monarchistes, bonapartistes, républicains nationalistes et socialistes révolutionnaires. Élu député à plusieurs reprises, le général Boulanger est accusé par le gouvernement d’atteinte à la sûreté de l’État en avril 1889. Exilé en Belgique, il met fin à ses jours le 30 septembre 1891, à l’âge de 54 ans. Moins de dix ans plus tard, les nationalistes se retrouvent aux premiers rangs de la campagne antidreyfusarde, mais le mouvement reste hétéroclite avec ses catholiques traditionalistes, ses antisémites et ses nationalistes. Fondé en 1898, le comité d’Action française entend défendre la cause catholique et appelle à la restauration de la monarchie : fils d’un percepteur martégal, le journaliste Charles Maurras est l’un des plus fervents théoriciens et propagandistes du nationalisme intégral. Entre les deux guerres mondiales, les idées fascistes se propagent allègrement parmi certains groupements qui rêvent de renverser la République par la force. Le gouvernement de Vichy adopte certaines mesures préconisées par l’extrême droite qui se trouvera, à la Libération, sévèrement déconsidérée. La guerre d’Algérie permet à la mouvance nationaliste de ressurgir avec Pierre Poujade qui se prévaut de défendre les petits artisans, boutiquiers et paysans contre les contrôles fiscaux. Du même coup, l’ancien papetier de Saint-Céré reprend les thématiques chères aux ligues nationalistes de l’entre-deux-guerres dont l’antiparlementarisme, le  complotisme et la xénophobie. « Le déclin de l’audience de l’extrême droite apparaît crûment en 1965, observe Jean-Étienne Dubois dans son livre « L’Extrême Droite française, de 1880 à nos jours », lors de la première élection présidentielle au suffrage universel direct. Jean-Louis Tixier-Vignancour, ancien député nationaliste et avocat de plusieurs dirigeants de l’Organisation armée secrète (OAS), entend regrouper sur sa candidature toutes les voix de ceux qui reprochent au président de la République son abandon de l’empire colonial et sa supposée complaisance envers les communistes. […] Mais malgré une active campagne, dirigée par Jean-Marie Le Pen, il n’obtient que 1,2 million de voix, soit 5 % des suffrages exprimés. Cet échec est sans appel : les militants et les idées de l’extrême droite d’avant-guerre ont fait leur temps et ne correspondent plus aux aspirations d’une société française en mutation rapide. » À partir des années 1980-1990, l’histoire de l’extrême droite française tend à se confondre avec celle du Front national (FN) qui a été créé en 1972 sous la présidence de Jean-Marie Le Pen (sa fille Marine lui succédera en 2011). Après des résultats électoraux mitigés, le FN réalise une percée remarquée en 1984 en récoltant 2,2 millions de voix, soit 11 % des suffrages exprimés, aux élections européennes. Aux scrutins suivants, le FN confirme sa réussite servie jusqu’alors, semble-t-il, par la crise économique et sociale apparue dès 1974, la politique libérale menée par la gauche et la droite dites « de gouvernement » et un discours électoral inlassablement répété qui fustige les immigrés, boucs émissaires en l’occurrence, rendus responsables du chômage et de l’insécurité. « Depuis la fin du XIXe siècle, estime Jean-Étienne Dubois, les nationalistes français partagent une même conception de la "nation" : non pas celle d’une communauté politique composée de citoyens ayant des droits égaux mais celle d’une communauté ethnique et/ou culturelle menacée par des ennemis extérieurs (Allemagne, mouvements anticoloniaux, Union européenne, mondialisation…) ou intérieurs (Parlement, Juifs, francs-maçons, communistes, immigrés, musulmans…). » Certes, l’origine, la descendance et la transmission restent parmi les enjeux fondamentaux du RN (Rassemblement national, dénommé Front national jusqu’en 2018), mais c’est toujours en réaction contre l’État républicain qu’il réactive les plus virulentes de ses mobilisations nationalistes. complotisme et la xénophobie. « Le déclin de l’audience de l’extrême droite apparaît crûment en 1965, observe Jean-Étienne Dubois dans son livre « L’Extrême Droite française, de 1880 à nos jours », lors de la première élection présidentielle au suffrage universel direct. Jean-Louis Tixier-Vignancour, ancien député nationaliste et avocat de plusieurs dirigeants de l’Organisation armée secrète (OAS), entend regrouper sur sa candidature toutes les voix de ceux qui reprochent au président de la République son abandon de l’empire colonial et sa supposée complaisance envers les communistes. […] Mais malgré une active campagne, dirigée par Jean-Marie Le Pen, il n’obtient que 1,2 million de voix, soit 5 % des suffrages exprimés. Cet échec est sans appel : les militants et les idées de l’extrême droite d’avant-guerre ont fait leur temps et ne correspondent plus aux aspirations d’une société française en mutation rapide. » À partir des années 1980-1990, l’histoire de l’extrême droite française tend à se confondre avec celle du Front national (FN) qui a été créé en 1972 sous la présidence de Jean-Marie Le Pen (sa fille Marine lui succédera en 2011). Après des résultats électoraux mitigés, le FN réalise une percée remarquée en 1984 en récoltant 2,2 millions de voix, soit 11 % des suffrages exprimés, aux élections européennes. Aux scrutins suivants, le FN confirme sa réussite servie jusqu’alors, semble-t-il, par la crise économique et sociale apparue dès 1974, la politique libérale menée par la gauche et la droite dites « de gouvernement » et un discours électoral inlassablement répété qui fustige les immigrés, boucs émissaires en l’occurrence, rendus responsables du chômage et de l’insécurité. « Depuis la fin du XIXe siècle, estime Jean-Étienne Dubois, les nationalistes français partagent une même conception de la "nation" : non pas celle d’une communauté politique composée de citoyens ayant des droits égaux mais celle d’une communauté ethnique et/ou culturelle menacée par des ennemis extérieurs (Allemagne, mouvements anticoloniaux, Union européenne, mondialisation…) ou intérieurs (Parlement, Juifs, francs-maçons, communistes, immigrés, musulmans…). » Certes, l’origine, la descendance et la transmission restent parmi les enjeux fondamentaux du RN (Rassemblement national, dénommé Front national jusqu’en 2018), mais c’est toujours en réaction contre l’État républicain qu’il réactive les plus virulentes de ses mobilisations nationalistes.
- L’Extrême Droite française, de 1880 à nos jours, par Jean-Étienne Dubois, Presses universitaires Blaise Pascal, collection l’opportune, Clermont-Ferrand, 64 pages, 2018.
Portrait
John Muir, un des pionniers de l’écologie
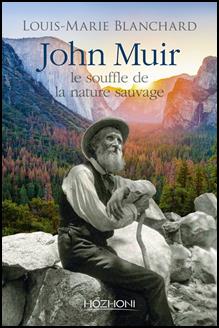
On retient de John Muir (Dunbar, 21 avril 1838-Los Angeles, 24 décembre 1914) l’initiative, déterminante, d’avoir œuvré dès 1864 à la création du premier parc de Yellowstone. Par une loi du 1er mars 1872, le Congrès transformait 888 718 hectares des montagnes Rocheuses - situées en majeure partie dans l’État de Wyoming mais également dans le Montana et l’Idaho - « en parc public, en terrain d’agrément pour le bénéfice et le plaisir de la population ». Très tôt, l’écrivain et naturaliste cherche à répandre auprès des décideurs, des politiques et de l’opinion l’idée selon laquelle la préservation de la nature procède d’un impérieux devoir, mieux d’une nécessité vitale. Il trouve dans le système américain des parcs nationaux un des instruments susceptibles de concourir à la sauvegarde des forêts ainsi que de la flore et de la faune. Il participe ainsi à la fondation du Parc national de Yosemite, en 1890, dans le massif de la Sierra Nevada, à l’est de la Californie.
« S’immerger dans la nature sauvage »
Né en 1838 en Écosse, il émigre à 11 ans avec sa famille et connaît l’adolescence âpre d’un fils de fermier du Wisconsin. Il est le troisième des huit enfants, trois garçons et cinq filles, nés de Daniel Muir (natif de Manchester), sergent-recruteur pour l’armée puis marchand de grains et de fourrage, et d’Anne Gilrye (de parents écossais). La rigueur presbytérienne de l’éducation familiale l’aguerrit à mépriser toute fatigue et à supporter les épreuves imposées par un quotidien réglé par la discipline paternelle et l’observance calviniste. À 22 ans, il intègre pour quatre ans l’université de Madison où il se perfectionne en mathématiques, physique, chimie et géologie avec l’idée de s’orienter vers la médecine. Le désir de rejoindre son frère Daniel qui s’est réfugié au Canada pour échapper à la conscription imposée par la guerre de Sécession le conduit à sillonner les forêts, sa presse à plantes sur le dos, autour des Grands Lacs Huron et Ontario. « Son projet est de marcher droit devant lui, explique son biographe Louis-Marie Blanchard dans "John Muir - Le souffle de la nature sauvage", et de s’immerger le plus possible dans la nature sauvage, dans l’esprit de ces chercheurs de route que sont Douglas [David], Mackenzie [Alexander] et surtout Humboldt [Alexander von], dont les récits ont tant alimenté son imagination. » En septembre 1867, il traverse les États-Unis de part en part, le plus souvent à pied (il marche jusqu’à 80 kilomètres par jour), il observe la vie sauvage, oiseaux et mammifères des bois, et s’émerveille de la splendeur végétale. Il herborise à Chicago et séjourne dans le port de New York sans oser gagner Central Park de peur de s’y perdre ! En 1874, il rencontre la fille d’un immigrant polonais révolutionnaire, Louie Wanda Strentzel (1847-1905), qu’il épousera en 1880 et qui lui donnera deux filles, Wanda (née en 1881) et Helen (1886). Habitant la petite ville de Martinez, dans la vallée de l’Alhambra, située au nord-est d’Oakland, le couple y aménage et gère un ranch dédié à la viticulture et à l’arboriculture fruitière.
« Attacher mon chariot à une étoile »
John Muir a vécu la plus grande partie de sa vie en Californie. Un de ses premiers combats fut la préservation des séquoias géants voués à être débités en allumettes à compter de 1850. Dans les sierras californiennes, il déplore la spoliation des populations indiennes dont les ascendants, chasseurs-cueilleurs et agriculteurs amérindiens, ont préservé les lieux en façonnant la nature sauvage.  Le scientifique expérimente également le rôle des glaciers dans la formation si singulière des reliefs du Yosemite. Le naturaliste convertit à son action le président Théodore Roosevelt avec lequel il réalise une escapade de trois jours au cœur du parc de Yosemite, « bivouaquant en plein air autour d’un feu et se réveillant au petit matin sous quelques centimètres de neige »… L’écrivain se révèle dans « Quinze cents kilomètres à pied à travers l’Amérique profonde : 1867-1869 » : « J’ai déjà vu des chênes de bien des espèces, dans différents types de sol et diverses expositions, mais ceux du Kentucky dépassent en majesté tous ceux que j’ai pu rencontrer. Ils sont vastes, touffus et d’un vert éclatant. Entre les berceaux de feuillage et les cavernes de leurs longues branches se nichent de superbes poches d’ombre, et chaque arbre paraît doté d’une double ration de vie puissante, exubérante. » Il écrit tout en marchant dans un carnet dont il illustre les notes et pensées de croquis de plantes et de paysages. Ses observations sont frappées de pertinence et de poésie, le propos est porté par un ample souffle lyrique tandis que les dessins balancent entre académisme et fantaisie. En 1893, alors qu’il est en route pour l’Europe avec son ami le peintre William Keith, John Muir fait étape à Concord, dans le Massachussetts, où il va se recueillir sur les tombes d’Henry David Thoreau et de Ralph Waldo Emerson. Ce dernier qu’il a rencontré est son maître à penser : « C’est le séquoia de l’espèce humaine, dira-t-il, j’ai suivi son conseil : attacher mon chariot à une étoile ». Le scientifique expérimente également le rôle des glaciers dans la formation si singulière des reliefs du Yosemite. Le naturaliste convertit à son action le président Théodore Roosevelt avec lequel il réalise une escapade de trois jours au cœur du parc de Yosemite, « bivouaquant en plein air autour d’un feu et se réveillant au petit matin sous quelques centimètres de neige »… L’écrivain se révèle dans « Quinze cents kilomètres à pied à travers l’Amérique profonde : 1867-1869 » : « J’ai déjà vu des chênes de bien des espèces, dans différents types de sol et diverses expositions, mais ceux du Kentucky dépassent en majesté tous ceux que j’ai pu rencontrer. Ils sont vastes, touffus et d’un vert éclatant. Entre les berceaux de feuillage et les cavernes de leurs longues branches se nichent de superbes poches d’ombre, et chaque arbre paraît doté d’une double ration de vie puissante, exubérante. » Il écrit tout en marchant dans un carnet dont il illustre les notes et pensées de croquis de plantes et de paysages. Ses observations sont frappées de pertinence et de poésie, le propos est porté par un ample souffle lyrique tandis que les dessins balancent entre académisme et fantaisie. En 1893, alors qu’il est en route pour l’Europe avec son ami le peintre William Keith, John Muir fait étape à Concord, dans le Massachussetts, où il va se recueillir sur les tombes d’Henry David Thoreau et de Ralph Waldo Emerson. Ce dernier qu’il a rencontré est son maître à penser : « C’est le séquoia de l’espèce humaine, dira-t-il, j’ai suivi son conseil : attacher mon chariot à une étoile ».
John Muir (à droite) et son ami l’écrivain naturaliste John Burroughs,
en excursion dans les collines Castkills, au sud des monts Adirondacks,
dans l’État de New York, en 1912.
Akg-Images/Science Source © Droits réservés
- John Muir - Le souffle de la nature sauvage, par Louis-Marie Blanchard, éditions Hozhoni, 272 pages, 2021 ;
- Quinze cents kilomètres à pied à travers l’Amérique profonde, par John Muir, traduit de l’américain par André Fayot, éditions José Corti, 160 pages, 2006.
Varia : des Polonais en équipe de France de football
« Les Polonais arrivent en France alors que le football est en plein essor. […] Dans les cités minières, des bandes se retrouvent pour "jouer au foot". Bien vite apparaissent des équipes polonaises : Cracovia Avion, Gwiazda Lens, KS Pogon Auchel, Océan Calonne-Ricouart et Urania Nœux-les-Mines, entre autres. […]
« Le premier footballeur polonais à intégrer l’équipe de France en 1935, Ignace Kowalczyk, communément appelé Ignace, est né en 1913 en Rhénanie-Westphalie, et a suivi ses parents qui se sont installés dans le bassin minier de Lens. Thadée (Tadeusz) Cisowski, né en 1927 à Laski, en Pologne, a rejoint à l’âge de neuf ans son père à Piennes, en Lorraine occidentale, où ce dernier avait été embauché à la mine de fer de La Mourière. À 14 ans, lui-même descend au fond mais, brillant footballeur amateur, il est recruté par le club de Metz en 1947, avant d’être sélectionné en équipe de France.
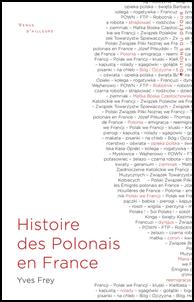 L’exemple le plus célèbre et souvent cité demeure celui de la cité du Chemin perdu, à Nœux-les-Mines, où le jeune Raymond Kopaszewski fourbit ses premières armes, à la fin des années 1930. Son père y est arrivé avec son grand-père en 1919. Né en 1931, il doit faire, à partir de ses 14 ans et, pendant deux ans et demi, le "galibot" (le manœuvre) au fond de la mine, où il perd une phalange à la suite d’un accident. Finalement, en 1949, il intègre l’équipe professionnelle d’Angers et devient Kopa. Son cas n’est pas unique. Une quinzaine de kilomètres plus loin, en allant vers Lens, naît à Avion en 1935, Théodore Szkudlapski, dit Théo, sélectionné deux fois en équipe de France, et descendu au fond de la mine à l’âge de 15 ans. Nous pourrions allonger la liste : Maryan Synakowski, dit Maryan, né en 1936 à Calonne-Ricouart, à côté de Lens, sélectionné plusieurs fois en équipe de France ; Maryan Wisnieski, né en 1937, lui aussi à Calonne, plusieurs fois international ; Robert Budzynski, né en 1940 dans la même commune, également international. Les trois sont nés dans la même rue. Nous arrêtons là notre énumération, non sans rappeler que, lors de la finale de la Coupe de France de 1948 qui oppose les clubs de Lille et Lens, sur les 22 joueurs, neuf sont d’origine polonaise. Un des plus grands entraîneurs français est le fils d’un Westphalien, né à Dortmund en 1914 : Jean (Jan) Snella, qui obtient plusieurs fois le titre de champion de France avec le club de Saint-Étienne. » L’exemple le plus célèbre et souvent cité demeure celui de la cité du Chemin perdu, à Nœux-les-Mines, où le jeune Raymond Kopaszewski fourbit ses premières armes, à la fin des années 1930. Son père y est arrivé avec son grand-père en 1919. Né en 1931, il doit faire, à partir de ses 14 ans et, pendant deux ans et demi, le "galibot" (le manœuvre) au fond de la mine, où il perd une phalange à la suite d’un accident. Finalement, en 1949, il intègre l’équipe professionnelle d’Angers et devient Kopa. Son cas n’est pas unique. Une quinzaine de kilomètres plus loin, en allant vers Lens, naît à Avion en 1935, Théodore Szkudlapski, dit Théo, sélectionné deux fois en équipe de France, et descendu au fond de la mine à l’âge de 15 ans. Nous pourrions allonger la liste : Maryan Synakowski, dit Maryan, né en 1936 à Calonne-Ricouart, à côté de Lens, sélectionné plusieurs fois en équipe de France ; Maryan Wisnieski, né en 1937, lui aussi à Calonne, plusieurs fois international ; Robert Budzynski, né en 1940 dans la même commune, également international. Les trois sont nés dans la même rue. Nous arrêtons là notre énumération, non sans rappeler que, lors de la finale de la Coupe de France de 1948 qui oppose les clubs de Lille et Lens, sur les 22 joueurs, neuf sont d’origine polonaise. Un des plus grands entraîneurs français est le fils d’un Westphalien, né à Dortmund en 1914 : Jean (Jan) Snella, qui obtient plusieurs fois le titre de champion de France avec le club de Saint-Étienne. »
Extraits de « Histoire des Polonais en France », de Yves Frey, éditions du Détour, 218 pages, 2019.
Carnet : vocabulaire de l’extrême
Il faut se méfier des mots colportés par les tribuns de certaines officines. Ceux-là ne remplacent-ils pas désormais le nauséabond référent à la pureté raciale par celui d’« identité culturelle » ou de « préférence nationale » ? Quand ils ne prônent pas le « droit à la différence » pour masquer leur aspiration à justifier l’« anti-égalitarisme ». Travail de mots, travail de sape qui détournent lentement mais sûrement les principes républicains de leur sens.
Les ratés du management
Dans un de ses fameux ouvrages - Au-delà du capitalisme, publié par Dunod en 1993 -, le journaliste et professeur Peter Drucker (1909-2005) fait un aveu qui étonne : « Bien qu’adepte du libre-marché, écrit-il, j’éprouve certaines réserves vis-à-vis du capitalisme ». En fait, au début des années 90, le théoricien américain du management d’entreprise avait été profondément marqué par la vague de « dégraissages » massifs décidés par IBM, General Motors ou Sears Holdings. « L’entreprise, bâtie naguère pour durer autant que les pyramides, ressemble maintenant plutôt à une tente », commentait-il avec beaucoup d’amertume.
Placement avec intérêts
« On place ses éloges comme on place de l’argent, pour qu’ils nous soient rendus avec les intérêts. (Jules Renard, Journal 1887-1910, Nrf Pléiade, 18 mars 1890)
De l’évasion fiscale
La sémantique est un système de signification qui ne sert pas toujours les causes les plus nobles. Ainsi en est-il de l’évasion fiscale, si décriée de nos jours, à laquelle on se plaît à substituer le syntagme « optimisation fiscale », comme on l’enseigne dans nos écoles de commerce.
(Jeudi 12 mai 2022)
|
Billet d’humeur
Le mythe du cœlacanthe
Identifié pour la première fois en 1938 en Afrique du Sud, à l’embouchure du fleuve Chalumna d’où un pêcheur l’avait remonté dans ses filets, ce poisson a longtemps été qualifié de « fossile vivant ». L’oxymore avait été forgé par le naturaliste Charles Darwin pour désigner des espèces paraissant n’avoir pas évolué depuis des millions d’années « pour avoir vécu dans des zones confinées et, de ce fait, avoir été exposées à une compétition moins sévère ». En vérité, le cœlacanthe (Latimeria chalumnae) appartient à un groupe de poissons qui, avec leurs nageoires charnues, sont considérés comme proches des vertébrés terrestres, voire comme les pères des tétrapodes, animaux munis de quatre pattes se terminant par des doigts. L’espèce semblait éteinte depuis le crétacé, il y a 70 millions d’années, où elle aurait disparu avec les dinosaures. On a cru que cet hôte des grottes sous-marines était un des précieux chaînons à la croisée des chemins de l’histoire et de la biologie, lorsqu’il y a plus de 360 millions d’années, les vertébrés se divisèrent en deux groupes, ceux qui restèrent sous l’eau et ceux qui allèrent sur terre. Aujourd’hui, les paléontologues et biologistes marins réfutent la notion de fossile vivant pour le cœlacanthe, une qualification abusivement entretenue par des revues scientifiques à grand spectacle. Des biologistes français de l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) tentent aujourd’hui d’établir son cycle de vie à partir de l’étude de ses écailles. Sous une lumière polarisée, des cernes quasiment invisibles de structures calcifiées y apparaissent. La comparaison d’une trentaine de spécimens de tailles différentes a permis aux chercheurs français de déterminer l’âge de l’animal en fonction de ces cernes. Comme pour les cernes des arbres, chaque année passée laisse une strie visible au microscope sur les écailles. Au nombre des hypothèses les plus vraisemblables, ils soutiennent que le cœlacanthe pourrait vivre plus de cent ans, que sa maturité sexuelle interviendrait entre 40 et 69 ans, et que la gestation pourrait durer cinq ans. En danger critique d’extinction selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, le cœlacanthe vit aujourd’hui dans l’océan Indien, le canal du Mozambique et en Indonésie. La connaissance accrue du génome de ce mastodonte de deux mètres pour un poids maximal de 110 kilos pourrait ouvrir de nouveaux horizons à la recherche scientifique des abysses.
|
Lecture critique
Trois jours et trois nuits à l’abbaye de Lagrasse
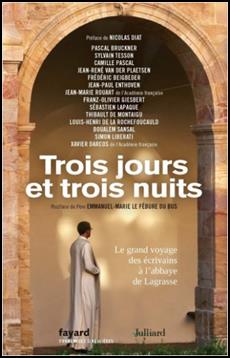 Démarche de bienveillance ou d’humilité, avec sans doute un tant soit peu de curiosité, quatorze écrivains ont accepté de séjourner trois jours et trois nuits à l’abbaye de Lagrasse, dans les Corbières, entre Narbonne et Carcassonne. Le compte rendu de leur séjour monacal serait publié et les droits de chacun des contributeurs versés à la restauration de l’abbatiale reconstruite par Charlemagne au début du VIIIe siècle. L’initiative due à Nicolas Diat (Saint-Amand-Montrond, 1975), éditeur et essayiste, a donné l’occasion à ces littérateurs d’inspiration très différente de livrer leur sentiment sur la retraite spirituelle vécue aux côtés des quarante-deux chanoines qui suivent à Lagrasse la règle de saint Augustin sous la férule de l’abbé Emmanuel-Marie Le Fébure du Bus. « Avec les moines, avoue l’un des "retraités", Frédéric Beigbeder, je suis si influençable qu’il me pousse une capuche dans le dos. Chantez-moi les vêpres en grégorien et je m’agenouille ; la ferveur est contagieuse. […] La génuflexion guérit de la prétention. » « Mécréant, ethnologue d’occasion, je tente aussitôt, explique Jean-Paul Enthoven, de suivre les sept offices qui rythment la vie quotidienne de l’abbaye. Matines, laudes, tierce, sexte, none, vêpres, complies, se succèdent devant ma curiosité de sceptique. » « Ce qui me plaît tant chez les religieux et les religieuses, soutient Louis-Henri de La Rochefoucauld, c’est leur esprit d’enfance. Commentant le psaume 112, saint Augustin notait : "Comme il n’y a que les enfants pour louer le Seigneur, puisque les superbes ne savent point le louer, ayez une vieillesse enfantine et une enfance déjà mûre." » Quant à Boualem Sansal, il rappelle avec raison que jadis « les frontières entre les trois religions monothéistes n’étaient pas si étanches ni si étroitement surveillées, comme elles le sont de nos jours, les enfants passaient en bandes entremêlées d’un culte à l’autre, d’une fête à l’autre, et goûtaient à toutes les cuisines de tous leurs doigts sans que les adultes et les parents y trouvassent à redire. » De son côté, Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, a découvert que « l’harmonie des lieux exerce d’étranges correspondances avec l’harmonie intérieure qui éclaire les chanoines. On est frappé par leur douceur, leur gentillesse, leur sourire, comme s’ils avaient purgé en eux les poisons qui animent nos existences survoltées : l’ambition, la soif de paraître, la jalousie, tous ces appétits qui nous rongent, car on ne peut ni les satisfaire ni les apaiser. Le spirituel semble avoir chassé de leur cœur tout ce qui n’est pas indispensable à la vie de l’esprit. » Quelque temps après le séjour des écrivains à l’abbaye de Lagrasse, il revenait à l’abbé Le Fébure du Bus d’émettre une sorte de conclusion à l’initiative : « Le dialogue avec les écrivains s’est fait sur le terrain de la beauté, s’est-il félicité. Les cœurs, les sensibilités, les intelligences même se rejoignent alors, à la fois très rapidement et à un niveau élevé. La beauté architecturale, celle de la liturgie, des chants, touchent. Beaucoup de vérités ne se communiquent que par ces expériences-là, aptes à faire passer l’indicible, sur des "longueurs d’onde" portées par les symboles, sous une forme de poésie dont la vie religieuse et sa liturgie ont gardé le secret. » Démarche de bienveillance ou d’humilité, avec sans doute un tant soit peu de curiosité, quatorze écrivains ont accepté de séjourner trois jours et trois nuits à l’abbaye de Lagrasse, dans les Corbières, entre Narbonne et Carcassonne. Le compte rendu de leur séjour monacal serait publié et les droits de chacun des contributeurs versés à la restauration de l’abbatiale reconstruite par Charlemagne au début du VIIIe siècle. L’initiative due à Nicolas Diat (Saint-Amand-Montrond, 1975), éditeur et essayiste, a donné l’occasion à ces littérateurs d’inspiration très différente de livrer leur sentiment sur la retraite spirituelle vécue aux côtés des quarante-deux chanoines qui suivent à Lagrasse la règle de saint Augustin sous la férule de l’abbé Emmanuel-Marie Le Fébure du Bus. « Avec les moines, avoue l’un des "retraités", Frédéric Beigbeder, je suis si influençable qu’il me pousse une capuche dans le dos. Chantez-moi les vêpres en grégorien et je m’agenouille ; la ferveur est contagieuse. […] La génuflexion guérit de la prétention. » « Mécréant, ethnologue d’occasion, je tente aussitôt, explique Jean-Paul Enthoven, de suivre les sept offices qui rythment la vie quotidienne de l’abbaye. Matines, laudes, tierce, sexte, none, vêpres, complies, se succèdent devant ma curiosité de sceptique. » « Ce qui me plaît tant chez les religieux et les religieuses, soutient Louis-Henri de La Rochefoucauld, c’est leur esprit d’enfance. Commentant le psaume 112, saint Augustin notait : "Comme il n’y a que les enfants pour louer le Seigneur, puisque les superbes ne savent point le louer, ayez une vieillesse enfantine et une enfance déjà mûre." » Quant à Boualem Sansal, il rappelle avec raison que jadis « les frontières entre les trois religions monothéistes n’étaient pas si étanches ni si étroitement surveillées, comme elles le sont de nos jours, les enfants passaient en bandes entremêlées d’un culte à l’autre, d’une fête à l’autre, et goûtaient à toutes les cuisines de tous leurs doigts sans que les adultes et les parents y trouvassent à redire. » De son côté, Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, a découvert que « l’harmonie des lieux exerce d’étranges correspondances avec l’harmonie intérieure qui éclaire les chanoines. On est frappé par leur douceur, leur gentillesse, leur sourire, comme s’ils avaient purgé en eux les poisons qui animent nos existences survoltées : l’ambition, la soif de paraître, la jalousie, tous ces appétits qui nous rongent, car on ne peut ni les satisfaire ni les apaiser. Le spirituel semble avoir chassé de leur cœur tout ce qui n’est pas indispensable à la vie de l’esprit. » Quelque temps après le séjour des écrivains à l’abbaye de Lagrasse, il revenait à l’abbé Le Fébure du Bus d’émettre une sorte de conclusion à l’initiative : « Le dialogue avec les écrivains s’est fait sur le terrain de la beauté, s’est-il félicité. Les cœurs, les sensibilités, les intelligences même se rejoignent alors, à la fois très rapidement et à un niveau élevé. La beauté architecturale, celle de la liturgie, des chants, touchent. Beaucoup de vérités ne se communiquent que par ces expériences-là, aptes à faire passer l’indicible, sur des "longueurs d’onde" portées par les symboles, sous une forme de poésie dont la vie religieuse et sa liturgie ont gardé le secret. »
- Trois jours et trois nuits, avec Pascal Bruckner, Sylvain Tesson, Camille Pascal, Jean-René van der Plaetsen, Frédéric Beigbeder, Jean-Paul Enthoven, Jean-Marie Rouart, Franz-Olivier Giesbert, Sébastien Lapaque, Thibault de Montaigu, Louis-Henri de La Rochefoucauld, Boualem Sansal, Simon Liberati et Xavier Darcos, préface de Nicolas Diat, postface du père Emmanuel-Marie Le Fébure du Bus, librairie Arthème Fayard/éditions Julliard, 360 pages, 2021.
Portrait
Marcel Conche :
« La philosophie a sa source dans la poésie »
Héraclite, Parménide et Anaximandre sont, avec Épicure, les hôtes permanents du petit bureau de la Maisonneuve, un hameau écarté d’Altillac, cité limousine et natale de Marcel Conche. Le philosophe et métaphysicien l’écrit dans un récit autobiographique « Épicure en Corrèze » : « Avec eux, ce qui est présent, c’est la Nature. C’est elle qu’ils m’aident à penser, grâce à un étonnement initial, une naïveté première ; non à partir de mots conceptuels aux significations réduites par les définitions mais des mots encore vivants du langage mi-commun, mi-poétique. La Nature est le Poète premier, ai-je souvent dit, et la philosophie a sa source dans la poésie. »
De la condition paysanne
Né le 27 mars 1922 à Altillac, il est l’enfant unique de Romain Conche, modeste éleveur et viticulteur élu maire du village en 1958, et de Marie-Louise Farges (mais on l’appelait Marcelle) qui décéda peu après l’accouchement.  Fils de paysan, il ne cache pas sa fierté d’avoir gardé les vaches en sabots ou sarmenté la vigne, retourné les foins et arraché les pommes de terre. Il a retenu de cette initiation champêtre une certaine idée de la solidarité et une compassion native à l’égard des humbles, goûtant peu les habitudes et la pratique religieuses de sa parentèle. De la communauté agricole corrézienne, il a jalousement conservé des mots et des expressions vernaculaires, se plaisant à expliquer que "noisiller" désigne une certaine façon de traiter les noix ; on prend le fruit entre le pouce et l’index et, avec un petit marteau, on le frappe délicatement de façon qu’il se fende en laissant les cerneaux intacts. Quand il parle des châtaignes "rascalées", il prend un évident plaisir à décrire la signification du terme : Cela veut dire que les châtaignes ont été cuites dans l’eau, puis décortiquées pour ôter la dernière peau, mises dans une marmite où on achève de les peler grâce aux mouvements de tourniquet faits à l’aide d’un instrument en forme de croix. Les châtaignes deviennent alors blanches, et on peut les servir. Commentant la fenaison, il énumère les opérations dès que son père a fini de manœuvrer la faucheuse : Après le fauchage, il faut étaler l’herbe, la laisser sécher, le retourner plusieurs fois par grand soleil. Ensuite, on l’assemble en tas appelés "finières", que l’on charge sur le chariot pour les transporter jusqu’à la grange, où l’on entrepose le foin au-dessus des mangeoires des vaches. « Mme de Sévigné s’est bien exprimée sur les charmes de la fenaison, observe-t-il aussitôt après. Je ne crois pas qu’elle-même ait jamais fané mais elle en parle de façon judicieuse. » Il dit aussi avoir pris part à la préparation du vin après les vendanges : Dans deux grandes cuves, on laisse la fermentation commencer, non sans l’accélérer en écrasant le raisin avec les pieds, ce qu’on appelle "froustir". On peut alors laisser le vin s’écouler, le recueillant dans des barriques, et ce qui reste dans la cuve part pour le pressoir. Et là, on obtient un autre vin, de moins bonne qualité. S’il reconnaît que le travail des champs l’a sûrement formé, il avoue s’y être beaucoup ennuyé parce qu’il le détournait de ce qu’il considérait comme son vrai travail, la philosophie. Fils de paysan, il ne cache pas sa fierté d’avoir gardé les vaches en sabots ou sarmenté la vigne, retourné les foins et arraché les pommes de terre. Il a retenu de cette initiation champêtre une certaine idée de la solidarité et une compassion native à l’égard des humbles, goûtant peu les habitudes et la pratique religieuses de sa parentèle. De la communauté agricole corrézienne, il a jalousement conservé des mots et des expressions vernaculaires, se plaisant à expliquer que "noisiller" désigne une certaine façon de traiter les noix ; on prend le fruit entre le pouce et l’index et, avec un petit marteau, on le frappe délicatement de façon qu’il se fende en laissant les cerneaux intacts. Quand il parle des châtaignes "rascalées", il prend un évident plaisir à décrire la signification du terme : Cela veut dire que les châtaignes ont été cuites dans l’eau, puis décortiquées pour ôter la dernière peau, mises dans une marmite où on achève de les peler grâce aux mouvements de tourniquet faits à l’aide d’un instrument en forme de croix. Les châtaignes deviennent alors blanches, et on peut les servir. Commentant la fenaison, il énumère les opérations dès que son père a fini de manœuvrer la faucheuse : Après le fauchage, il faut étaler l’herbe, la laisser sécher, le retourner plusieurs fois par grand soleil. Ensuite, on l’assemble en tas appelés "finières", que l’on charge sur le chariot pour les transporter jusqu’à la grange, où l’on entrepose le foin au-dessus des mangeoires des vaches. « Mme de Sévigné s’est bien exprimée sur les charmes de la fenaison, observe-t-il aussitôt après. Je ne crois pas qu’elle-même ait jamais fané mais elle en parle de façon judicieuse. » Il dit aussi avoir pris part à la préparation du vin après les vendanges : Dans deux grandes cuves, on laisse la fermentation commencer, non sans l’accélérer en écrasant le raisin avec les pieds, ce qu’on appelle "froustir". On peut alors laisser le vin s’écouler, le recueillant dans des barriques, et ce qui reste dans la cuve part pour le pressoir. Et là, on obtient un autre vin, de moins bonne qualité. S’il reconnaît que le travail des champs l’a sûrement formé, il avoue s’y être beaucoup ennuyé parce qu’il le détournait de ce qu’il considérait comme son vrai travail, la philosophie.
Un auteur prolifique
Dans « Épicure en Corrèze », Marcel Conche se laisse aller à la confidence : « Je me suis voué à la philosophie dès mon plus jeune âge, sans doute dès 6 ans, lorsque je me suis aventuré jusqu’au grand tournant, sur la route longeant le pré que mon père était en train de faucher, pour savoir si le monde continuait après. Depuis, j’ai toujours eu dans l’esprit des questions de cette nature : "Pourquoi le monde existe ? Et moi, pourquoi j’existe ? Le monde, est-il fini ou infini ?" » Avec l’argent reçu de ses parents à sa première communion, il achète les Pensées pour moi-même du stoïcien romain Marc Aurèle. Peu après, il se passionne pour les Pensées de Pascal qui deviennent dès lors son vade mecum. Au lycée Edmond-Perrier de Tulle, en 1942, il découvre d’autres textes, fondateurs, de la pensée philosophique, et… tombe amoureux de sa professeure de lettres avant de l’épouser. De quinze ans son aînée, Marie-Thérèse Tronchon, alias Mimi (1907-1997), lui communique sa passion des poètes Aragon, Rilke, Michaux et Apollinaire. Il reconnaît chez elle le goût artistique dont il est dépourvu : « Je n’y entends rien pour juger de la qualité de la littérature, de la musique, de la peinture ou du cinéma. Je suis capable d’apprécier un navet comme un chef-d’œuvre. Mon fils [François], d’ailleurs, qui est très cinéphile et ne jure que par Godard, ne comprend pas que je prenne autant de plaisir à "Columbo" qu’à "L’Année dernière à Marienbad", de Resnais. »
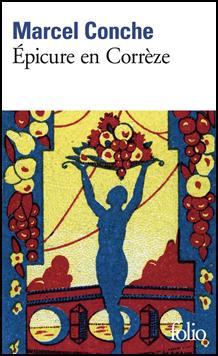 Durant la Seconde Guerre mondiale, il affiche un pacifisme radical et refuse à plusieurs reprises d’intégrer les rangs de la Résistance où ses parents jouent un rôle actif. Après le conflit durant lequel il a continué l’étude des langues mortes, il suit les cours de Jean Wahl, Martial Gueroult et Gaston Bachelard où il côtoie François Châtelet, Gilles Deleuze et Jean d’Ormesson. Devenu agrégé de philosophie en 1950, ayant appris le grec et le latin, il édite et traduit les philosophes présocratiques de la Grèce antique ; il commente et analyse également les œuvres de Chamfort, Hegel, Heidegger, Lucrèce, Montaigne, Nietzsche, Pyrrhon, Spinoza et Vauvenargues. Professeur de lycée (Cherbourg, Évreux et Versailles) jusqu’en 1963, il enseigne à l’université de Lille où il devient l’assistant d’Éric Weil (jusqu’en 1978). Il est admis à la Sorbonne (Paris 1) où il est titulaire de la chaire de métaphysique jusqu’en 1988. En 2008, il embarque pour la Corse pour rejoindre Émilie, une de ses élèves dont il s’est épris : « Émilie était pénétrée de culture persane, relate-t-il dans son ouvrage autobiographique. Je fis venir de Paris les œuvres d’Attar, Rûmî, Ferdowsî, je m’intéressai à l’itinéraire mystique du soufisme iranien. J’allai en Inde, dont Émilie m’avait parlé, puis en Chine, dont elle ne m’avait pas parlé. Découvrant Lao-tseu, je fis du chinois toute l’année 2002 et publiai ma traduction du Tao Te king en 2003. » Durant la Seconde Guerre mondiale, il affiche un pacifisme radical et refuse à plusieurs reprises d’intégrer les rangs de la Résistance où ses parents jouent un rôle actif. Après le conflit durant lequel il a continué l’étude des langues mortes, il suit les cours de Jean Wahl, Martial Gueroult et Gaston Bachelard où il côtoie François Châtelet, Gilles Deleuze et Jean d’Ormesson. Devenu agrégé de philosophie en 1950, ayant appris le grec et le latin, il édite et traduit les philosophes présocratiques de la Grèce antique ; il commente et analyse également les œuvres de Chamfort, Hegel, Heidegger, Lucrèce, Montaigne, Nietzsche, Pyrrhon, Spinoza et Vauvenargues. Professeur de lycée (Cherbourg, Évreux et Versailles) jusqu’en 1963, il enseigne à l’université de Lille où il devient l’assistant d’Éric Weil (jusqu’en 1978). Il est admis à la Sorbonne (Paris 1) où il est titulaire de la chaire de métaphysique jusqu’en 1988. En 2008, il embarque pour la Corse pour rejoindre Émilie, une de ses élèves dont il s’est épris : « Émilie était pénétrée de culture persane, relate-t-il dans son ouvrage autobiographique. Je fis venir de Paris les œuvres d’Attar, Rûmî, Ferdowsî, je m’intéressai à l’itinéraire mystique du soufisme iranien. J’allai en Inde, dont Émilie m’avait parlé, puis en Chine, dont elle ne m’avait pas parlé. Découvrant Lao-tseu, je fis du chinois toute l’année 2002 et publiai ma traduction du Tao Te king en 2003. »
Le philosophe devait fêter ses 100 ans le 27 mars 2022. Il s’est éteint à Treffort, en Isère, le 27 février, trois jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il a laissé une cinquantaine d’ouvrages de métaphysique, de philosophie morale et de création littéraire dont les cinq volumes du « Journal étrange », pièce maîtresse du testament littéraire et philosophique qu’il lègue à la postérité.
Marcel Conche en 2017 © Photo X, droits réservés
- Épicure en Corrèze, par Marcel Conche, ouvrage issu de conversations avec Catherine Portevin (journaliste et écrivaine), éditions Gallimard, collection folio n° 6149, 192 pages, 2016 ;
- Journal étrange, de M. Conche, éditions Presses universitaires de France, 2006-2011 ;
- L’Infini de la nature (œuvres philosophiques), de M. Conche, éditions Bouquins, 1073 pages, 2022.
Varia : objets inutiles ou kitsch de la mythologie moderne
« Mythologie moderne : les objets en tant que tels ont changé de signification en se démettant de leur fonction.
« En février 1970, près de Saint Germain des Prés, à Paris, le couple Lalanne, sculpteurs - "les Lalannes" - ont exposé au milieu d’une galerie un immense hippopotame bleu tendre en matière plastique. Le dos s’ouvrait : le corps offrait une baignoire aux robinets de cuivre. La mâchoire recélait un lavabo. L’exposition montrait aussi quatre crapauds que leur dos rejeté transformait en fauteuils.
« "Rome n’est plus dans Rome"… ni l’art dans l’art, ni le plus rationnel des objets dans ses normes.
« Qu’était-il, l’hippopotame bleu clair ? Un objet d’art ? Un objet technique ? Un objet utilitaire ? Un objet inutile ? Les sociologues croyaient pouvoir diviser l’objet, le répartir entre ces quatre catégories logiques. Voilà que tout se mêle. […]
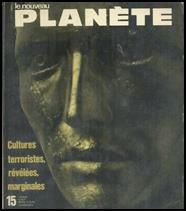 « "L’objet inutile", enfin, en se banalisant, devient dérisoire. Multiplié dans des matières bon marché, ce qui devait libérer l’imagination, individualiser le décor de série, rentre dans la série. Ainsi retrouvons-nous ce que les Viennois de 1880 avaient baptisé "kitsch" : le non-authentique, le falsifié, le dérisoire. Jadis représenté par d’atroces animaux de porcelaine, des tasses pseudo-japonaises, des orientaleries, le "kitsch" renaît. Nous le retrouvons dans des boutiques dites de "cadeaux" spécialement créées pour l’inutile. Petites chaises faux-second-empire made in Italy, abat-jour style 1925, et ces radiomètres tournoyant sous la lumière, ces sabliers multicolores pris dans un cube transparent, ces ludions qui montent et descendent sombrent, par la multiplication, dans le déjà-vu, l’excédant : le "kitsch". « "L’objet inutile", enfin, en se banalisant, devient dérisoire. Multiplié dans des matières bon marché, ce qui devait libérer l’imagination, individualiser le décor de série, rentre dans la série. Ainsi retrouvons-nous ce que les Viennois de 1880 avaient baptisé "kitsch" : le non-authentique, le falsifié, le dérisoire. Jadis représenté par d’atroces animaux de porcelaine, des tasses pseudo-japonaises, des orientaleries, le "kitsch" renaît. Nous le retrouvons dans des boutiques dites de "cadeaux" spécialement créées pour l’inutile. Petites chaises faux-second-empire made in Italy, abat-jour style 1925, et ces radiomètres tournoyant sous la lumière, ces sabliers multicolores pris dans un cube transparent, ces ludions qui montent et descendent sombrent, par la multiplication, dans le déjà-vu, l’excédant : le "kitsch".
« Donner un objet utile constitue une sorte d’injure, un doute sur le train de vie du destinataire. Achetons donc le ressort-à-matelas doré, présenté en boîte et qui permettra, en jouant, de ne pas s’énerver quand on attend au téléphone. La boule qui n’éclaire pas, mais scintille et change. L’animal grotesque, bourré de petit plomb, que l’on malaxe pour passer son agressivité. Le néo-kitsch.
« Ici la dérision ne consiste pas à vouloir imiter l’art, mais d’offrir un objet dérivé de l’utile, détourné de tout usage : le bout de ressort à matelas assoupli et coûteux ; le radiomètre, appareil de laboratoire apprivoisé et privé d’usage. Désormais, l’objet détourné de son sens sera fabriqué exprès pour l’inutile, l’amusement. »
Extraits de « L’objet dans notre vie » par Dominique Desanti, issu de la revue « Le Nouveau Planète », n° 15, mars 1970.
Carnet : Stephen Sondheim inspiré par Ravel et Seurat
Né le 22 mars 1930 à New York, Stephan Sondheim, un des plus fameux compositeurs de comédies musicales, est mort le 26 novembre 2021 dans sa maison de Roxbury (Connecticut). Il avait signé les paroles de « West Side Story » (réalisé par Jerome Robbins et Robert Wise) et composé la musique de « Compagny » (mis en scène par Harold Prince). Prix Pulitzer pour la musique et les paroles de « Sunday in the Park with George » (de James Lapine), il révérait Maurice Ravel (1875-1937) dont il disait que « l’influence harmonique s’entend jusqu’à l’époque du rock » ; il lui rend d’ailleurs un bel hommage dans « A Little Night Music » (1973), musique composée d’après le film d’Ingmar Bergman « Sourires d’une nuit d’été » (1955) et inspirée du Ravel des « Valses nobles et sentimentales » (1920). Dans « Sunday un the Park with George » (1984), Stephen Sondheim interpelait les personnages d’un tableau d’un autre créateur français, Georges-Pierre Seurat (1859-1891), « Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte » (un tableau acquis par l’Art Institute de Chicago en 1924).
La genèse des Dupondt
Rédacteur en chef du magazine de bande dessinée humoristique Fluide glacial, Albert Algoud (Asnières-sur-Seine, 1950) est un tintinophile averti auquel nous devons « Le Dupondt sans peine » (éditions Albin Michel, 1998). L’auteur explique la genèse du tandem de flics légendaires, nés de la fascination de Georges Remi, alias Hergé (1907-1983) pour la gémellité de son père Alexis et de son oncle Léon. Semblables en tout point les Dupondt ? Un seul détail physique permet de les distinguer, la moustache, elle est droite chez Dupond et troussée chez Dupont.
(Vendredi 27 mai 2022)
Parité humains-animaux
En 1980, il y a seulement quarante ans, on n’aurait pas cru que les gènes, éléments du chromosome qui mettent en place le plan d’un être humain étaient identiques à ceux fonctionnant chez une grenouille, une souris ou une mouche. Et pourtant ce sont bien les mêmes gènes qui ont été retrouvés chez tous les animaux examinés par les chercheurs la décennie suivante. Prix Nobel de médecine en 1965, le biologiste François Jacob (1920-2013) nous enseigne que « tous les animaux existant aujourd’hui sur cette terre descendent d’un même organisme ayant vécu il y a six cents millions d’années et possédant déjà cette batterie de gènes ». Fascinant, non ?
La foudre lente des mots…
Ce fils de paysan portugais exerça la fonction de garçon de ferme au Brésil à l’âge de 13 ans. Médecin ORL, il fut un conteur et un diariste fabuleux. Ses nouvelles et son journal sont exemplaires à plus d’un titre. Adolfo Correia de Rocha (1907-1995) se considérait plutôt poète qu’écrivain, la poésie étant vécue comme l’art essentiel, « une foudre lente des mots dans la pénombre du labeur et du "journal" quotidien ». Adolfo s’était choisi pour pseudonyme Miguel Torga, Miguel pour Cervantes et Torga comme la bruyère sauvage.
(Samedi 28 mai 2022)
|
Billet d’humeur
Fêtés, chômés, fériés
Revu et corrigé par le pape Grégoire XIII en 1582, le calendrier, de type solaire, continue à rythmer les jours, les semaines, les mois et les années de notre vie. Les fêtes légales - déclarées comme telles par décret - comportent des fêtes fixes donnant lieu à des jours fériés : Jour de l’an (1er janvier), fête du travail (1er mai), victoire du 8 mai 1945, fête nationale (14 juillet). Ainsi que des fêtes mobiles : jour du souvenir des déportés (dernier dimanche d’avril), fête de Jeanne d’Arc (deuxième dimanche de mai) et fête des mères (dernier dimanche de mai ; elle peut être reportée au premier dimanche de juin si la Pentecôte tombe ce jour-là). Un souverain pontife est donc à l’origine de notre division particulière du temps qui a été étendue à presque tous les pays du globe. Cela ne va pas sans contradictions pour les usagers du calendrier grégorien en France. Notre pays se déclare souvent champion de la laïcité après avoir été fille aînée de l’Église. Ce clivage apparaît dans certaines festivités. Ainsi le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte sont devenus jours fériés en 1886 au milieu d’un âpre conflit opposant l’État à l’Église. Rappelez-vous : la IIIe République venait de supprimer le repos dominical, de restaurer le divorce et de laïciser les programmes de l’école primaire (où l’on avait décroché l’effigie du Christ en croix). Ces deux journées donnaient lieu à des processions et elles étaient chômées. C’est à la demande des chambres de commerce que le gouvernement en a fait des jours fériés : la France en compte onze aujourd’hui. Curieusement, la plupart de ces jours fériés observent le même clivage religieux/profane : ne célèbre-t-on pas quasiment aux mêmes périodes Noël et jour de l’An, Pâques et le 1er-Mai, le 14-Juillet et l’Assomption, la Toussaint et le 11-Novembre ? Le législateur s’empresse d’expliquer que les fêtes légales n’ont pas été instituées pour donner des temps de repos supplémentaires, mais pour remplir des fonctions religieuses ou politiques. Dans l’opinion, on débat par intermittence de l’opportunité de supprimer les fêtes religieuses ou de les revoir, quitte à y inclure le Kippour et l’Aïd el-Kébir (juifs et musulmans possédant un autre calendrier que celui du pape Grégoire).
|
Lecture critique
Machines à voir, à lire et à penser
ou trois siècles d’inventions
De quelle façon et selon quelles circonstances s’est construit du XVIIe au XIXe siècle le regard de l’homme, assisté de dispositifs optiques toujours plus innovants ? C’est à cette multiplicité de questions que répond l’anthologie établie par les universitaires (université Lumière Lyon 2) Delphine Gleizes et Denis Reynaud sous le titre « Machines à voir - Pour une histoire du regard instrumenté (XVIIe-XIXe siècles) ». La démarche éditoriale est exemplaire dans ce qu’elle combine l’histoire à la fois culturelle, littéraire et scientifique des inventions qui ont permis à l’homme d’améliorer ses capacités visuelles. Spécialisés dans la littérature française, les auteurs ont utilisé avec profit un corpus de 238 textes de natures différentes (littéraires, scientifiques ou techniques) puisés à la source de 180 auteurs.  Ces machines à voir sont surtout des machines à lire, selon D. Gleizes et D. Reynaud, qui distinguent quatre types de relations entre littérature et science : « une littérature du pressentiment, qui annonce des machines inconnues ; une littérature d’exploitation, qui transpose ces inventions dans le domaine de la fiction ; une littérature de validation qui, décrivant des expériences et des découvertes, en assure la légitimité ; enfin une littérature de vulgarisation qui présente à un public non averti les inventions de la science ». Ces machines à voir sont surtout des machines à lire, selon D. Gleizes et D. Reynaud, qui distinguent quatre types de relations entre littérature et science : « une littérature du pressentiment, qui annonce des machines inconnues ; une littérature d’exploitation, qui transpose ces inventions dans le domaine de la fiction ; une littérature de validation qui, décrivant des expériences et des découvertes, en assure la légitimité ; enfin une littérature de vulgarisation qui présente à un public non averti les inventions de la science ».
Aux dernières années du XVIe siècle, les scientifiques inventent deux sortes de lunettes, le télescope qui permet de voir des personnes ou des objets invisibles en raison de leur éloignement et le microscope qui permet de percevoir des objets quasiment imperceptibles à cause de leur petitesse. Si l’histoire des inventions est marquée par des rythmes chaotiques, les trois siècles visés par l’ouvrage offrent un inventaire assez riche d’instruments qui témoignent d’une accélération continue et remarquable de la mise au point d’appareils et de dispositifs qui, depuis l’invention du télescope à la découverte des rayons X et du cinématographe, ont grandement modifié la manière dont l’homme percevait et reproduisait la réalité. « Plus de 5 000 ans séparent par exemple l’invention de la roue par les Sumériens de celle du vélocipède par Pierre Michaux ; alors que ce dernier ne précède que d’une petite dizaine d’années l’apparition des automobiles à moteur à explosion. Il en va de même dans le domaine de l’optique. » L’histoire des techniques est brossée dès la première partie de l’anthologie : outre le télescope et le microscope, il est question de radiographie, de lanterne magique, de fantascope, de panorama (œuvre du peintre écossais Robert Parker), de diorama (imaginé par Louis Daguerre et Charles-Marie Bouton) et, naturellement, de photographie. On s’amuse à l’idée qu’on doit au capucin Chérubin d’Orléans la création du mot binocle, au physiologiste français Jules Marey le fusil photographique (1882) et au poète Charles Cros l’invention du paléophone, appareil de reproduction des sons. On s’étonne d’apprendre l’existence précoce, au début du XVIIIe s., d’un clavier oculaire capable de proposer des harmonies colorées (invention de Louis Bertrand Castel, savant jésuite montpelliérain). Susceptibles de restituer des images en mouvement, d’autres dispositifs optiques retiennent l’attention du lecteur : le phénakistiscope (1833), le zootrope (1834), le stéréoscope (conçu par le savant anglais Charles Wheatstone en 1838), le folioscope (1860), le kinématoscope (1861) et le praxinoscope (1877). Dans l’introduction de l’ouvrage, les anthologistes rappellent à bon escient que « Quoique née en 1908, Simone de Beauvoir évoque des souvenirs d’enfance non pas liés au cinéma mais à d’autres images optiques qui décomposaient et recomposaient la réalité sous ses yeux : le "stéréoscope qui transformait deux plates photographies en une scène à trois dimensions", "le kinétoscope" (elle veut probablement dire le zootrope) : "bande d’images immobiles dont la rotation engendrait le galop d’un cheval" et ces "espèces d’albums qu’on animait d’un simple coup de pouce : la petite fille figée sur des feuillets se mettait à sauter, le boxeur à boxer". (le folioscope). »
« Si les perfectionnements de l’optique ont conduit à saisir ce qui échappait jusqu’alors à la connaissance humaine, à découvrir au cœur de la matière l’action de corps imperceptibles et au sein de l’univers les lois de la gravitation, pourquoi n’en serait-il pas de même pour ce qui demeure encore insaisissable ? interrogent Delphine Gleizes et Denis Reynaud. Pourquoi l’homme ne pourrait-il acquérir la possibilité de voir l’avenir et de revoir le passé, d’être simultanément et virtuellement dans plusieurs lieux à la fois, de communiquer à distance sans être physiquement en présence de son interlocuteur ? Il est prisonnier d’un corps et d’un esprit qui lui confèrent certes son intégrité en tant qu’individu, mais qui le rendent également opaque et inaccessible à autrui : comment rester insensible à la dangereuse tentation de voir à travers les corps, de lire dans les pensées comme à livre ouvert ou de surprendre les désirs secrets des individus ? » Ces questions n’ont rien de saugrenu, elles apparaissent parfaitement pertinentes, a fortiori après la lecture attentive de cette passionnante anthologie.
- Machines à voir - Pour une histoire du regard instrumenté (XVIIe-XIXe siècles), par Delphine Gleizes et Denis Reynaud, Presses universitaires de Lyon, 404 pages, 2017.
Portrait
Claude Romano explore l’infinitude de la couleur
Nous devons savoir gré à Claude Romano (Fontenay-aux-Roses, 1967) de nous rappeler à bon escient que la couleur n’a pas encore livré tous ses secrets. « On pourrait même affirmer, insiste-t-il à cet égard dans son ouvrage "De la couleur", que plus nos connaissances se raffinent et s’étoffent, comme ce fut le cas à partir de la révolution newtonienne et de la constitution d’une optique mathématique, et plus il y a matière à débats, plus la couleur oppose à nos interrogations une résistance têtue. »
 La couleur est-elle subjective ou objective ? Quel type de nécessité préside aux rapports des couleurs ? Peut-on proposer une "esthétique" des couleurs ? Les couleurs n’ont-elles de réalité que dans notre regard ? Existe-t-il une logique du phénomène chromatique ? Des facteurs atomiques ou moléculaires sont-ils responsables de l’absorption de certaines longueurs d’ondes du spectre électromagnétique ? Comment agissent les phénomènes de réfraction, de réflexion et de diffusion de la lumière ? Est-ce vrai que la vision humaine possède sa plus grande acuité dans les conditions d’éclairage qui sont celles d’un sous-bois ? Les questions que le philosophe soulève dans l’excellent essai que les éditions Gallimard publient en une version revue et augmentée trouvent ici à défaut de réponses définitives une réflexion éclairée et un argumentaire savant sur les hommes - scientifiques, philosophes, peintres et musiciens - qui ont étudié le phénomène de la couleur, de Descartes à Newton, de Locke à Wittgenstein, de Chevreul à Goethe, de Schopenhauer à Merleau-Ponty, de Kandinsky à Scriabine. L’indispensable recours à l’optique, à la physique, aux neurosciences, à la philosophie et à la peinture étaie avec bonheur le propos énoncé avec une clairvoyance et un didactisme salutaires. La couleur est-elle subjective ou objective ? Quel type de nécessité préside aux rapports des couleurs ? Peut-on proposer une "esthétique" des couleurs ? Les couleurs n’ont-elles de réalité que dans notre regard ? Existe-t-il une logique du phénomène chromatique ? Des facteurs atomiques ou moléculaires sont-ils responsables de l’absorption de certaines longueurs d’ondes du spectre électromagnétique ? Comment agissent les phénomènes de réfraction, de réflexion et de diffusion de la lumière ? Est-ce vrai que la vision humaine possède sa plus grande acuité dans les conditions d’éclairage qui sont celles d’un sous-bois ? Les questions que le philosophe soulève dans l’excellent essai que les éditions Gallimard publient en une version revue et augmentée trouvent ici à défaut de réponses définitives une réflexion éclairée et un argumentaire savant sur les hommes - scientifiques, philosophes, peintres et musiciens - qui ont étudié le phénomène de la couleur, de Descartes à Newton, de Locke à Wittgenstein, de Chevreul à Goethe, de Schopenhauer à Merleau-Ponty, de Kandinsky à Scriabine. L’indispensable recours à l’optique, à la physique, aux neurosciences, à la philosophie et à la peinture étaie avec bonheur le propos énoncé avec une clairvoyance et un didactisme salutaires.
7 ou 11 couleurs de base ?
Nous apprenons ainsi que Newton distinguait sept couleurs de base dans le spectre, par analogie avec l’échelle musicale. Gassendi en identifiait cinq, Léonard de Vinci six. L’auteur signale l’existence de onze noms de couleurs de base dans les langues possédant le plus riche vocabulaire chromatique, c’est-à-dire le noir, le blanc, le rouge, le jaune, le vert, le bleu, le marron, le violet, le rose, l’orange et le gris. Il en profite pour détruire utilement un vieux mythe relatif aux innombrables termes décrivant l’état de la neige chez les Esquimaux. En vérité, ceux-là ne disposent que d’une douzaine de vocables, c’est-à-dire à peu près autant qu’en français. Un philosophe américain, George Boas (1891-1980), a favorisé cette fausse représentation en indiquant que les Esquimaux employaient quatre racines étymologiques distinctes, signifiant respectivement « neige au sol », « neige tombant », « neige amoncelée » et « congère », pour désigner les différents états de la neige. Un linguiste et anthropologue de l’université Yale, à New Haven, Benjamin Lee Whorf (1897-1941), aurait embelli l’histoire en mentionnant sept racines distinctes et laissant entendre qu’il y en avait davantage. En 1984, dans le New York Times daté du 9 février, le nombre de mots esquimaux pour désigner la neige était passé à cent !
La couleur chez les peintres
La troisième et dernière partie de l’ouvrage consacrée à « l’esthétique des couleurs » porte d’éblouissantes analyses. Nous en donnons ici un florilège. « Ce que peignent les impressionnistes en même temps que l’impression - ou plutôt en lieu et place de celle-ci -, c’est la lumière telle qu’elle flotte au-dessus des choses, les pollinise de son poudroiement sans fin ». À propos de Paul Cézanne : « Dans le "Château Noir",  le dynamisme de la touche confère aux formes un rayonnement qui se communique de proche en proche à tout l’espace de la toile comme un vent agitant un feuillage, l’unifiant, transgressant l’écart des sens, faisant communiquer bruits, mouvements, senteurs en une unique modulation indivise - l’odeur même des pins. La couleur est vie et le paysage mouvement. "Il n’y a qu’une seule route, affirme Cézanne, pour tout rendre, tout traduire : la couleur. La couleur est biologique, si je puis dire. La couleur est vivante, rend seule les choses vivantes." » Évoquant la manière des Fauves, il convoque Henri Matisse : « Chez les Fauves, comme chez les symbolistes, la couleur est affranchie de tout souci de vraisemblance. "Le tableau est fait de la combinaison de surfaces différemment colorées, écrit Matisse, combinaison qui a pour résultat de créer une expression. De la même façon que, dans une harmonie musicale, chaque note est une partie du tout, ainsi souhaitai-je que chaque couleur eût une valeur contributive. Un tableau est la coordination de rythmes contrôlés." » « C’est certainement dans la peinture non figurative, observe-t-il en outre, que la couleur, affranchie de toute référentialité, devenue dimension de l’être, est accessible pour elle-même. La couleur est un monde parce qu’elle possède un rythme, une vibration, une dynamique, une spatialité, une résonance affective propres. Ces caractéristiques ont été remarquablement décrites par Vassily Kandinsky. Chaque couleur sécrète pour notre œil son propre climat affectif, sa propre dynamique spatiale. » Plus loin, en fin de volume, évoquant le tableau comparatif des tons colorés et musicaux d’Alexandre Scriabine qui lui a servi de base pour la composition de son poème symphonique Prométhée ou le Poème du feu, Claude Romano juge fondamental le phénomène des synesthésies parce qu’il est universel. Il a soin de citer la judicieuse sentence de Charles Baudelaire : « On trouve dans la couleur l’harmonie, la mélodie, et le contrepoint. » le dynamisme de la touche confère aux formes un rayonnement qui se communique de proche en proche à tout l’espace de la toile comme un vent agitant un feuillage, l’unifiant, transgressant l’écart des sens, faisant communiquer bruits, mouvements, senteurs en une unique modulation indivise - l’odeur même des pins. La couleur est vie et le paysage mouvement. "Il n’y a qu’une seule route, affirme Cézanne, pour tout rendre, tout traduire : la couleur. La couleur est biologique, si je puis dire. La couleur est vivante, rend seule les choses vivantes." » Évoquant la manière des Fauves, il convoque Henri Matisse : « Chez les Fauves, comme chez les symbolistes, la couleur est affranchie de tout souci de vraisemblance. "Le tableau est fait de la combinaison de surfaces différemment colorées, écrit Matisse, combinaison qui a pour résultat de créer une expression. De la même façon que, dans une harmonie musicale, chaque note est une partie du tout, ainsi souhaitai-je que chaque couleur eût une valeur contributive. Un tableau est la coordination de rythmes contrôlés." » « C’est certainement dans la peinture non figurative, observe-t-il en outre, que la couleur, affranchie de toute référentialité, devenue dimension de l’être, est accessible pour elle-même. La couleur est un monde parce qu’elle possède un rythme, une vibration, une dynamique, une spatialité, une résonance affective propres. Ces caractéristiques ont été remarquablement décrites par Vassily Kandinsky. Chaque couleur sécrète pour notre œil son propre climat affectif, sa propre dynamique spatiale. » Plus loin, en fin de volume, évoquant le tableau comparatif des tons colorés et musicaux d’Alexandre Scriabine qui lui a servi de base pour la composition de son poème symphonique Prométhée ou le Poème du feu, Claude Romano juge fondamental le phénomène des synesthésies parce qu’il est universel. Il a soin de citer la judicieuse sentence de Charles Baudelaire : « On trouve dans la couleur l’harmonie, la mélodie, et le contrepoint. »
Claude Romano © Photo X, droits réservés
- De la couleur, par Claude Romano, éditions Gallimard, Folio essais n° 660, 384 pages, 2020.
Varia : le marché de l’art sous le marteau d’ivoire
La longévité de ce guide de cotation est impressionnante : voilà trente-six années que Jacques-Armand Akoun (Paris, 1947) publie à son propre patronyme un ouvrage de référence qui détermine la cote des peintres de tous les pays et de tous les siècles :86 000 d’entre eux sont répertoriés cette année ! Fréquentant très tôt avec une assiduité inlassable les salles de ventes et les marchés d’antiquités, il est précocement passé maître de la discipline, répertoriant les résultats des enchères à partir desquelles il évalue les cotes moyennes, comptabilise les records et précise les tendances du marché. Né à Montmartre, à un jet de caillou de la place du Tertre, il se souvient avoir rencontré, à 8 ans, Maurice Utrillo, quelques mois seulement avant la disparition du maître rendu célèbre par sa « période blanche ». Artiste lui-même, J.-A. Akoun reçoit les encouragements des peintres Victor Brauner, Charles Camoin, Ferdinand Desnos et Edmond Heuzé. 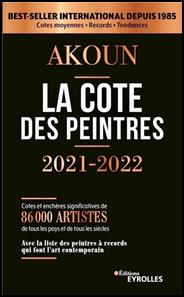 Des moulins au Sacré-Cœur, il fréquente la fine fleur des peintres de la Butte Montmartre parmi lesquels Jordi Bonàs, Joseph Csàky, Robert Delval, Roland Dubuc, Jean Dupuy, Pierre Gougerot, Pierre-César Lagage, Armand Lourenço, Raymond Moretti, Robert Naly aux États-Unis en 2012, Takanori Oguiss, Eugène Paul, André Quellier, Georges Rouault et Astolfo Zingaro. Collectionneur devenu marchand, il s’impose rapidement en qualité d’expert à travers la publication de son guide servi par un système de cotation fonctionnel. S’ajouteront à la « Cote des Peintres », la « Cote des bronzes, sculptures, lithos, gravures, tapisseries, affiches et photos » et le « Akoun International Auction Art ». Des moulins au Sacré-Cœur, il fréquente la fine fleur des peintres de la Butte Montmartre parmi lesquels Jordi Bonàs, Joseph Csàky, Robert Delval, Roland Dubuc, Jean Dupuy, Pierre Gougerot, Pierre-César Lagage, Armand Lourenço, Raymond Moretti, Robert Naly aux États-Unis en 2012, Takanori Oguiss, Eugène Paul, André Quellier, Georges Rouault et Astolfo Zingaro. Collectionneur devenu marchand, il s’impose rapidement en qualité d’expert à travers la publication de son guide servi par un système de cotation fonctionnel. S’ajouteront à la « Cote des Peintres », la « Cote des bronzes, sculptures, lithos, gravures, tapisseries, affiches et photos » et le « Akoun International Auction Art ».
Avantageusement nommée « la bible des collectionneurs » par le quotidien Journal de Genève et « le saint Christophe des chineurs » par l’historien d’art Gérald Schurr, « La Cote des peintres Akoun » révèle les records de ventes d’œuvres d’art portées aux enchères les années précédentes : « Salvator Mundi » (1490-1500), peinture à l’huile sur bois de noyer (65 x 45 cm) de Léonard de Vinci adjugée 381 000 000 € en 2017 aux États-Unis ; « Nafea faa ipoipo ? » (1892), littéralement Quand te maries-tu ?, de Paul Gauguin (101 x 77 cm), peinture à l’huile sur toile vendue 290 000 000 € en Suisse en 2015 et « Les Joueurs de cartes » (1895), peinture à l’huile sur toile de Paul Cézanne (47 x 73 cm) vendue 191 000 000 € en 2012 aux États-Unis. Chez les femmes peintres, « Une rue » (1926), huile sur toile de Georgia O’Keeffe (122 x 76 cm) a trouvé preneur à 13 000 000 € aux États-Unis en 2018 ; « Orange Grove » (1965), huile et mine de plomb sur toile d’Agnes Martin (182 x 182 cm) adjugée 10 693 000 € aux États-Unis en 2016 et « Noon » (1969), huile sur toile de Joan Mitchell (261 x 200) vendue 9 797 000 € aux États-Unis en 2016. Chez les peintres vivants, le palmarès affiche : « Portrait of an Artist (Pool with two figures) » (1972), peinture acrylique sur toile de David Hockney (214 x 305) vendue 88 0000 000 € aux États-Unis en 2018 ; « Flag » (1983) de Jasper Johns (29 x 44), encaustique sur soie drapeau sur toile adjugée 32 000 000 € aux États-Unis en 2014 et « Abstraktes bild 648 » (1987), huile sur toile de Gerhard Richter (225 x 200 cm) vendue aux États-Unis en 2014. Les listes des records de vente établis sous le marteau d’ivoire par le Guide Akoun témoignent de la vitalité d’un marché de l’art qui ne cesse d’affoler la boussole des enchères.
- La Cote des peintres 2021-2022, par Jacques-Armand Akoun, assisté de Jacky Pierre Albert Akoun (fils du précédent) et Geneviève D’Hoye, éditions Eyrolles, 398 pages, 2021.
"La Mort de Marat", tableau d’histoire et portrait
 « "La Mort de Marat", ce tableau déplace la peinture. Quelque chose s’y passe, qui change la peinture en ce qui n’a de nom dans aucune langue, puisque, cette fois enfin, la politique fait se rejoindre les parallèles : tableau d’histoire et portrait. Au passage de Marie-Antoinette, la rencontre se produit à nouveau, mais en instabilité. Le tableau d’histoire et le portrait, naissant du croquis, ne cessent de s’éclipser mutuellement ; comme dans certains jeux optiques, le regard perçoit l’une des possibilités, pour la perdre aussitôt, au profit de l’autre. La rapidité du trait suscite tantôt l’une, tantôt l’autre, en mode dubitatif. De là naît une fascination ; elle renvoie à un manque : le manque-à-peindre, justement. Dans "La Mort de Marat", en revanche, le portrait est pleinement portrait et pleinement portrait d’histoire ; le tableau d’histoire est pleinement tableau d’histoire et pleinement portrait. Loin que chacun s’éclipse, ils s’imposent à l’observateur. Loin que chacun éclipse l’autre, chacun confirme l’autre. » « "La Mort de Marat", ce tableau déplace la peinture. Quelque chose s’y passe, qui change la peinture en ce qui n’a de nom dans aucune langue, puisque, cette fois enfin, la politique fait se rejoindre les parallèles : tableau d’histoire et portrait. Au passage de Marie-Antoinette, la rencontre se produit à nouveau, mais en instabilité. Le tableau d’histoire et le portrait, naissant du croquis, ne cessent de s’éclipser mutuellement ; comme dans certains jeux optiques, le regard perçoit l’une des possibilités, pour la perdre aussitôt, au profit de l’autre. La rapidité du trait suscite tantôt l’une, tantôt l’autre, en mode dubitatif. De là naît une fascination ; elle renvoie à un manque : le manque-à-peindre, justement. Dans "La Mort de Marat", en revanche, le portrait est pleinement portrait et pleinement portrait d’histoire ; le tableau d’histoire est pleinement tableau d’histoire et pleinement portrait. Loin que chacun s’éclipse, ils s’imposent à l’observateur. Loin que chacun éclipse l’autre, chacun confirme l’autre. »
Extrait de l’ouvrage « Malaise dans la peinture. À propos de "La Mort de Marat" », par Jean-Claude Milner, éditions Ophrys/Institut national d’histoire de l’art, 70 pages, 2012.
Haut de page
|





