Les Papiers collés
de Claude Darras
Hiver 2019-2020
Carnet : les petits cailloux des poètes
Tuffeau, couleur du vieil ivoire. La Terre appartient aux poètes. Couleurs, odeurs, douleurs, de petits cailloux semés sur la route de la Poésie !
Les poètes sont, aussi, les comptables du ciel !
(Jules Mougin, « 1912 : toutes les boîtes aux lettres sont peintes en bleu ciel », Travers 53, Philippe Marchal éditeur, 1999)
Du métier de lecteur
On me demande souvent ce que je fabrique dans la vie. À me voir flâner dans les rues, sur ma moto, on s’interroge. Des rentes ? Alors quand je réponds que je suis lecteur, le doute, la curiosité, redoublent. J’explique. Quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Quand un manuscrit se sent mal dans le tiroir de son auteur, celui-ci l’envoie chez un éditeur, qui s’empresse de le passer à un de ses lecteurs. Lequel ausculte, tâte, déshabille, et dresse un diagnostic, une ordonnance. Généralement, le manuscrit n’est pas malade du tout, il a simplement rêvé qu’il l’était. On le renvoie à son auteur. Rien de grave, cher Monsieur, soyez tout à fait rassuré…
(Georges Perros, « Papiers collés » 3, Gallimard/l’Imaginaire, 1978-2005)
Midi tragique
Max Chaleil (Brignon, 1937) a raison de dire que les régions du Midi sont des contrées dures, tragiques. Le tragique habite en permanence les méridionaux, puisqu’ils vont tous mourir. « Ce tragique, prétend à raison l’éditeur gardois, apparaît dans les plus petits gestes, les plus menus détails, renvoie à une universalité qui a peu à voir, naturellement, avec les frontières administratives de la région. »
(Lundi 30 septembre 2019)
Féminisation
« La sagesse n’est pas la femme du sage », prétend un plaisantin.
(Mardi 1er octobre 2019)
La dynastie à l’Écusson rouge
À Francfort-sur-le-Main, il n’était pas rare que les habitants prennent le nom de leur maison. C’est ce que fit, au XVIe siècle, un certain Isaac Elchanan Rothschild qui emprunta son patronyme à une maison de la Judengasse (la rue aux juifs) appelée Zum Roten Schild (À l’Écusson rouge). La famille déménagea plusieurs fois, tout en continuant à s’appeler Rothschild. À la fin du XVIIIe siècle, Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) transforma le modeste commerce de prêt sur gages créé par son père en une banque reconnue, premier établissement de la puissante dynastie des banquiers et financiers.
(Mercredi 9 octobre 2019)
|
Billet d’humeur
Lucy et les Beatles
En novembre 1974, la perception de nos origines bascule avec la découverte à Dikika, près d’Hadar, dans l’est de Éthiopie, du fossile d’un hominidé qui vivait apparemment à cet endroit de la vallée de l’Afar il y a plus de trois millions d’années (3,2 millions environ). L’expédition qui comprendra cinq campagnes de fouilles sur une période de six ans est codirigée par Donald Johanson et Jon Kalb, paléoanthropologues américains (accompagnés d’un élève de Johanson, Tom Gray), et les français Maurice Taieb, alors au Laboratoire de géologie du quaternaire du CNRS, et Yves Coppens, sous-directeur du Musée de l’homme. Au total, 52 ossements (un squelette humain en comporte 206) sont collectés, disséminés sur les bords de la rivière Awash, dans un petit ravin sur une dizaine de mètres. Ces ossements permettront de reconstituer le poids, l’âge et la locomotion de l’individu, et de découvrir que les préhumains marchaient et grimpaient aux arbres. « Nous avons fini,raconte Yves Coppens, par brosser l’extraordinaire tableau d’une femelle préhumaine, probablement âgée de 20 ans, mesurant entre 1 m et 1,20 m, pesant 20 à 25 kg, avec de longs bras et des jambes courtes. Elle se nourrissait de fruits, de racines et de tubercules. Elle se tenait debout et marchait comme un bipède, mais à petits pas, en roulant des hanches et des épaules. » En 1978, les découvreurs nommeront et décriront le fossile d’hominidé Australopithecus afarensis, c’est-à-dire le « singe austral de l’Afar ». Quand ils ont fêté sa découverte au champagne, au soir du dimanche 24 novembre 1974, ils l’avaient déjà appelée « Lucy » en référence à un tube des Beatles qui tournait en boucle à l’antenne des radios du moment. « Lucy in the Sky with Diamonds », littéralement « Lucy dans le ciel avec des diamants », est restée célèbre à cause de ses initiales, LSD, de l’acronyme désignant la substance hallucinogène, bien que son auteur, John Lennon, ait expliqué qu’il s’était inspiré d’une camarade de classe de son fils Julian, Lucy O’Donnell.
|
Lecture critique
L’Afrique subsaharienne décryptée
Quarante-huit pays composent l’Afrique subsaharienne, située au sud du désert du Sahara, 48 États pour un peu plus d’un milliard d’habitants (deux milliards en 2050) dont 60 % ont moins de 20 ans. 48 pays qui se distribuent en quatre sous-régions géographiques : Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique centrale et Afrique australe, et s’organisent en huit communautés économiques régionales, propices à l’intégration régionale. Cette région du continent africain subit aujourd’hui, selon des fortunes diverses, la dérégulation de la mondialisation, processus par lequel la production et les échanges tendent à s’affranchir des contraintes imposées par les frontières et la distance. Si elle connaît chez une quinzaine de ses nations un regain de dynamisme, c’est en grande partie grâce à des investisseurs comme le Chine, l’Inde et la Turquie. Maître de conférences en géographie et aménagement à l’université Paris Nanterre, Jean-Fabien Steck a relevé le défi de présenter, dans un ouvrage bref et pertinent, l’Afrique subsaharienne à travers ses atouts et ses échecs, entre promesses et inquiétudes, réussites flagrantes et amères désillusions. Destiné aux élèves des classes de quatrième et de terminales, « L’Afrique subsaharienne » (collection Documentation photographique, éditions de la Documentation française) peut et doit être lu par tous les publics, ne serait-ce que pour se débarrasser enfin des approches biaisées d’une région qui véhicule comme autant de boulets assertions insensées et clichés éculés. Le fait d’intégrer son sujet au travers d’une grille de lecture à la fois géographique, géoéconomique, géopolitique et géostratégique conforte l’analyse, très lucide, de l’auteur qui assortit son argumentaire de nombreux textes très éclairants signés par des géographes, des journalistes, des chercheurs et des universitaires. éditions de la Documentation française) peut et doit être lu par tous les publics, ne serait-ce que pour se débarrasser enfin des approches biaisées d’une région qui véhicule comme autant de boulets assertions insensées et clichés éculés. Le fait d’intégrer son sujet au travers d’une grille de lecture à la fois géographique, géoéconomique, géopolitique et géostratégique conforte l’analyse, très lucide, de l’auteur qui assortit son argumentaire de nombreux textes très éclairants signés par des géographes, des journalistes, des chercheurs et des universitaires.
Même si les difficultés et les obstacles restent multiples et nombreux, l’Afrique subsaharienne connaît des pôles de développement d’excellence et des initiatives salutaires qui lui valent de prendre part aux flux mondiaux, entre autres au travers de trois types d’espaces et de territoires : les ports et les corridors qui semblent apporter une réponse aux enjeux de l’enclavement, les multiples espaces productifs qui jouent un rôle bénéfique au profit du développement local ainsi que les villes et les métropoles dont l’extension et l’interconnexion sont de nature à créer des points nodaux de première importance dans les domaines du développement économique, du progrès social et de l’environnement. L’auteur de l’ouvrage ne néglige pas de souligner la persistance des conflits et l’action des mouvements terroristes qui causent des déplacements forcés de populations dans des camps et augmentent la pauvreté des populations subsahariennes. Des problèmes majeurs mettent à mal les efforts des gouvernants de bonne volonté en quête de progrès, les crises sanitaires et les maladies récurrentes (paludisme, tuberculose, sida), la gestion de l’eau et l’assainissement, l’insécurité alimentaire et la mutation du monde rural, les atteintes portées par l’exploitation minière à la biodiversité et aux réserves animalières, la lente et patiente conquête de la démocratie.
|
Au fil de la lecture
Au Sud, les Hollandais fondent la colonie du Cap en 1652, prise par les Britanniques en 1806 en raison de sa position stratégique sur la route maritime des Indes.
¤
Mais plus encore que les classes moyennes, c’est l’émergence de ce que le philosophe Achille Mbembe appelle les Afropolitains (artistes, intellectuels ou hommes d’affaires qui font beaucoup pour l’image de leur continent d’origine) qui mérite attention et qui donne à voir une population métropolitaine, mondialisée et interconnectée.
¤
Un dessin du cartooniste sud-africain Zapiro permet de dresser une géographie des clichés développés par certains Sud-Africains sur le reste du continent : Angola, Namibie, Botswana, Tanzanie ou Somalie abritent des « aliens ». Le Zimbabwe n’est que « la poubelle de Mugabe ». Le Soudan est le pays des réfugiés, la République démocratique du Congo celui des gardiens de parking, le Nigeria celui des dealers de drogue et le Maroc « n’est pas vraiment l’Afrique ».
¤
L’activité minière, si elle connaît un certain renouveau, n’est pas nouvelle en Afrique subsaharienne. Sans remonter à l’époque médiévale et à l’importance du commerce de l’or, notamment en Afrique de l’Ouest, elle a été dans certaines régions un puissant élément de l’exploitation coloniale des territoires. Ainsi en est-il de la riche région minière de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe, de la Zambie et du Katanga (RDC), surnommée Copper Belt (« ceinture de cuivre »). Celle-ci a connu une véritable colonisation industrielle et urbaine autour des mines, structurée par les réseaux ferrés, dont les paysages portent encore la marque.
¤
En matière de production cinématographique, on connaît Nollywood. Deuxième puissance cinématographique au monde depuis 2009, derrière l’Inde (Bollywood) et devant les États-Unis (Hollywood), le Nigeria produit chaque année 2 000 films vidéos, dont le coût total estimé ne dépasse pas 20 millions d’euros. Or, début 2017, l’entreprise Eutelsat évaluait à 60 millions le nombre de téléviseurs en Afrique subsaharienne et anticipait une progression de 25 % sur les 5 prochaines années. En outre, la consommation de vidéos sur smartphone progresse à un rythme soutenu. À ces changements d’usage s’ajoute la libéralisation des paysages audiovisuels, à mesure que les pays passent à la télévision numérique terrestre (TNT). Tout cela crée un fort besoin de contenus : sur un marché mondial de 15 milliards d’euros, la part de l’Afrique subsaharienne a doublé en quatre ans et dépasse désormais le milliard. L’exemple nigérian fait donc rêver d’autres pays, à l’instar de la Côte d’Ivoire, qui aimerait voir émerger un Babiwood (Babi étant le surnom d’Abidjan).
¤
|
- L’Afrique subsaharienne, par Jean-Fabien Steck, la Documentation française, collection documentation photographique n° 8121, janvier-février 2018, 64 pages.
Portrait
Jean Malrieu, l’enchanteur de Montauban
Est-ce la distance, aux différents sens du vocable, qui permet à un poète de révéler l’œuvre d’un confrère d’une contrée plus lointaine ? En l’occurrence, homme du Nord, Pierre Dhainaut (Lille, 1935) 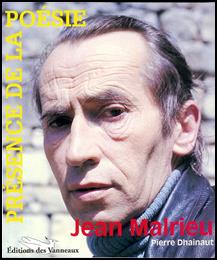 m’aura donné à aimer de son ami Jean Malrieu, poète du Sud, le tempérament, la sensibilité, le génie qui l’habitaient. « Cette force, cette rage, Jean Malrieu la tire de l’amour, la célébration d’une femme, l’exaltation d’un couple. » « Tout est à sa place au pays, indique encore le poète et écrivain lillois, c’est l’amour comblé ». Et pourtant, la quête de l’amour, du bonheur, emprunte des chemins pavés d’aléas et de déconvenues : « Je suis épouvantablement heureux », s’exclame Jean Malrieu (Montauban, 29 août 1915-Penne d’Agenais, 24 avril 1975). m’aura donné à aimer de son ami Jean Malrieu, poète du Sud, le tempérament, la sensibilité, le génie qui l’habitaient. « Cette force, cette rage, Jean Malrieu la tire de l’amour, la célébration d’une femme, l’exaltation d’un couple. » « Tout est à sa place au pays, indique encore le poète et écrivain lillois, c’est l’amour comblé ». Et pourtant, la quête de l’amour, du bonheur, emprunte des chemins pavés d’aléas et de déconvenues : « Je suis épouvantablement heureux », s’exclame Jean Malrieu (Montauban, 29 août 1915-Penne d’Agenais, 24 avril 1975).
« Jean Malrieu s’établit à Marseille comme instituteur en 1948, rapporte l’écrivain et critique d’art Alain Paire. Poète et militant communiste [il s’éloigna cependant du Parti en 1956], il fut remarqué par Louis Aragon qui publia ses textes en 1950 dans "Les Lettres françaises". L’année suivante, il créait, avec son ami Gérald Neveu, la revue "Action poétique". Simultanément, avec l’appui de Jean Tortel qui préfaça son premier recueil "Préface à l’amour", il fréquentait Jean Ballard et l’équipe des "Cahiers du Sud". L’arrêt de cette revue en 1966 l’incita à créer, en 1970, "Sud", en compagnie d’Yves Broussard. »
Les soirées tarnaises et les surréalistes
« Les soirées, chez lui, raconte Yves Broussard, étaient extraordinaires. Il lisait ses poèmes et ceux de ses amis proches ou lointains, dont Pierre Dhainaut, qu’il retrouvait chaque été dans son "Tarn natal", les Dhainaut passant leurs vacances à Vaour, à dix kilomètres de Penne d’Agenais ; et aussi de Gaston Puel, Jean Digot, André Laude, Georges Herment, Jean-Noël Agostini, et bien d’autres. Il parlait très souvent de Tortel, de Gros [Léon-Gabriel], de Ballard et, bien sûr, des "Cahiers du Sud" qui publièrent son premier recueil "Préface à l’Amour" [1953, prix Guillaume Apollinaire 1954],
 à propos duquel André Breton lui écrivit : "Je suis jaloux de vos poèmes". Nous sortions le soir [à Marseille] avec d’autres amis poètes : Jean-Luc Sarré, Roger Meyère, Albert Chénier, Francis Livon, notamment. Nous allions écouter quelques chanteurs-poètes, dont Livon et Chénier, dans un bar, aujourd’hui disparu, "Chez Sam", sur le Vieux-Port, là où débuta Bernard Lavilliers. » Il aimait aussi le jazz et fréquenta André Breton (avec lequel il visita Montségur) et ses disciples sans adhérer pleinement au surréalisme. Ses écrits rappellent maintes fois la veine surréaliste : « Le silence revient dans son auto noire », « La mémoire est sonore, c’est le tambour des morts », « Car l’âme c’est ce qui fait crier les airs », ou encore dans le recueil « Possible imaginaire » (Pierre-Jean Oswald éditeur, 1975), « Celle que j’aime s’appelle Rigueur. C’est signe / Que je suis soumis aux lois terrestres de l’invisible / Je suis blanc comme l’oubli. »
à propos duquel André Breton lui écrivit : "Je suis jaloux de vos poèmes". Nous sortions le soir [à Marseille] avec d’autres amis poètes : Jean-Luc Sarré, Roger Meyère, Albert Chénier, Francis Livon, notamment. Nous allions écouter quelques chanteurs-poètes, dont Livon et Chénier, dans un bar, aujourd’hui disparu, "Chez Sam", sur le Vieux-Port, là où débuta Bernard Lavilliers. » Il aimait aussi le jazz et fréquenta André Breton (avec lequel il visita Montségur) et ses disciples sans adhérer pleinement au surréalisme. Ses écrits rappellent maintes fois la veine surréaliste : « Le silence revient dans son auto noire », « La mémoire est sonore, c’est le tambour des morts », « Car l’âme c’est ce qui fait crier les airs », ou encore dans le recueil « Possible imaginaire » (Pierre-Jean Oswald éditeur, 1975), « Celle que j’aime s’appelle Rigueur. C’est signe / Que je suis soumis aux lois terrestres de l’invisible / Je suis blanc comme l’oubli. »
La magie du feu et la féérie de la terre
Dans « Une visite chez Jean Malrieu », Henri-Michel Polvan explique que « l’Enchanteur - c’est ainsi qu’il le nomme - en appelle à la magie du feu dans un poème de toute beauté qui, en mai 68, à Marseille, recouvrit spontanément les murs de la cité ; un poème où flambent ces mots : "Si le bonheur n’est pas de ce monde nous partirons à sa rencontre. / Nous avons pour l’apprivoiser les merveilleux manteaux de l’incendie" ("Levée en masse", in "Hectares de soleil"). » « Il faut savoir écouter ce poème d’un bout à l’autre de sa belle mèche enflammée, recommande plus loin l’écrivain marseillais. Jean Malrieu trouvait dérisoires les "bonnes intentions" poétiques appliquées aux luttes sociales. Il jugeait d’ailleurs pareillement toute menée artistique entreprise sous le signe de quelque urgence d’ordre utilitaire. Mais il allait parfois plus loin encore dans ce sens, ne craignant pas de déclarer carrément contre-indiquées les actions poétiques qui se soldent par une critique au tout premier degré de la "société de consommation". »
À Penne d’Agenais, il écrit « Le Château cathare » (Seghers, 1972) dans une baraque en bois, un abri de jardinier en fait qui jouxte la vieille demeure où il reçoit ses amis. La nature, les senteurs de la terre, les moissons, les arbres, le feu et les fleurs alimentent une poésie gourmande et sensuelle.  « La terre est une légende, une féérie permanente, s’enthousiasme son ami le poète et journaliste André Laude (1936-1995). Et Malrieu dresse amoureusement la carte de cette féérie : insectes, plantes, eaux, herbes, papillons, enclose dans le paysage de Penne d’Agenais. Chez lui, le poème n’a vraiment ni commencement ni fin. On peut même dire que chaque poème est un fragment d’un seul et vaste poème. » « La terre est une légende, une féérie permanente, s’enthousiasme son ami le poète et journaliste André Laude (1936-1995). Et Malrieu dresse amoureusement la carte de cette féérie : insectes, plantes, eaux, herbes, papillons, enclose dans le paysage de Penne d’Agenais. Chez lui, le poème n’a vraiment ni commencement ni fin. On peut même dire que chaque poème est un fragment d’un seul et vaste poème. »
En 1975, Jean Malrieu prit sa retraite et s’installa à Bruniquel, village voisin de Penne d’Agenais, logeant dans la conciergerie du château dont il était devenu le guide occasionnel et inspiré. C’est là qu’une tique le piqua en 1976, ce qui ne l’empêcha pas de se rendre à Toulouse pour signer « le Plus Pauvre Héritier » que l’éditeur Privat venait de publier avec les illustrations du peintre surréaliste Adrien M. Dax. Conduit à l’hôpital de Montauban, le poète occitan de langue française décéda le 24 avril.
- Vesper, par Jean Malrieu, préface de Jean Tortel, prix Antonin Artaud 1963, éditions la Fenêtre ardente, 47 pages, 1962 ;
- Le Nom secretsuivi de La Vallée des rois, par Jean Malrieu, introduction de Georges Mounin, éd. P.-J. Oswald, 198 pages, 1968 ;
- Jean Malrieu, par Pierre Dhainaut, éditions Subervie, collection Visages de ce temps, 64 pages, 1972 ;
- Jean Malrieu, par Pierre Dhainaut, éditions des Vanneaux, collection Présence de la poésie n° 2, 2007, 174 pages ;
- Libre comme une maison en flammes - œuvre poétique 1935-1976, éd. Le Cherche midi, 510 pages, 2004.
Lectures complémentaires :
- Une visite chez Jean Malrieu, par Henri-Michel Polvan, préface de Jacques Lucchesi, éditions du Port d’Attache, 40 pages, 2010 ;
- Avec Jean Malrieu, l’amour n’est pas une légende, par Charles Dobzynski, revue « Aujourd’hui Poème », n° 58, février 2005 ;
- Jean Malrieu, défenseur de la Civilisation du Sud, par Yves Broussard, revue « Aujourd’hui Poème », n° 58, février 2005 ;
- La Poésie inadmissible, par André Laude, revue « Planète » n° 3, décembre 1968/janvier 1969 ;
- Dictionnaire des Marseillais, publié sous la direction de Jean Chélini, Félix Reynaud et Madeleine Villard, notice d’Alain Paire, Académie de Marseille, 368 pages, 2001.
Varia : les souffleurs de sucre
« Dans l’Antiquité chinoise, les habitants de l’ancien royaume de Chu qui occupait une partie des provinces actuelles du Hubei et du Hunan donnaient des figurines de caramel en offrande aux mânes de leurs ancêtres ; le savoir-faire des souffleurs de sucre est né de cette coutume. Jadis, la plupart des souffleurs de sucre vivant aux alentours de deux villes du Hubei, Tianmen et Mianyang (actuelle Xiantao), 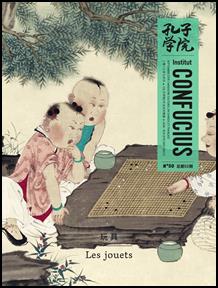 avaient pour habitude d’aller à la morte saison exercer leur activité dans d’autres campagnes, favorisant ainsi la transmission des tours de main qu’ils avaient longuement forgés. avaient pour habitude d’aller à la morte saison exercer leur activité dans d’autres campagnes, favorisant ainsi la transmission des tours de main qu’ils avaient longuement forgés.
« Les souffleurs de sucre faisaient cuire du maltose dans de l’eau, y ajoutaient des pigments rouges, bleus ou noirs en fonction de la douzaine de teintes qu’ils voulaient utiliser, puis à l’aide d’outils très simples - ciseaux, petit peigne, serpette - ils soufflaient, malaxaient, séparaient, pinçaient, appuyaient et coupaient pour façonner la forme recherchée. Dorénavant, les souffleurs de sucre sont présents dans toute la Chine ; ils s’inspirent d’animaux mis en valeur par la tradition - volatiles, bêtes sauvages - ainsi que de personnages légendaires pour produire de véritables petits tableaux pleins d’intérêt et d’une grande variété, intitulés par exemple "que des années d’abondance se succèdent", ou bien "les deux dragons se disputent une perle", ou encore "la licorne apporte un bébé", créations qui ne manquent jamais de susciter l’accueil enthousiaste de leur public.
« Autrefois, il fut un temps où souffler le sucre était une activité novatrice et captivante. Les souffleurs de sucre, une malle en bois sur leur dos, partaient vers le Sud, trottaient vers le Nord. Tantôt ils haranguaient le chaland depuis les profondeurs d’une ruelle, tantôt un attroupement se faisait autour d’eux dans la grande rue ; il arrivait aussi que l’on rencontrât un souffleur de sucre dans une modeste allée. Dong, Dong, Dong… De loin résonnaient quelques coups de gongs. Alors les gamins savaient que le souffleur de sucre était là ! […]
« En règle générale, l’art ancien des souffleurs de sucre était autrefois transmis de père en fils. »
Extraits de « Au royaume des peintres et souffleurs de sucre », enquête de Wang Sisi, issue de la revue Institut Confucius, n° 50, dossier « Les jouets », septembre 2018, 80 pages.
Carnet : les cinq éléments de l’acupuncture
L’acupuncture utilise la circulation de l’énergie par l’intermédiaire de méridiens qui parcourent le corps depuis la tête jusqu’aux pieds, en reliant les organes entre eux suivant une classification particulière que l’on nomme théorie des 5 éléments. Ainsi les maladies sont traitées en stimulant certains points de méridiens relevant de l’organe concerné. Maître de conférences à l’université de Provence, Jean-Claude Crescenzo enseigne que la manupuncture coréenne agit de la même manière sur le même nombre de méridiens réduits à l’échelle de la main, ce que l’on appelle les Ki Mek. Divers moyens sont utilisés comme les aiguilles, les moxas (petits cônes d’armoise que l’on fait chauffer sur la région sensible de la main), des aimants ainsi que le stylet électronique. Quelquefois, si la douleur n’est pas trop intense, une simple pression ou un léger massage sur le point concerné permet de traiter efficacement et rapidement le déséquilibre, voire la maladie.
(Mardi 15 octobre 2019)
Philosophie en clef de sol
« Qu’est d’autre notre vie, écrivait le compositeur allemand Robert Schumann (1810-1856), sinon un accord de septième plein de doutes, qui porte en lui des désirs insatisfaits et des espoirs insatiables ? »
Audition colorée
Saviez-vous que l’écrivain Alfred de Musset (1810-1857) disposait d’une audition colorée ? Il aimait raconter, en tout cas, qu’il avait toutes les peines du monde à démontrer à sa famille que le fa était jaune et le sol rouge. Olivier Messiaen (1908-1992) jouissait d’une même capacité. Le compositeur reconnaissait mentionner, sur ses partitions de chef d’orchestre, les couleurs correspondant aux sons, cela afin de renforcer ses sensations musicales pour diriger son orchestre dans les meilleures conditions.
(Mercredi 16 octobre 2019)
Les scorpions de l’éditeur
À la fin des années 1970-1980, le Péruvien Esteban Quiroz Cisneros devenait imprimeur et éditeur, rêvant de créer « une armée de scorpions dressés à piquer la curiosité et à vaincre l’ignorance ».
De l’urbanité
Je ne comprends pas pourquoi tant de centres urbains soient aussi dénués d’urbanité.
(Jeudi 24 octobre 2019)
|
Billet d’humeur
Marianne est occitane !
Beauté quelque peu hiératique, affublée d’un curieux couvre-chef (bonnet phrygien ou casque grec), osant parfois de vertigineux décolletés - quand elle ne se découvre pas les seins nus ! - elle toise les administrés avec superbe et indifférence. Allégorie de la liberté républicaine, elle tourne encore la tête de bien des historiens. Certains d’entre eux en effet se demandent encore pourquoi et à partir de quand son prénom est apparu, et pourquoi celui-ci plutôt qu’un autre. Actuellement, la plus ancienne occurrence connue - et attestée par Frédéric Mistral et Maurice Agulhon - de l’emploi de Marianne pour désigner la France en République est une chanson patriotique en langue d’oc, « La Garison de Marianno » (La Guérison de Marianne). Cordonnier et chansonnier d’origine protestante devenu instituteur, Guillaume Lavabre (Puylaurens, 1755-Toulouse, 1845), l’a composée en 1792 à l’occasion de la proclamation de la République, idéologie politique prégnante après la mort de Louis XVI. Les paroles de la chanson réfèrent métaphoriquement à l’actualité d’août-novembre 1792 : la guérison, c’est le soulagement après l’insurrection du 10 août 1792 et la saignée bénéfique (le massacre des gardes suisses au palais des Tuileries), suivies des victoires de la jeune armée révolutionnaire contre les armées austro-prussiennes aux frontières du nord-est et des Alpes. À l’époque, Marie et Anne qui donneront Marianne sont des prénoms très répandus dans les milieux populaires, notamment à la campagne où les filles aînées sont envoyées comme domestiques dans les maisons bourgeoises de la ville. Le village tarnais de Puylaurens n’est pas peu fier d’être le lieu de naissance du chansonnier jacobin. Quand bien même celui-ci écrivit après 1814 des poèmes à la gloire de la monarchie restaurée ! Cet écart ne lui porta pas bonheur, car il mourut dans la misère, en 1845, dans un hospice toulousain.
|
Lecture critique
« Être forêts » de Jean-Baptiste Vidalou : le credo d’un rebelle
Champ d’action, refuge, lieu de résistance ou de rébellion, la forêt est en danger. Depuis des lustres. En 2700 avant Jésus-Christ, les Sumériens la saccageaient déjà. Nous savons aussi que la cité de Rome naquit des clairières qu’elle tailla dans les forêts du Latium. Et en France, les dommages causés aux espaces boisés ont trouvé leur justification sous l’Occupation, en octobre 1942, lorsque le gouvernement de Vichy a relancé la décentralisation industrielle et l’aménagement du territoire. Il s’agissait alors d’appliquer une politique de grands travaux d’équipement en industrialisant le rendement agricole, en repensant le réseau de communication avec l’ouverture de routes nationales en 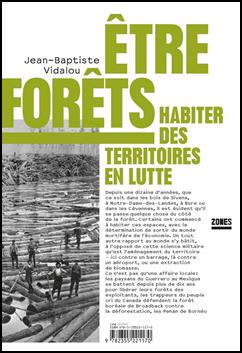 direction des voisins européens et en multipliant les cités-satellites autour des grandes villes. Auteur d’un savant brûlot, « Être forêts - Habiter des territoires en lutte », Jean-Baptiste Vidalou accuse la science militaire qu’est, selon lui, l’aménagement du territoire d’être la cause d’une dévastation abominable des forêts mondiales qui entre 2000 et 2012 auraient perdu 2,3 millions de km2, soit l’équivalent de 50 terrains de football par minute ! Il enferme dans sa condamnation les politiques et les ingénieurs, ceux-là mêmes qui ont planifié depuis plus de trois siècles la coupe claire des forêts au profit de la marine, des forges et des hauts-fourneaux, des étayages de galeries d’extraction, des traverses de chemin de fer et des centrales à biomasse. Jean-Baptiste Vidalou qui se qualifie bâtisseur en pierre sèche et agrégé de philosophie cache son patronyme sous celui d’un héros de la guerre des Demoiselles menée en Ariège au XIXe siècle : de 1829 à 1872, les montagnards pyrénéens ont combattu les propriétaires des bois et des forges pour conserver les droits d’usage de leurs ancêtres. Après avoir vécu sept ans dans les bois, il se tient aux côtés des rebelles des ZAD (zones à défendre) qui habitent les mêmes lieux à Tronçay dans le Morvan, à Sivens, à Notre-Dame des Landes, à Roybon, à Bure ou dans les Cévennes, là où « le passé insurgé peut se lire à même le territoire ». Depuis belle lurette, les zadistes qui désavouent le monde cynique et sinistre de l’économie ont multiplié les blocages des infrastructures mortifères portées par l’aménagement du territoire. direction des voisins européens et en multipliant les cités-satellites autour des grandes villes. Auteur d’un savant brûlot, « Être forêts - Habiter des territoires en lutte », Jean-Baptiste Vidalou accuse la science militaire qu’est, selon lui, l’aménagement du territoire d’être la cause d’une dévastation abominable des forêts mondiales qui entre 2000 et 2012 auraient perdu 2,3 millions de km2, soit l’équivalent de 50 terrains de football par minute ! Il enferme dans sa condamnation les politiques et les ingénieurs, ceux-là mêmes qui ont planifié depuis plus de trois siècles la coupe claire des forêts au profit de la marine, des forges et des hauts-fourneaux, des étayages de galeries d’extraction, des traverses de chemin de fer et des centrales à biomasse. Jean-Baptiste Vidalou qui se qualifie bâtisseur en pierre sèche et agrégé de philosophie cache son patronyme sous celui d’un héros de la guerre des Demoiselles menée en Ariège au XIXe siècle : de 1829 à 1872, les montagnards pyrénéens ont combattu les propriétaires des bois et des forges pour conserver les droits d’usage de leurs ancêtres. Après avoir vécu sept ans dans les bois, il se tient aux côtés des rebelles des ZAD (zones à défendre) qui habitent les mêmes lieux à Tronçay dans le Morvan, à Sivens, à Notre-Dame des Landes, à Roybon, à Bure ou dans les Cévennes, là où « le passé insurgé peut se lire à même le territoire ». Depuis belle lurette, les zadistes qui désavouent le monde cynique et sinistre de l’économie ont multiplié les blocages des infrastructures mortifères portées par l’aménagement du territoire.
« Au-delà de la financiarisation de la nature, dont toutes les bonnes âmes de nos pays condamnent les abus, déplore J.-B. Vidalou, ce qui contamine la planète depuis plus de trois cents ans, c’est bien cette maladie tout occidentale qui consiste à réduire le monde à des lignes de comptes. […] Qu’il s’agisse de grains ou de salamandres, d’orchidées ou de bois-énergie, peu importe : on parle toujours de calcul, de standard, d’équivalence. L’idée même de biodiversité, tant chérie par les écologues, correspond moins à la grande prise de conscience environnementale qu’on nous vante qu’à un stade supplémentaire dans la pure mise en chiffres du vivant. » « La forêt n’est pas un gisement de biomasse, une zone d’aménagement différé, une réserve de biosphère, un puits de carbone, la forêt, et c’est là son credo, c’est un peuple qui s’insurge, c’est une défense qui s’organise, ce sont des imaginaires qui s’intensifient. »
- Être forêts - Habiter des territoires en lutte, par Jean-Baptiste Vidalou, éditions Zones/La Découverte, 200 pages, 2017.
Portrait
Quand on parle du loup
 Lorsqu’en novembre 1992, un loup est repéré dans le parc national du Mercantour, lors d’un comptage de chamois et de mouflons au vallon de Mollières (Alpes-Maritimes), son statut légal est chamboulé. Après avoir été longtemps tenu pour nuisible (raison pour laquelle fut constitué, en 812, sous le roi Charlemagne, le corps des lieutenants de louveterie), le loup gris (Canis lupus Linné) est désormais protégé (par la convention de Berne - à l’instar du lynx et de l’ours - et la directive Habitat-faune-flore). En vingt ans, la population lupine est passée à 360 individus (répartis en 52 meutes), selon les estimations de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Sur les 29 zones de présence permanente de l’animal recensées en France (lorsque sa présence est constatée pendant au moins deux hivers consécutifs), 27 ont été localisées dans le seul massif alpin. Mais la viabilité génétique de la population ne serait atteinte qu’entre 2 500 et 5 000 individus adultes, selon une expertise de 2017 publiée par l’ONCFS et le Muséum national d’histoire naturelle à Paris. 360 ? 500 ? Les chiffres font débat entre partisans et détracteurs du loup. La précision arithmétique est importante, car elle sert de base de calcul au plafond de loups qui pourront être abattus légalement pour protéger les troupeaux (10 à 12 % chaque année selon le Plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage). Lorsqu’en novembre 1992, un loup est repéré dans le parc national du Mercantour, lors d’un comptage de chamois et de mouflons au vallon de Mollières (Alpes-Maritimes), son statut légal est chamboulé. Après avoir été longtemps tenu pour nuisible (raison pour laquelle fut constitué, en 812, sous le roi Charlemagne, le corps des lieutenants de louveterie), le loup gris (Canis lupus Linné) est désormais protégé (par la convention de Berne - à l’instar du lynx et de l’ours - et la directive Habitat-faune-flore). En vingt ans, la population lupine est passée à 360 individus (répartis en 52 meutes), selon les estimations de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Sur les 29 zones de présence permanente de l’animal recensées en France (lorsque sa présence est constatée pendant au moins deux hivers consécutifs), 27 ont été localisées dans le seul massif alpin. Mais la viabilité génétique de la population ne serait atteinte qu’entre 2 500 et 5 000 individus adultes, selon une expertise de 2017 publiée par l’ONCFS et le Muséum national d’histoire naturelle à Paris. 360 ? 500 ? Les chiffres font débat entre partisans et détracteurs du loup. La précision arithmétique est importante, car elle sert de base de calcul au plafond de loups qui pourront être abattus légalement pour protéger les troupeaux (10 à 12 % chaque année selon le Plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage).
Le chien descend du loup
En étudiant des crânes et des mâchoires de chiens provenant de fouilles en Europe, au Proche-Orient et en Sibérie, les archéologues les ont datés de 14 000 ans : les ossements des canidés étaient enterrés aux côtés d’humains chasseurs-cueilleurs. D’autres chercheurs sont allés plus loin en affirmant avoir identifié, en Sibérie et en Belgique, des chiens vieux de 33 000 et 42 000 ans, en somme à l’arrivée d’Homo sapiens. Mais leur thèse n’a pu être validée. La communauté scientifique retient donc aujourd’hui la seule période 15 000 à 12 000 ans pour situer l’apparition du Canis familiaris Linné. Ils sont convaincus que l’autre canidé, Canis lupus Linné, a été domestiqué au même moment et que mélangé au chien d’Asie il a donné l’actuel chien domestique. Le chien est le premier animal à avoir été apprivoisé et domestiqué avant même que les hommes ne passent du statut de chasseurs-cueilleurs nomades à celui d’agriculteurs-éleveurs sédentaires lors de la révolution néolithique, vers 8 500 ans avant J.-C.
4 à 6 louveteaux par portée
Le carnivore vit en meute, qui compte entre deux et huit individus en Europe, sur un territoire de 150 à 300 km2. Il mange en moyenne 2 à 5 kg de viande par jour, mais peut jeûner plusieurs journées et compenser ensuite. Son régime alimentaire est composé de 75 à 90 % d’animaux sauvages (chevreuils ou lièvres) et de 6 à 10 % d’animaux domestiques (ovins, bovins et caprins). Il en existe plus de vingt sous-espèces à la surface de la planète, dont le poids varie de 20 kilos, dans les déserts de l’Inde, à 80 kilos, dans le Grand Nord.  Le loup se reproduit une fois par an, entre les mois de janvier et d’avril, à raison de quatre à six louveteaux par portée. Il se déplace en ligne, plaçant ses pas dans ceux du précédent et les pattes arrières dans les traces de celles de devant pour économiser l’énergie de la déambulation. Le loup se reproduit une fois par an, entre les mois de janvier et d’avril, à raison de quatre à six louveteaux par portée. Il se déplace en ligne, plaçant ses pas dans ceux du précédent et les pattes arrières dans les traces de celles de devant pour économiser l’énergie de la déambulation.
Partisans du loup et opposants montrent les crocs
Nul doute que la présence dans les Alpes de grands massifs forestiers, d’aires protégées et de terrains agricoles et pastoraux abandonnés a facilité sa colonisation en France et en Italie. Les zones accidentées et riches en proies sont naturellement favorables à l’installation durable et dispersée du mammifère qui se satisfait pleinement d’écosystèmes pauvres en se nourrissant de déchets et en chassant bétail, chiens et chats. Dans ces espaces, les ongulés sauvages - cerfs, chamois, chevreuils et sangliers - dont l’effectif avait fondu dans les années 1970 constituent des proies vitales pour le loup. « La population de mouflons, qui abondait dans les Alpes du Sud, a été la première victime du retour de Canis lupus en France, explique Jean-Marc Moriceau, historien des campagnes françaises qui signe chez Actes Sud "Le Loup en questions - Fantasme et réalité". Son repli et son adaptation au nouveau contexte conduisent le loup à se reporter sur le chamois. » Il était inévitable que la présence accrue du prédateur se heurte au monde agropastoral qui se maintient en pratiquant un élevage extensif avec une main-d’œuvre minimale, une forme d’agriculture dont la préservation est devenue un véritable enjeu politique.
Les interrogations nées du loup hybridé
À la suite d’enquêtes effectuées après la mort de brebis ou de moutons, des chasseurs et des forestiers se demandent si le loup hybridé, révélé par des analyses ADN (acide désoxyribonucléique), n’aggraverait pas le phénomène de la prédation en raison de caractères physiologiques et comportementaux différents des caractères du loup de lignée pure. Chez les associations de défense des animaux, on reconnaît que le pastoralisme est indispensable au maintien d’une activité socio-économique en montagne et qu’il participe à l’entretien des paysages et des écosystèmes ; on souligne avec la même conviction à la fois le rôle unique joué par le loup dans l’équilibre de la chaîne alimentaire et de la biodiversité et la nécessité vitale d’une gestion concertée de l’espèce dont les intérêts s’opposent à ceux des éleveurs et des bergers. « Tout imparfaite qu’elle soit dans les préférences à accorder, selon les lieux, au pastoralisme ou au prédateur sauvage, l’action politique ne peut s’exercer qu’à l’échelle européenne, reconnaît J.-M. Moriceau (professeur à l’université de Caen). L’expérience dont on dispose de part et d’autre des Alpes appelle des arbitrages internationaux. »
Jean-Marc Moriceau © Photo X, droits réservés
- Le Loup en questions - Fantasme et réalité, par Jean-Marc Moriceau, éditions Buchet-Chastel, collection Dans le vif, 128 pages, 2015.
Lectures complémentaires :
- Le Loup - Le retour du sauvage, revue « Billebaude », éditions Glenat et fondation François Sommer, n° 4, juin 2014, 96 pages ;
- La forêt de Boscodon, par Claude Darras et David Tresmontant, Naturalia Publications, 224 pages, 2019.
Varia : de la bonne maîtrise des mathématiques à l’Académie royale d’architecture
« Alors que les mathématiques occupent une place centrale dans l’enseignement à l’Académie royale d’architecture dès sa fondation en 1671, puisque son premier professeur et directeur, François Blondel, était avant tout un mathématicien,
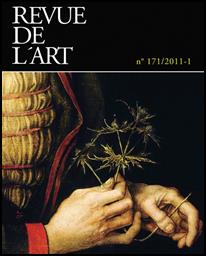 l’historiographie de l’histoire de l’enseignement des sciences dans la France de l’époque moderne ne mentionne quasiment jamais le rôle de l’institution dans la diffusion du savoir mathématique. [...] l’historiographie de l’histoire de l’enseignement des sciences dans la France de l’époque moderne ne mentionne quasiment jamais le rôle de l’institution dans la diffusion du savoir mathématique. [...]
« Or, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’Académie royale d’architecture proposait avec le Collège de France le seul cours public hebdomadaire de mathématiques de la capitale accessible à tous les auditeurs. Mathématiques et architecture étant intimement liées selon la conception classique, les deux cours étaient dispensés par le même professeur […].
« Depuis Vitruve, les auteurs de traités d’architecture insistent sur l’universalité du savoir de l’architecte et surtout sur la nécessité d’une bonne maîtrise des mathématiques. L’article 41 des statuts de l’Académie royale d’architecture délivrés en 1717 précise que "nul ne sera nommé élève de l’Académie [..] qu’il ne sçache lire et écrire et les premières règles d’arithmétique [et] une teinture des lettres et de la géométrie". Dans l’article "Architecte" de l’Encyclopédie, Jacques-François Blondel, professeur d’architecture de l’Académie de 1762 à 1774, définit les connaissances nécessaires à l’architecte en importance décroissante : d’abord le dessin, puis les mathématiques, puis la coupe des pierres et enfin la perspective. À l’École royale gratuite de dessin fondée par Jean-Jacques Bachelier en 1767, "le but de l’institution est d’enseigner […] les principes élémentaires de la géométrie pratique, de l’architecture et des différentes parties du dessin relatives aux arts mécaniques". Ce lien entre architecture et mathématiques, que l’on retrouve dans la plupart des écoles de dessin qui fleurirent au XVIIIe siècle en France, dérive très certainement de l’exemple de l’Académie d’architecture, même si cette dernière n’a jamais cherché, contrairement à l’Académie de peinture et de sculpture, à mettre sous tutelle les écoles provinciales. On assista pourtant au sein de l’Académie royale d’architecture de Paris à un éloignement de plus en plus important entre les deux enseignements. »
Extraits de l’article de Basile Baudez, archiviste paléographe, maître de conférences en histoire du patrimoine moderne et contemporain à l’université de Paris-Sorbonne, « Les mathématiques à l’Académie royale d’architecture dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », étude issue de la « Revue de l’art », n° 171/2011-1, publiée par l’Institut national d’histoire de l’art et les éditions Ophrys, 80 pages.
Carnet : ce bon vieux Mathusalem !
Le romancier Tristan Bernard (1866-1947) s’exclamait : « L’étonnant n’est pas que Mathusalem ait vécu sept cent vingt ans, c’est qu’à cinq cent trente ans… il ne les faisait pas ! »
(Jeudi 31 octobre 2019)
Miroir
Ces notations journalières où s’inscrivent dans un ordre apparent les températures de l’âme et du cœur procèdent forcément de l’intimité de l’écrivain que je suis qui se regarde en fait dans un miroir de papier.
Présence scénique
Louis Jouvet avait une telle présence sur scène qu’il lui suffisait de remarquer : « Tiens ! il est déjà onze heures ! », pour que dans la salle les spectateurs regardent tout de suite leur montre !
(Mardi 12 novembre 2019)
|
Billet d’humeur
La bonne fortune de New York
Spécialisé dans le commerce de la fourrure, un petit comptoir est à l’origine de New York, ville mythique aux yeux des Européens avant de devenir la destination rêvée des candidats à l’émigration de l’ensemble de la planète. Les fondateurs de la ville née au printemps 1626 et appelée d’abord Nouvelle-Amsterdam sont des Wallons persécutés en Belgique pour leur protestantisme qui ont trouvé refuge sur une des petites îles jusqu’alors habitées par les Indiens, en majorité des Algonquins. Ces émigrés sont des employés de la compagnie hollandaise des Indes occidentales, créée en 1621. Cinq années plus tard, ils arrachent un accord aux Amérindiens et achètent l’île de Manhattan pour 60 florins. L’île est bientôt investie par une population nombreuse où les protestants francophones de Wallonie côtoient les Hollandais et se mêlent aux immigrants venus des États allemands ainsi qu’aux esclaves noirs, aux Amérindiens et à une petite communauté juive. En 1664, Londres s’empare de la Nouvelle-Amsterdam et la rebaptise New York, en hommage à son nouveau maître, Jacques Stuart, duc d’York et futur roi d’Angleterre. La colonie d’alors constitue déjà un rouage essentiel du commerce international entre l’Europe, l’Afrique et le Nouveau Monde. Deux siècles plus tard, le développement économique de la ville marqué par une courbe ascendante et une longue durée est caractérisé par un essor industriel sans précédent (à partir des années 1880) et par une emprise financière spectaculaire (mise en place au XIXe siècle) : de 25 banques commerciales en 1845, on passe à 506 en 1883 !
|
Lecture critique
La fabrique du mensonge et de l’ignorance démasquée
par Stéphane Foucart
Parce qu’elle est sous la tutelle de l’économie de marché, l’alliance de la science et de la technique n’est pas sauve de manipulations qui provoquent des préjudices irréparables aux populations, dans les domaines de l’alimentation et de la santé humaines notamment. Journaliste scientifique au quotidien Le Monde, Stéphane Foucart (né en 1973) explique dans « La Fabrique du mensonge » comment certains industriels instrumentalisent la science à des fins mercantiles et délictueuses. Aux États-Unis, les fabricants de cigarettes ont sollicité des « experts » de la communauté scientifique qui, sans nécessairement être corrompus, paraissent plus sensibles aux intérêts industriels qu’à l’intérêt général. « Les grandes universités américaines ont eu, à un moment ou à un autre, recours à l’argent du tabac, confirme l’auteur. Pas moins de six scientifiques américains qui furent  plus tard lauréats du prix Nobel de physiologie et de médecine ont aussi mené une part de leurs travaux grâce à ces fonds. » En focalisant leur communication sur la qualité des recherches et la réussite des découvertes de leurs « experts », les cigarettiers détournent habilement l’opinion des dangers du tabac. Alors que, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la cigarette a tué environ cent millions d’individus au cours du XXe siècle. Un autre scandale sanitaire a été révélé dans les années 1960-1970, chez les industriels de l’amiante cette fois. À ce moment-là, des recherches établissaient le lien existant entre le mésothéliome, un cancer des voies respiratoires presque exclusivement lié à l’amiante, et la fibre minérale inhalée, même à très faibles doses, tandis que des scientifiques répandaient l’idée d’un « usage contrôlé de l’amiante » ! Le résultat de cette manipulation a été calculé par des épidémiologistes de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) : entre 1996 et 2025, environ cent mille personnes devraient mourir prématurément, en France, de leur exposition à cet « or blanc » qu’est l’amiante ! Nouvelle classe d’insecticides, les néonicotinoïdes sont la cause de l’accélération du déclin des abeilles domestiques : en 2009, l’université de Warwick (à Coventry, en Angleterre) annonçait qu’une bourse de 1 million de livres sterling était octroyée à un groupe de chercheurs afin d’« investiguer sur le déclin des abeilles ». Las ! dans ce projet, le conseil de recherche donateur, Biotechnology and Biological Sciences Research Council, comptait comme partenaire la société suisse Syngenta qui commercialise le Cruiser, l’un des néonicotinoïdes les plus mortifères ! L’ouvrage pointe d’autres catastrophes ou/et aberrations engendrées par l’incompétence ou la malhonnêteté de scientifiques du monde académique : les perturbateurs endocriniens prescrits dès les années 1940 aux femmes souffrant de risques de fausses couches mais dont on interdit l’un, le distilbène, 30 ans plus tard après la découverte de graves malformations chez les enfants des femmes ayant pris ce médicament ; le Round Up si décrié de nos jours n’a jamais fait l’objet de tests toxicologiques. Seul le glyphosate (sa molécule active) a été testé alors que l’herbicide est un composé de plusieurs autres substances… Remarquablement documenté et pourvu d’un argumentaire toujours pertinent, « La Fabrique du mensonge » incite son lectorat à la plus grande circonspection devant la formidable production d’ignorance générée par les industriels et les scientifiques marrons : « On a vu comment la force de persuasion de l’argument scientifique permet de faire passer un poison pour un remède, une servitude pour une liberté, un péril certain pour un progrès possible… ». plus tard lauréats du prix Nobel de physiologie et de médecine ont aussi mené une part de leurs travaux grâce à ces fonds. » En focalisant leur communication sur la qualité des recherches et la réussite des découvertes de leurs « experts », les cigarettiers détournent habilement l’opinion des dangers du tabac. Alors que, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la cigarette a tué environ cent millions d’individus au cours du XXe siècle. Un autre scandale sanitaire a été révélé dans les années 1960-1970, chez les industriels de l’amiante cette fois. À ce moment-là, des recherches établissaient le lien existant entre le mésothéliome, un cancer des voies respiratoires presque exclusivement lié à l’amiante, et la fibre minérale inhalée, même à très faibles doses, tandis que des scientifiques répandaient l’idée d’un « usage contrôlé de l’amiante » ! Le résultat de cette manipulation a été calculé par des épidémiologistes de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) : entre 1996 et 2025, environ cent mille personnes devraient mourir prématurément, en France, de leur exposition à cet « or blanc » qu’est l’amiante ! Nouvelle classe d’insecticides, les néonicotinoïdes sont la cause de l’accélération du déclin des abeilles domestiques : en 2009, l’université de Warwick (à Coventry, en Angleterre) annonçait qu’une bourse de 1 million de livres sterling était octroyée à un groupe de chercheurs afin d’« investiguer sur le déclin des abeilles ». Las ! dans ce projet, le conseil de recherche donateur, Biotechnology and Biological Sciences Research Council, comptait comme partenaire la société suisse Syngenta qui commercialise le Cruiser, l’un des néonicotinoïdes les plus mortifères ! L’ouvrage pointe d’autres catastrophes ou/et aberrations engendrées par l’incompétence ou la malhonnêteté de scientifiques du monde académique : les perturbateurs endocriniens prescrits dès les années 1940 aux femmes souffrant de risques de fausses couches mais dont on interdit l’un, le distilbène, 30 ans plus tard après la découverte de graves malformations chez les enfants des femmes ayant pris ce médicament ; le Round Up si décrié de nos jours n’a jamais fait l’objet de tests toxicologiques. Seul le glyphosate (sa molécule active) a été testé alors que l’herbicide est un composé de plusieurs autres substances… Remarquablement documenté et pourvu d’un argumentaire toujours pertinent, « La Fabrique du mensonge » incite son lectorat à la plus grande circonspection devant la formidable production d’ignorance générée par les industriels et les scientifiques marrons : « On a vu comment la force de persuasion de l’argument scientifique permet de faire passer un poison pour un remède, une servitude pour une liberté, un péril certain pour un progrès possible… ».
- La Fabrique du mensonge - Comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger, par Stéphane Foucart, éditions Denoël, collection Impacts, 304 pages, 2013.
Portrait
Non-lieu pour la « Marseille délinquante »
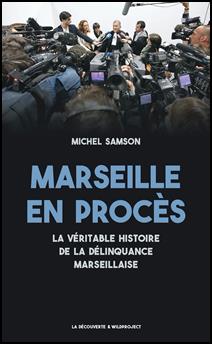 La littérature, le cinéma, la politique, la police et la justice concourent par la voix de certains de leurs représentants à accréditer la thèse selon laquelle la cité phocéenne serait l’une des villes les plus criminogènes de France. Certes, deux formes de délinquance se côtoient à Marseille qui s’allient parfois. D’un côté, un banditisme de tradition, très développé, et, de l’autre, des vols, cambriolages, trafics de stupéfiants, conduite sans permis ou détention d’armes, mais rien n’est plus faux que de conclure à l’existence d’une capitale du délit et du crime. Dans un livre très documenté et constellé de témoignages souvent inédits, Michel Samson (qui fut correspondant régional du Monde en Provence-Alpes Côte d’Azur de 1996 à 2008 après avoir appartenu à la rédaction de Libération) explique comment le mythe d’une « Marseille délinquante » s’est développé et maintenu jusqu’à nos jours. Outre le recours à des centaines de documents filmiques, littéraires et journalistiques ainsi qu’aux analyses éclairées d’historiens et de sociologues, l’auteur qui enquête depuis des décennies sur les réalités marseillaises a jugé opportun entre 2012 et 2016 d’assister, le plus souvent possible, aux audiences du tribunal de Marseille, jusqu’aux plus banales, des audiences qui révèlent selon lui la vraie nature de la délinquance. La littérature, le cinéma, la politique, la police et la justice concourent par la voix de certains de leurs représentants à accréditer la thèse selon laquelle la cité phocéenne serait l’une des villes les plus criminogènes de France. Certes, deux formes de délinquance se côtoient à Marseille qui s’allient parfois. D’un côté, un banditisme de tradition, très développé, et, de l’autre, des vols, cambriolages, trafics de stupéfiants, conduite sans permis ou détention d’armes, mais rien n’est plus faux que de conclure à l’existence d’une capitale du délit et du crime. Dans un livre très documenté et constellé de témoignages souvent inédits, Michel Samson (qui fut correspondant régional du Monde en Provence-Alpes Côte d’Azur de 1996 à 2008 après avoir appartenu à la rédaction de Libération) explique comment le mythe d’une « Marseille délinquante » s’est développé et maintenu jusqu’à nos jours. Outre le recours à des centaines de documents filmiques, littéraires et journalistiques ainsi qu’aux analyses éclairées d’historiens et de sociologues, l’auteur qui enquête depuis des décennies sur les réalités marseillaises a jugé opportun entre 2012 et 2016 d’assister, le plus souvent possible, aux audiences du tribunal de Marseille, jusqu’aux plus banales, des audiences qui révèlent selon lui la vraie nature de la délinquance.
Naissance d’un mythe
Dès 1881, Alphonse Daudet fait état de l’ascension d’une « mafia méridionale » dans un roman, « Numa Roumestan ». Mais la légende bâtit ses fondements littéraires dans les années 1920 lorsque Albert Londres dévide dans les colonnes du Petit Parisien une série d’articles qui seront rassemblés en un volume sous le titre « Marseille, porte du Sud » (1927). Avec son film « Justin de Marseille », le réalisateur Maurice Tourneur inventorie les bas-fonds du Vieux-Port en 1935 où il est question de mauvais garçons et du vol d’une cargaison d’opium. Les décennies suivantes, le roman policier et le septième art alimentent, selon une infernale surenchère, la saga de la pègre à Marseille, le Milieu que protègent des élus et des flics pourris. « L’emploi de malfaiteurs par les hommes politiques, précise à cet égard Laurence Montel, est un des aspects du clientélisme partisan pratiqué par l’ensemble des partis. » Mais l’historienne ajoute que l’utilisation de personnages douteux par les collectivités territoriales n’a rien de spécifiquement marseillais. Rappelant le statut de port importateur de stupéfiants que Marseille acquit à la fin du XIXe siècle, le sociologue Laurent Mucchielli date l’apparition d’un milieu corso-marseillais à l’issue de la Première Guerre mondiale lorsque les drogues ont été prohibées. Après la Seconde Guerre mondiale, les marins marseillais d’origine corse ont grandement contribué à la pérennité de ce statut en développant les liaisons clandestines avec l’Indochine, colonie française jusqu’en 1954 d’où arrivait l’opium. « Cette réalité n’a jamais disparu, observe L. Mucchielli, quel que soit le trafic - opium, héroïne et maintenant le cannabis. » « On oublie souvent de préciser, explique la journaliste Louise Fessard (Mediapart), que Marseille est la ville la plus inégalitaire de France. En 2007, les 10 % des Marseillais le plus riches déclaraient 14,3 fois plus que les 10 % les plus pauvres. Quelque 44 % des enfants y vivaient sous le seuil de pauvreté. » La combinaison de fragilités familiales, d’échecs scolaires et l’absence de perspective professionnelle favorisent inéluctablement l’entraînement dans la délinquance.
Le procureur happé par le mythe
La corporation des journalistes n’est pas indemne de reproches, loin s’en faut, dans la déformation de l’image de Marseille et l’auteur de citer des faits-diversiers (journalistes spécialisés dans le fait divers) prompts à conforter à travers leur chronique la légende noire de la ville. Ce sont parfois les mêmes qui influencent les magistrats eux-mêmes… Ainsi Michel Samson s’étonne de trouver dans un livre, sous la plume d’un procureur de la République qui a officié cinq ans à Marseille, des considérations aussi fallacieuses que l’image tronquée d’une cité phocéenne gouvernée par les mafias : « Les sources principales sur les milieux délinquants qu’il cite dans son livre viennent en tout cas de la presse, soutient l’écrivain et journaliste, ce qui semble un peu étrange pour un homme de justice. La conclusion de son chapitre sur Marseille mérite d’ailleurs citation : "Je vais rester dans cet univers en assistant à l’avant-première du film 'L’Immortel'. […] Jean Reno incarne avec sa sobriété habituelle une figure du grand banditisme marseillais, miraculeusement réchappée d’une tentative d’assassinat. J’aime les polars nerveux, tournés à l’américaine, avec un souci de réalisme dans les scènes violentes. Un défoulement paradoxal. En tout cas, pas de quoi me changer les idées." »
- Marseille en procès - La véritable histoire de la délinquance marseillaise, par Michel Samson, éditions La Découverte/Wildproject, 224 pages, 2017.
Varia : Paul Gauguin et le passage de l’inspiration à l’exécution
« Le tableau "D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?" (1897) constitue une sorte de récapitulation du passé pictural de Paul Gauguin. Et c’est à son propos pourtant que l’artiste est parvenu, dans la solitude où il vivait, à se poser les questions les plus neuves qu’il ait agitées, depuis près de dix ans, depuis très exactement l’année passée auprès d’Émile Bernard et de Van Gogh. Or ses réflexions s’orientent déjà vers ce qui, en Europe aussi, va hanter les jeunes peintres dans le demi-siècle à venir : la revendication d’une liberté totale dans l’acte de peindre. 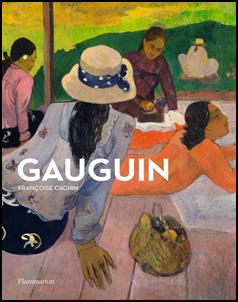 Par exemple, il semble se poser au cours de cette année, avec une acuité particulière, le problème du passage de l’inspiration à l’exécution. Il est obsédé par l’idée de conserver toute la fraîcheur et la vérité de l’impulsion inconsciente : "Où commence l’exécution d’un tableau, où finit-elle ? Au moment où des sentiments extrêmes sont en fusion au plus profond de l’être, au moment où ils éclatent, et que toute la pensée sort comme la lave d’un volcan, n’y a-t-il pas là une éclosion de l’œuvre soudainement créée, brutale si l’on veut, mais grande et d’apparence surhumaine ?" Car il a le sentiment que son tableau, pourtant si chargé de réminiscences, a la puissance de ce qui naît d’instinct. Il retrouve les thèmes les plus à la mode de la philosophie contemporaine, ceux de la puissance créatrice privilégiée de l’instinct et de "l’élan vital". En même temps, il cherche dans une direction qui aura plus d’importance dans la dernière partie de sa production, et qui le conduira bientôt à une plus grande liberté, une plus grande indépendance envers une idéologie symboliste souvent bien encombrante. Il se moque, à propos de Bouguereau, de la "volonté artistique", et évoque à plusieurs reprises les charmes du "non finito", comme le Delacroix romantique du Journal qu’il avait peut-être emporté. C’est d’ailleurs une fois de plus au peintre romantique qu’il a recours, pour se justifier auprès du critique Fontainas d’un reproche sur la monotonie de ses tons, à ce Delacroix dont les "accords répétés de marron et de violet sourds, manteau sombre, vous suggèrent le drame" et immédiatement après, il retrouve, pour parler d’un Tahiti mythique qu’il quête désespérément dans le quotidien, des accents baudelairiens : "Ici, près de ma case, en plein silence, je rêve à des harmonies violentes dans les parfums naturels qui me grisent. Délice relevé de je ne sais quelle horreur sacrée que je devine vers l’immémorial. Autrefois, odeur de joie que je respire dans le présent." » Par exemple, il semble se poser au cours de cette année, avec une acuité particulière, le problème du passage de l’inspiration à l’exécution. Il est obsédé par l’idée de conserver toute la fraîcheur et la vérité de l’impulsion inconsciente : "Où commence l’exécution d’un tableau, où finit-elle ? Au moment où des sentiments extrêmes sont en fusion au plus profond de l’être, au moment où ils éclatent, et que toute la pensée sort comme la lave d’un volcan, n’y a-t-il pas là une éclosion de l’œuvre soudainement créée, brutale si l’on veut, mais grande et d’apparence surhumaine ?" Car il a le sentiment que son tableau, pourtant si chargé de réminiscences, a la puissance de ce qui naît d’instinct. Il retrouve les thèmes les plus à la mode de la philosophie contemporaine, ceux de la puissance créatrice privilégiée de l’instinct et de "l’élan vital". En même temps, il cherche dans une direction qui aura plus d’importance dans la dernière partie de sa production, et qui le conduira bientôt à une plus grande liberté, une plus grande indépendance envers une idéologie symboliste souvent bien encombrante. Il se moque, à propos de Bouguereau, de la "volonté artistique", et évoque à plusieurs reprises les charmes du "non finito", comme le Delacroix romantique du Journal qu’il avait peut-être emporté. C’est d’ailleurs une fois de plus au peintre romantique qu’il a recours, pour se justifier auprès du critique Fontainas d’un reproche sur la monotonie de ses tons, à ce Delacroix dont les "accords répétés de marron et de violet sourds, manteau sombre, vous suggèrent le drame" et immédiatement après, il retrouve, pour parler d’un Tahiti mythique qu’il quête désespérément dans le quotidien, des accents baudelairiens : "Ici, près de ma case, en plein silence, je rêve à des harmonies violentes dans les parfums naturels qui me grisent. Délice relevé de je ne sais quelle horreur sacrée que je devine vers l’immémorial. Autrefois, odeur de joie que je respire dans le présent." »
Extrait de « Près du Golgotha - 1895-1901 », issu de « Gauguin », monographie par Françoise Cachin (1936-2011), directeur honoraire des Musées de France, éditions Flammarion, 312 pages, 2017.
Carnet : le temps des révisions
« De 1900 à 1930, remarque à juste raison le sociologue Michel Maffesoli (Graissessac, 1944), on commençait à réformer les croyances héritées d’un XIXe siècle trop positiviste et à revoir les idées reçues. D’un côté, les surréalistes menaient tambour battant la révolution dans les têtes : ils changeaient la couleur des mots et repeignaient la lune avec le "bleu" d’une "orange", mais surtout ils lançaient la mode de l’art nègre, en exaltant la conscience artiste de ceux que l’on qualifiait encore de "primitifs", et tournaient vers l’Afrique des regards langoureux. » Le temps des révisions n’a de cesse de corriger les plus sottes affirmations de nos contemporains. Ainsi plus d’une antique négresse nue au musée du quai Branly-Jacques Chirac nous rappelle à une mortifiante humilité tant elles savent exprimer, avec une totale plénitude des sens, le plus brûlant érotisme libéré des interdits que ne cesse de tramer la morale d’hier et d’aujourd’hui.
L’invention des poids et mesures
Quand bien même elle prend appui sur le méridien terrestre, la masse de l’eau et la base dix, toute mesure n’est pas « naturelle ». Le système des poids et mesures a été instauré, par convention, il s’agit d’une pure invention culturelle.
(Vendredi 22 novembre 2019)
Poésie de l’épure
L’idéal pour le diariste est d’écrire des sortes de poèmes où tout surgirait de quatre ou cinq mots, pas davantage, sans qu’il soit besoin d’expliciter. L’idéal consiste à exprimer l’essence des choses comme y parvient Nicolas De Staël. Dans certaines de ses peintures, il y a tout, la lumière, le premier plan, l’horizon, l’au-delà de l’horizon. Tout est là, le monde entier est contenu dans le trait et la couleur et juste dans le trait et la couleur, eux-mêmes réduits à l’essentiel.
Des chiffres et des lettres
L’invention de l’écriture n’a pas été le fait d’un poète mais d’un comptable. En effet, dès les temps reculés, à Sumer ou bien ailleurs, c’est la nécessité d’entreprendre le décompte des sacs de grain et des têtes de bétail qui a entraîné la naissance de l’écriture. L’assyriologue Jean Bottéro (1914-2007) aura été un des premiers historiens à le dire : « L’écriture mésopotamienne est probablement née de besoins et de nécessités d’économie et d’administration, et toute préoccupation religieuse, ou proprement "intellectuelle", paraît bien devoir être exclue de ses origines ». À méditer.
(Samedi 30 novembre 2019)
Les couleurs de la vue
Notre rétine est constituée d’environ sept millions de cônes qui permettent de voir les couleurs et de bâtonnets qui ne perçoivent que le noir et le blanc et enregistrent les intensités lumineuses. Cellules de la rétine, les cônes réagissent aux fréquences de trois couleurs : le bleu, le vert et le rouge, et les retransmettent au cerveau. À partir de ces données, celui-ci fabrique les images que nous voyons.
Borges-Calvino : anecdote
Lors d’un dîner à Rome en l’honneur de Jorge Luis Borges, dans un silence de convives intimidés par le grand aveugle, son voisin de table l’informa de la présence de l’écrivain et philosophe Italo Calvino. Borges répliqua aussitôt : « Je l’avais deviné à l’intensité de son silence. »
(Dimanche 1er décembre 2019)
|
Billet d’humeur
Les mystères du pigeon voyageur
Depuis que les Égyptiens, il y a près de 4 000 ans, ont utilisé Columba livia pour acheminer des messages, le même constat revient en boucle : comment les pigeons voyageurs retrouvent-ils leur volière après des voyages de plusieurs centaines de kilomètres ? La même question revient obséder, en une sorte de ritournelle, les travaux des scientifiques engagés dans la conférence internationale sur l’orientation animale. À la fin des années 1950, tout le monde pensait que les oiseaux migrateurs s’orientaient grâce aux étoiles ou au soleil. On a ensuite parlé du champ magnétique terrestre, comme d’autres ont avancé le rôle des odeurs apportées par les vents ou bien encore le repérage visuel (mémorisation du paysage) ou sonore (guidage par infrasons). Las ! Les questions s’emboîtent comme des poupées russes, mais le questionnement ne connaît pas de fin : quels instruments le volatile utilise-t-il pour se repérer, « carte » ou « boussole » ? Quels signaux sont employés ? Quel(s) organe(s) les détecte(nt) ? Qu’en fait le cerveau ? Dans cet organe, quelles molécules et/ou quels gènes sont impliqués ? S’agit-il d’une capacité innée ou apprise ? Le pigeon biset (Columba livia) n’est pas l’unique cobaye étudié par les ornithologues, même si les oiseaux se taillent la part du lion - rouge-gorge, rousserolle effarvatte, fauvette des jardins, diamant mandarin, gobe-mouche noir, paruline rayée, etc. Les sangliers, tortues de mer, phoques, langoustes, saumons, truites, anguilles, papillons de nuit, fourmis ou grenouilles sont soumis aux mêmes interrogations. Le mécanisme de l’orientation animale reste obstinément inconnu : l’ignorance des éthologistes ne s’est jamais manifestée aussi crûment.
|
Lecture critique
Le roman outre-noir de Jérôme Leroy
 Fils unique d’un notaire, Joël Jugan est un ancien leader du groupe d’extrême gauche Action Rouge dont les exactions - braquages et crimes - l’ont fait condamner à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement dans les quartiers de haute sécurité. En vacances à Paros, au cœur des Cyclades, le narrateur se rappelle dans quelles conditions, douze ans plus tôt, il a croisé ce personnage énigmatique et inquiétant à sa sortie de la centrale de Bapaume. Enseignant au collège Barbey d’Aurevilly de Noirbourg, dans le Cotentin, il le voit débarquer un matin à la terrasse de la brasserie de Paris où ont coutume de se retrouver professeurs et collégiens. Dès lors, il cherche à le connaître mieux, à comprendre les motivations de son engagement, à dissiper l’aura mystérieuse qui habite encore le révolutionnaire. Les réponses à ses interrogations lui sont apportées, parcimonieusement distillées, par une militante de gauche et féministe obstinée, Clotilde Mauduit, qui a pris part au mouvement Action Rouge. C’est elle qui a recruté le narrateur en sa qualité de conseillère principale d’éducation au sein d’une équipe d’aide aux élèves de la zone d’éducation prioritaire (ZEP) Fils unique d’un notaire, Joël Jugan est un ancien leader du groupe d’extrême gauche Action Rouge dont les exactions - braquages et crimes - l’ont fait condamner à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement dans les quartiers de haute sécurité. En vacances à Paros, au cœur des Cyclades, le narrateur se rappelle dans quelles conditions, douze ans plus tôt, il a croisé ce personnage énigmatique et inquiétant à sa sortie de la centrale de Bapaume. Enseignant au collège Barbey d’Aurevilly de Noirbourg, dans le Cotentin, il le voit débarquer un matin à la terrasse de la brasserie de Paris où ont coutume de se retrouver professeurs et collégiens. Dès lors, il cherche à le connaître mieux, à comprendre les motivations de son engagement, à dissiper l’aura mystérieuse qui habite encore le révolutionnaire. Les réponses à ses interrogations lui sont apportées, parcimonieusement distillées, par une militante de gauche et féministe obstinée, Clotilde Mauduit, qui a pris part au mouvement Action Rouge. C’est elle qui a recruté le narrateur en sa qualité de conseillère principale d’éducation au sein d’une équipe d’aide aux élèves de la zone d’éducation prioritaire (ZEP) 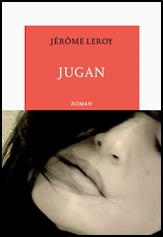 de Noirbourg, enfants des HLM et des camps sinti et rom. Étudiante en comptabilité, Assia Rafa partage son temps entre les bénévoles du groupe d’aide et la supérette de la ZEP que gère son père, Samir.
Elle tombe sous le charme vénéneux de l’anarcho-communiste qui causera sa perte… Au-delà de l’intrigue, « Jugan » brosse le portrait d’un militant intraitable et ambigu. « Il avait le regard froid du théoricien, du terroriste, dit de lui le narrateur, mais aussi du libertin, un regard. Le même au bout du compte. Il disait prendre modèle sur Robespierre mais il admirait Roger Vailland dont Clotilde Mauduit m’avait dit qu’il était le seul écrivain qu’il ait lu et relu en prison, notamment "Drôle de jeu" et "Écrits intimes". » Roman outre-noir, « Jugan » célèbre le mal absolu : « C’est en face de Jugan que j’ai éprouvé pour la première et dernière fois de ma vie, avec une certitude presque animale que le mal existait et qu’il était une forme d’énergie dévastatrice, comme l’"aristéïa" qui s’empare des guerriers dans "L’Illiade" et leur fait soudain massacrer sans pitié des centaines d’adversaires. » de Noirbourg, enfants des HLM et des camps sinti et rom. Étudiante en comptabilité, Assia Rafa partage son temps entre les bénévoles du groupe d’aide et la supérette de la ZEP que gère son père, Samir.
Elle tombe sous le charme vénéneux de l’anarcho-communiste qui causera sa perte… Au-delà de l’intrigue, « Jugan » brosse le portrait d’un militant intraitable et ambigu. « Il avait le regard froid du théoricien, du terroriste, dit de lui le narrateur, mais aussi du libertin, un regard. Le même au bout du compte. Il disait prendre modèle sur Robespierre mais il admirait Roger Vailland dont Clotilde Mauduit m’avait dit qu’il était le seul écrivain qu’il ait lu et relu en prison, notamment "Drôle de jeu" et "Écrits intimes". » Roman outre-noir, « Jugan » célèbre le mal absolu : « C’est en face de Jugan que j’ai éprouvé pour la première et dernière fois de ma vie, avec une certitude presque animale que le mal existait et qu’il était une forme d’énergie dévastatrice, comme l’"aristéïa" qui s’empare des guerriers dans "L’Illiade" et leur fait soudain massacrer sans pitié des centaines d’adversaires. »
Jérôme Leroy © Patrice Normand, Leemage
- Jugan, par Jérôme Leroy, éditions de la Table ronde, collection Vermillon, 220 pages, 2015.
Portrait
Enquête sur les fêtes de la Nativité : entre folklore et dévotion
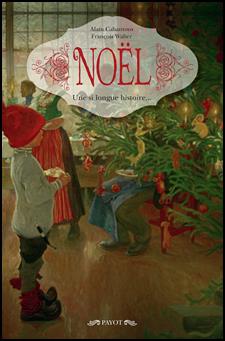 L’ouvrage d’Alain Cabantous (né en 1946) et de François Walter (né en 1950), « Noël - Une si longue histoire… », est une véritable somme, un corpus où les deux historiens des mentalités racontent et analysent les multiples mutations des fêtes de la Nativité, principalement à travers le continent européen, durant les cinq derniers siècles. En dépit des interrogations persistantes que suscite la liesse noëlique, les auteurs commentent avec lucidité les interprétations de la Nativité, leur instrumentalisation religieuse puis politique. Et ils cernent avec autant de pertinence les enjeux portés par cette fête éminemment populaire, tout à la fois religieuse et sociale, collective et familiale. Leur tâche n’est pas aisée et ils se perdent en conjectures dans la détermination de la date de naissance du Christ. Les sources n’ont pourtant pas manqué aux enquêteurs, qu’il s’agisse de l’analyse des textes bibliques, des archives ecclésiastiques, des travaux et thèses d’historiens, des traités de théologie, d’astronomie et de philosophie, des recueils des folkloristes, des textes législatifs, des correspondances entre chercheurs et érudits, des œuvres littéraires, picturales et musicales. Noël reste un objet protéiforme, éternellement changeant avec la profusion de ses rites et la pérennité de ses coutumes. L’ouvrage d’Alain Cabantous (né en 1946) et de François Walter (né en 1950), « Noël - Une si longue histoire… », est une véritable somme, un corpus où les deux historiens des mentalités racontent et analysent les multiples mutations des fêtes de la Nativité, principalement à travers le continent européen, durant les cinq derniers siècles. En dépit des interrogations persistantes que suscite la liesse noëlique, les auteurs commentent avec lucidité les interprétations de la Nativité, leur instrumentalisation religieuse puis politique. Et ils cernent avec autant de pertinence les enjeux portés par cette fête éminemment populaire, tout à la fois religieuse et sociale, collective et familiale. Leur tâche n’est pas aisée et ils se perdent en conjectures dans la détermination de la date de naissance du Christ. Les sources n’ont pourtant pas manqué aux enquêteurs, qu’il s’agisse de l’analyse des textes bibliques, des archives ecclésiastiques, des travaux et thèses d’historiens, des traités de théologie, d’astronomie et de philosophie, des recueils des folkloristes, des textes législatifs, des correspondances entre chercheurs et érudits, des œuvres littéraires, picturales et musicales. Noël reste un objet protéiforme, éternellement changeant avec la profusion de ses rites et la pérennité de ses coutumes.
Entre Saturnales et Calendes
Un fait semble sûr : la fête de Noël s’est imposée à la chrétienté au cours du IVe siècle, au milieu des célébrations romaines des Saturnales qui marquent le retour provisoire du dieu Saturne, détrôné par son fils Jupiter, et les Calendes qui célèbrent le passage à l’an nouveau. Il semble que les célébrations se soient concentrées sur le jour même et sa vigile, autrement dit les 24 et 25 décembre en Occident, les 5 et 6 janvier en Orient. « Pour l’historien, soutiennent MM. Cabantous et Walter, le problème est de trancher entre les éléments proprement liturgiques  des origines et l’agrégat progressif d’autres composantes, considérées au XIXe siècle comme des traditions populaires. » Ils accordent beaucoup de crédit à l’Évangile de Luc où il est dit que Joseph, accompagné de son épouse Marie qui est enceinte, doit quitter Nazareth pour se faire recenser en Judée, à Bethléem, sa ville natale. Marie accouche durant le déplacement et, ne trouvant pas de place dans une salle d’hôtes, dépose son bébé dans la mangeoire d’une étable. L’évangéliste ne parle ni des deux animaux de la crèche, le bœuf et l’âne, ni des mages venus d’Orient. Pour en savoir davantage, il convient de compulser les évangiles dits « apocryphes » (inauthentiques pour les Églises) qui regorgent de détails et d’anecdotes en ce qui concerne la tradition narrative et iconographique de Noël. Ainsi il est dit que le vierge Marie a enfanté et qu’ensuite elle est restée vierge. Le thème de la virginité maternelle est très largement diffusé dans la culture religieuse. D’autres dieux ou fondateurs de courants religieux se sont vu attribuer une vierge pour mère : Horus en Égypte, Attis en Phrygie, Indra au Tibet, Adonis à Babylone, Mithra et Zoroastre en Perse. des origines et l’agrégat progressif d’autres composantes, considérées au XIXe siècle comme des traditions populaires. » Ils accordent beaucoup de crédit à l’Évangile de Luc où il est dit que Joseph, accompagné de son épouse Marie qui est enceinte, doit quitter Nazareth pour se faire recenser en Judée, à Bethléem, sa ville natale. Marie accouche durant le déplacement et, ne trouvant pas de place dans une salle d’hôtes, dépose son bébé dans la mangeoire d’une étable. L’évangéliste ne parle ni des deux animaux de la crèche, le bœuf et l’âne, ni des mages venus d’Orient. Pour en savoir davantage, il convient de compulser les évangiles dits « apocryphes » (inauthentiques pour les Églises) qui regorgent de détails et d’anecdotes en ce qui concerne la tradition narrative et iconographique de Noël. Ainsi il est dit que le vierge Marie a enfanté et qu’ensuite elle est restée vierge. Le thème de la virginité maternelle est très largement diffusé dans la culture religieuse. D’autres dieux ou fondateurs de courants religieux se sont vu attribuer une vierge pour mère : Horus en Égypte, Attis en Phrygie, Indra au Tibet, Adonis à Babylone, Mithra et Zoroastre en Perse.
De la liturgie canonique aux traditions populaires
Au fil du temps et des pays concernés (parfois des provinces d’une même nation), les fêtes de la Nativité connaissent une débauche d’innovations et de transferts culturels où les récupérations idéologiques et commerciales sont légion. Parmi les célébrations, plus ou moins imprégnées de la liturgie canonique ou des traditions profanes, nous citerons quelques personnages ou éléments constitutifs de la fête de Noël.
• Évêque de Myre, Saint-Nicolas (270-330), fêté le 6 décembre dans les pays germaniques, dans le nord de la France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse, est devenu le modèle de l’être bienveillant pourvoyeur de cadeaux : en dehors de l’Italie, on compterait plus de deux mille cinq cents sanctuaires qui lui ont été dédiés entre le XIe et le XVIe siècles ;
• Au XIe siècle apparaissent les noëls, petites poésies pieuses et rimées qui mêlent latin et langue vernaculaire ; ils accompagnent le jeu des mystères en référence aux louanges chantées par les bergers dans la nuit de Noël ;
• La ville de Sélestat, en Alsace, s’enorgueillit de compter dans ses archives la première mention de sapins de Noël en 1521 ;
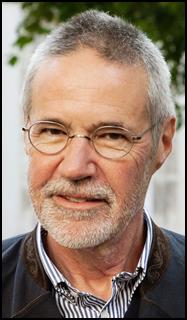 • Le santon (petit saint, de l’italien « santibelli ») de la crèche domestique provençale est d’abord composé de plâtre que vendent les colporteurs d’origine italienne. Ouvrier mouleur dans une faïencerie, Jean-Louis Lagnel (1764-1822) est le premier fabricant de santons à avoir utilisé l’argile et à produire des figurines par moulage, séchées à l’air et destinées à peupler une crèche ; • Le santon (petit saint, de l’italien « santibelli ») de la crèche domestique provençale est d’abord composé de plâtre que vendent les colporteurs d’origine italienne. Ouvrier mouleur dans une faïencerie, Jean-Louis Lagnel (1764-1822) est le premier fabricant de santons à avoir utilisé l’argile et à produire des figurines par moulage, séchées à l’air et destinées à peupler une crèche ;
• Autour des crèches publiques, en Provence, se jouaient des pastorales où s’entrecroisaient dialogues parlés et chants connus. Probablement imaginé par l’abbé Thobert vers 1770, le genre se développa surtout après 1840 à l’initiative d’un ouvrier miroitier marseillais, Antoine Maurel (1815-1897) ;
• Un peintre londonien, John Callot Horsley (1817-1903), dessine en décembre 1843 la première carte de Noël, imprimée à mille exemplaires. La première carte de correspondance du monde est expédiée de Vienne, en Autriche, le 1er octobre 1869 : trois millions de cartes sont vendues jusqu’à la fin de l’année ;
• En 1927, la radio finnoise révèle le lieu auparavant tenu secret de la résidence du père Noël, Korvatunturi en Laponie. En 1950, le village du Père Noël est déplacé sur le cercle polaire, à Rovaniemi où sont désormais adressées les missives des enfants sages.
Entre folklore et dévotion, « Noël - Une si longue histoire… » révèle une enquête passionnante sur un phénomène social devenu universel.
Alain Cabantous © Patrice Normand
François Walter © Patrice Normand
- Noël - Une si longue histoire… par Alain Cabantous et François Walter, éditions Payot, 416 pages, 2016.
Varia : le patrimoine et la règle du feu
« Aussi loin qu’on puisse remonter, le feu destructeur est lié dans notre imaginaire à la guerre et ses malheurs. Raconté par Homère, l’incendie mythique de Troie a marqué durablement l’Occident : c’est la mère des cités détruites par le feu des vainqueurs au long des guerres de notre pauvre humanité. Plus près de nous, les Allemands n’ont pas oublié comment les troupes de Louis XIV ont incendié Heidelberg et ravagé le Palatinat, ni les Flamands comment les rayons de ce même Roi-Soleil ont enflammé Bruxelles en 1695. La mécanique du feu militaire est partout la même, sous toutes les latitudes : quand les Républicains brûlent les villages du bocage vendéen ; quand les Russes préfèrent incendier Moscou en 1812 que d’y laisser triompher Napoléon ; quand les Anglais mettent à sac Washington en 1814 ; quand la guerre porte le feu à Reims en 1914, dès l’automne et les premières offensives allemandes ; on bien quand les nazis incendient les résidences impériales autour de Saint-Pétersbourg… Ajoutons-y les hideuses destructions causées par l’idéologie, qui puise dans le feu une force dévastatrice démultipliée : l’exemple le plus cruel est celui de la Commune de 1871, qui a mis méthodiquement le feu aux plus beaux monuments parisiens - "du passé, faisons table rase", n’est-ce pas. […]
 « Les monuments brûlent également, et pour des raisons diverses. Il existe des incendies politiques, comme celui, machiavélique, du Reichstag en 1933, ou encore criminels, comme ceux du siège historique du Crédit lyonnais de Paris en 1996, lié aux "affaires", ou de la Fenice à Venise, pour une sombre histoire d’assurances. Mais le plus souvent, l’incendie est accidentel. Il est parfois dû au déchaînement des éléments, telle la foudre, comme à l’église de Lavau-sur-Loire en août 1994 ou à Saint-Amans-Soult (Tarn) en octobre 2018, mais plus sûrement à la bêtise des hommes. Un outil mal éteint, un mégot de cigarette jeté négligemment, un court-circuit dans un réseau vétuste ou mal installé : des causes dérisoires et minuscules provoquent, par extension, des catastrophes immenses, entraînant des chantiers longs et coûteux pour la collectivité. […] « Les monuments brûlent également, et pour des raisons diverses. Il existe des incendies politiques, comme celui, machiavélique, du Reichstag en 1933, ou encore criminels, comme ceux du siège historique du Crédit lyonnais de Paris en 1996, lié aux "affaires", ou de la Fenice à Venise, pour une sombre histoire d’assurances. Mais le plus souvent, l’incendie est accidentel. Il est parfois dû au déchaînement des éléments, telle la foudre, comme à l’église de Lavau-sur-Loire en août 1994 ou à Saint-Amans-Soult (Tarn) en octobre 2018, mais plus sûrement à la bêtise des hommes. Un outil mal éteint, un mégot de cigarette jeté négligemment, un court-circuit dans un réseau vétuste ou mal installé : des causes dérisoires et minuscules provoquent, par extension, des catastrophes immenses, entraînant des chantiers longs et coûteux pour la collectivité. […]
« Parmi les édifices sujets aux incendies, si l’on excepte les lieux de pouvoir, toujours à la merci des flammes révolutionnaires, deux catégories se détachent nettement : les théâtres et les cathédrales. Les premiers, lieu confiné où les bougies sont autant de menaces fragiles, mais redoutables, semblent même faits pour brûler, y compris après les progrès de l’électricité… Le foyer, seule pièce alors chauffée par une cheminée, y porte un nom prédestiné. Quant aux cathédrales, elles possèdent dans leurs combles des forêts de bois et dans leurs flèches des aiguilles qui peuvent attirer les foudres du ciel. Elles n’ont pas cessé de prendre feu, même après le développement du voûtement de pierre qui a remplacé les plafonds en bois apparents des premiers édifices chrétiens. Depuis la cathédrale de Chartres, en 1020, jusqu’à Notre-Dame il y a six mois, résonne une litanie d’incendies. Heureusement, ces voûtes de pierre jouent un rôle de coupe-feu, en préservant l’édifice entier des flammes qui dévorent sans pitié son couronnement. »
L’auteur présente ensuite dix cas d’incendies de monuments remarquables : la Sainte-Chapelle en 1630, la cathédrale de Rouen (1822), la cathédrale de Chartres (1836), la cathédrale de Metz (1877), la cathédrale de Reims (1914), le château de Hautefort (1968), le Parlement de Bretagne (1994), le château de Lunéville (2003), l’hôtel de ville de La Rochelle (2013) et l’hôtel Lambert (2013).
Extraits de « Patrimoine en flammes », d’Alexandre Gady, professeur d’histoire de l’art moderne, Sorbonne-Université, étude issue de la revue mensuelle « L’Estampille/L’Objet d’art », n° 560, octobre 2019, 96 pages, éditions Faton.
|





