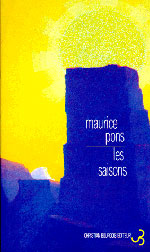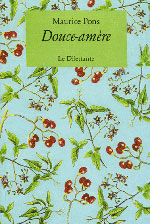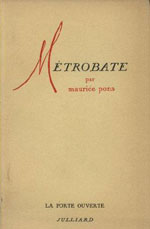|
|

Maurice
Pons
Parlez-nous de ce lieu qu’est le Moulin d’Andé.
Le Moulin d’Andé est maintenant homologué comme Centre de Rencontres Culturelles par le Ministère de la Culture.
Au départ, c’était une petite association d’amis pour venir travailler à la campagne, tranquillement entre nous.
Et pour moi c’était une bénédiction, parce que je vivais à Paris où je n’arrivais pas à écrire.
J’ai découvert le Moulin d’Andé à la faveur d’un concert inaugural et médiéval, dans l’île secrète du moulin qui est un site classé. Suzanne Lipinska m’a parlé de son projet de faire de son moulin un lieu d’animation, d’accueil pour des peintres, des écrivains, des cinéastes, des artistes. C’est ce dont je rêvais depuis presque toujours. Mon idée à vingt ans était de vivre dans une belle maison à la campagne et d’écrire des livres. A vingt ans, on est à la fois téméraire, utopique, et courageux. Je me suis accroché à cette idée : je vais devenir un écrivain.
J’avais en tête un gros livre que j’avais envie d’écrire, qui m’a pris un an et demi. Quand il a été fini, édité, publié et bien accueilli je me suis dit que j’allais en faire un autre et encore un autre… et de livre en livre, de traductions en scénarios, je suis resté là, tout en participant à la vie du Moulin et au développement de l’Association.
Un lieu est nécessaire pour écrire ?
C’est essentiel ! Plusieurs fois, j’ai essayé de prendre un peu de distance, de m’installer ailleurs, mais pour écrire je revenais toujours au Moulin et tous mes livres, je les ai écrits ici.
Les lieux dans vos textes sont aussi importants. La recherche, la quête d’un lieu…
Ou l’invention totale d’un lieu ! Par exemple dans Rosa, la fameuse Principauté Wasquelham, non seulement j’ai inventé le nom, en contractant des noms flamands mais j’ai inventé la
Principauté que je situe entre le Palatinat, le Luxembourg et l’Alsace. Comme je suis né et que j’ai passé les premières années de ma vie à Strasbourg, j’avais des souvenirs quelque peu alsaciens, qui font que les Strasbourgeois reconnaissent des lieux. C’est très important de situer une action, surtout quand il s’agit d’évènements totalement imaginaires, qui font semblant d’être véridiques et historiques. Il faut que ce soit très précis. Il suffit d’emprunter un palais dans une ville, un fleuve dans une autre, un jardin public ailleurs, mélanger tout ça en donnant des noms bizarres, on a l’impression qu’on a inventé un pays.
A chaque fois vous recréez un univers. Comme dans Les Saisons… Ou dans Mademoiselle B qui ressemble un peu d’Andé…
Oui, le village de Jouff où vit Mademoiselle B, peut faire penser au village où j’habite ou à n’importe quel petit village de France. Dans Les saisons, par contre, le pays est inhabitable et ne peut pas exister. Les êtres humains qui vivent dans cette espèce de désert glacé, pluvieux et pourri, sont à peine des hommes. Là, j’ai pu concentrer tout ce que je déteste dans l’univers que nous habitons : le froid, la pluie, les maladies, les infirmités… Et curieusement, ce livre qui devrait faire horreur à tout le monde a, je ne sais pas pourquoi, un pouvoir de séduction assez étonnant. Ce sont les lecteurs qui décicent. Parce que ça fait maintenant quarante ans que ce livre est sans cesse réédité. Pas à cent mille exemplaires, mais mon éditeur, Christian Bourgois, m’a dit : « Ne t’en fais pas, il y en a toujours quelques centaines qui circulent ». Et ce sont les lecteurs qui se le racontent les uns aux autres, qui se le prêtent, qui se le donnent à lire. Moi, je n’y suis plus pour grand chose.
C’est un livre extrêmement dérangeant, très dur mais très humain.
Je dis toujours que c’est un livre très dur mais la seule façon de s’accrocher c’est de prendre l’horreur avec des éclats de rire. Plus c’est horrible, plus il faut rigoler ! Quand « le chirurgien » qui est plutôt chaudronnier soigne le pied de son pauvre patient en le faisant lécher par un âne, c’est épouvantable comme situation. Ce doigt de pied pas plus gros qu’un radis devient une aubergine ! qu’il fait brouter par son âne. C’est fou ! C’est une façon pour moi de dénoncer la torture et la souffrance physique, de me libérer de souvenirs douloureux.
La guerre est souvent présente.
Il m’est difficile d’en parler parce que bien sûr, je n’ai pas fait la guerre, je l’ai seulement subie. Mais, j’ai été bouleversé par des images de la guerre. Une date importante de ma vie, c’est la première fois que j’ai vu le film d’Alain Resnais, Nuit et brouillard. J’étais avec une amie juive, de famille juive, et c’était une épreuve terrible.
Les camps sont aussi évoqués. Ce sont de grandes souffrances.
Oui. Elles apparaissent en contrepoint. Dans Les saisons, le pauvre Siméon a vu le cadavre de sa sœur Enina, morte de sécheresse dans un camp traîné par les pieds dans le sable blanc d’un désert. Ce sont mes images personnelles de la guerre.
La guerre d’Algérie apparaît en filigrane ? Pensez-vous que la littérature a un rôle à jouer ?
Je ne pense pas au rôle que pourraient jouer mes livres une fois qu’ils sont écrits. Je ne me suis jamais engagé dans la vie politique mais j’ai manifesté contre l’affreuse « guerre d’Algérie » et j’ai signé l’appel des 121.
On retrouve plusieurs fois dans vos livres des écrivains ou des personnes qui veulent devenir écrivains. C’est une obsession que vous avez toujours eue…
J’ai toujours eu à la fois le désir profond d’écrire et une très grande difficulté à écrire. Dans Les saisons, c’est le summum, parce que le personnage passe son temps à écrire et à la fin de son œuvre déchire tout ! Il lui reste une seule ligne, et encore, en latin.
Et il perd des feuilles… Il y a un lien au papier très particulier…
J’ai une admiration folle pour le papier, c’est une matière superbe ! Blanche, belle… Il y a des feuilles qui font un bruit magnifique. Je l’appelle « le papier drelin » parce qu’il résonne comme les cloches des moutons. Les moutons aussi jouent un grand rôle dans Les saisons. Ça commence par cet obus qu’on lui lance dessus par une fenêtre et qui est en fait un crâne de mouton. C’est dur un crâne de mouton ! J’en sais quelque chose !
Les animaux jouent un grand rôle…
C’est le seul moyen de chauffage ! C’est un souvenir de mon enfance, dans les Hautes Alpes. J’ai été frappé de voir l’hiver, dans ce pays inhabitable. Maintenant, c’est civilisé, mais à l’époque les gens dormaient à l’écurie parce que c’était le seul moyen de chauffage. Il n’y avait pas le chauffage central ! C’étaient les vaches qui chauffaient la maison. Dès qu’il faisait froid, on allait dormir à l’écurie.
Le froid est un personnage de votre livre !
Je pense bien. Il dure quarante mois ininterrompus, suivis, je crois de dix-huit mois de pluie ! C’est vraiment inhabitable ! Et c’est drôle parce que la vallée de Névache est une des plus belles vallées des Alpes françaises et même d’Europe ! C’est un pays magnifique, aux mois de mai-juin, c’est le paradis. Et j’ai le mauvais goût d’en faire un enfer !
On trouve aussi dans une nouvelle de votre dernier recueil, Délicieuses frayeurs, des personnages qui cherchent un autre lieu en espérant trouver mieux ailleurs. On est encore dans la quête, d’un changement de lieu, d’un espoir…
Il y a une phrase qu’on doit retrouver dans plusieurs de mes livres : « Quand un monde est inhabitable on le change ou on en change ! ». Mais pour aller où ? C’est difficile…Dans Rosa, les hommes ont cherché une formule qui ne leur a pas beaucoup réussi… Mais maintenant que je suis là, moi, dans ce vieux et cher Moulin, je ne cherche plus à aller ailleurs ! J’ai arrêté ma quête d’un monde impossible.
C’était votre quête ?
Oui, tout le temps, depuis la guerre… Comme vous le disiez au début, trouver un lieu, un endroit pour vivre et écrire sans bouger, sans se déplacer. Maintenant, je pense que je l’ai trouvé.
Vivre ici, dans un lieu de rencontres, c’est important pour vous ?
Oui, mais c’est à l’intérieur de soi qu’on trouve les thèmes. On utilise quelques figures mais c’est le mélange de tout ça qui doit être inscrit dans le disque dur qu’on a dans la tête et qui tout à coup se met en route. Ce n’est jamais systématique.
Il faut créer son propre univers. Dans beaucoup de vos écrits, il y a un lien au fantastique. Comment vous alliez le fantastique et la réalité ?
Je trouve que souvent la réalité n’est pas très intéressante. Elle est trop réelle, quoi ! Le métier de journaliste consiste à rendre intéressantes des choses qui ne le sont pas forcément comme un accident de voiture ou un conseil des ministres. En tant que romancier je ne suis pas tenu de dire la vérité de quoi que ce soit, donc je peux en rajouter. Je peux mélanger des choses qui sont inconciliables. Il a une petite chanson que j’aime bien : « Un oranger sous un ciel irlandais on ne le verra jamais ». Pourquoi pas ? un oranger au pôle Nord si ça m’amuse. Par écrit, avec un petit stylo et un papier blanc. Un journaliste ne peut pas dire : « Je suis allé au pôle Nord, j’ai vu trois orangers. » On ne le croirait pas !
Pour vous le plaisir de l’écriture, c’est pouvoir rêver la vie.
Quand le rêve n’est pas un cauchemar !
Dans Mademoiselle B, sa naissance est un peu surprenante !
Un peu effrayante aussi puisqu’elle est née sans père ni mère… J’avais peur quand j’écrivais Mademoiselle B. Je l’écrivais ici, sur ce banc où vous êtes assise. Parce que quand je travaille, je me mets de l’autre côté de la table, avec les rideaux fermés et une toute petite lampe. J’écris le matin, très tôt. Et souvent, j’avais peur, de ce qui allait m’arriver, de ce qui allait lui arriver, à elle...
Vous créez souvent des univers inquiétants.
Dans une des nouvelles de Délicieuses Frayeurs, il y a cette main coupée qui arrive de Hollande dans une ambulance, quand il ouvre la boîte, moi, j’ai peur. Je le savais pourtant, ce qui était dans la boîte, mais quand j’écris, celui qui parle ne le sait pas. Tout à coup, l’horreur de trouver cette main ! La main de sa femme qui est pianiste ! A la fois, ça ne tient pas debout et la difficulté c’est de mettre debout des choses qui ne peuvent pas tenir debout. Et c’est pour ça que dans Mademoiselle B je me mets en scène sous mon nom, je décris des scènes très réelles de moi et de ma vie. Il y a beaucoup de mensonges aussi, mais c’est pour leur donner l’apparence de la réalité, de la vérité. Si tout était imaginaire, personne ne croirait rien. Je voudrais que des choses impensables deviennent presque naturelles. Une dent c’est un organe très ordinaire dans la bouche, le poussin qui sort de l’œuf et qui devient une poule, c’est merveilleux, c’est naturel, mais quand on parle d’une poule avec des dents, ça devient extraordinaire. Je n’ai jamais vu de poule avec des dents, mais j’ai envie d’en inventer une dans une histoire.
Dans Délicieuses frayeurs, il y a des histoires extraordinaires mais il y en a des plus réalistes comme celle du champagne ou celle de la fenêtre même si on reste dans le rêve.
Oui, on est à la fois dans le rêve et dans le réel. C’est la force des mots. Le narrateur, Frantz décrit tellement bien ce qu’il ne voit pas, que ça devient réel, une réalité qu’il partage avec toute la chambrée. Avec les mots, on peut tout faire, on peut créer de l’or, il suffit de tracer un o et un r.
Vos images littéraires sont très visuelles, très picturales. Comment se construit ce lien entre les mots et les images ?
Les rideaux fermés, à cinq heures du matin, se forcer à faire travailler ce je ne sais quoi, ce petit robot qu’on appelle le cerveau… J’ai beaucoup d’images en tête. Et je garde des boîtes entières de petites images que je découpe partout, dans les journaux, les magazines, les livres même… Un jour, certains petits personnages découpés apparaîtront peut-être dans mes pages…
Et après, vous vous laissez guider ?
Quand je commence un livre, je sais à peu près où je vais, mais en route il y a beaucoup de surgeons qui se développent.
On retrouve souvent la nuit, le ciel…
J’aurais aimé faire de vraies études d’astronomie mais j’aurais triché aussi, j’aurais rajouté des galaxies, j’en aurais inventé une qui ne ressemble pas du tout aux autres, qui mangerait la nôtre…
On est toujours dans l’inquiétant.
Oui, mais écrire ce n’est pas jouer avec des soldats de plomb, c’est jouer avec des images, des souvenirs autrement terrifiants. Les trous noirs dans l’univers, c’est fascinant ! Mais il faudrait être un génie pour savoir les décrire ou les imaginer vraiment.
Il faudrait que vous rencontriez un scientifique qui vous donnerait des éléments et vous feriez, vous, votre travail de romancier.
Il « aurait fallu », parce que maintenant c’est un peu trop tard, je le crains !…
Quand vous commencez un texte, vous savez si ce sera une nouvelle ou un roman ?
Maintenant, je me « re-raconte » mes histoires. Par exemple, récemment, j’ai trouvé une autre fin pour Rosa qui aurait été très bien, très étonnante, plus encore que celle que j’ai trouvée à l’époque ! On ne peut pas réécrire un livre mais il m’arrive de me dire que j’aurais pu le finir autrement.
C’est très oulipien.
L’Oulipo, oui, ces merveilleux jongleurs qui jonglent avec les mots et les lettres. C’est fabuleux, ils inventent un langage… J’étais très ami de Georges Perec, qui a vécu plusieurs années avec nous au Moulin. Mais plus que ses œuvres oulipiennes, j’aime ses livres plus personnels comme Un homme qui dort, W, Le souvenir d’enfance ou La Poche Parmentier.
Vous mettez plusieurs années à réfléchir à un livre avant de l’écrire ?
Oui, je le laisse naître d’abord, mûrir, s’épanouir peut-être… ou alors se dessécher et disparaître !
Vous vous êtes toujours donné du temps pour écrire.
Je suis sidéré quand je vois des écrivains écrire des livres de cinq ou six cents pages dans l’année, et l’un après l’autre…
Beaucoup de gens disent « Maurice Pons est un écrivain très rare, il n’a écrit qu’une dizaine de livres en quarante ans » mais moi je trouve que c’est déjà fantastique.
J’ai écrit trois recueils de nouvelles, mais par exemple dans Douce amère il y a onze nouvelles, j’aurais peut-être pu en faire onze romans. Ce serait moins bien. Elles sont serrées, denses, il n’y a pas un mot de trop, c’est de l’orfèvrerie, comme me le disait mon éditeur.
L’écriture d’une nouvelle est différente de celle du roman ?
Oui, le roman, ça coule. Dans Douce amère, l’histoire de la petite Chinoise, je la trouve terrible et belle. J’aurais pu effectivement en faire un petit livre de cent cinquante pages, en continuant parce que j’avais toute la matière. Mais j’ai déjà bien pleuré en écrivant les vingt pages. C’était terrible pour moi. C’est cela la rançon et le salaire de l’écrivain…
C’est ce qui fait la force de vos livres. L’émotion innerve vos écrits.
Il y a des échos d’un livre à l’autre, des prolongements…
Ça m’amuse de me raconter ce que j’aurais pu écrire de différent de ce qui est écrit, partir dans une autre direction.
Revoir avec un autre angle. Plusieurs fois, vos personnages sont des écrivains ou des peintres.
Dans La maison des brasseurs surtout qui est un voyage imaginaire, à travers les toiles irréelles d’un grand peintre flamand qui n’existe pas !
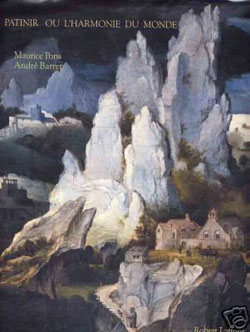 Je voyais justement dans Le Monde un grand article sur Patinir, le peintre flamand du XVIe siècle et il se trouve que j’ai participé à un magnifique livre sur Patinir, un très bel album qui est passé complètement inaperçu. Patinir était quasiment un inconnu et je vois qu’il y a maintenant une grande exposition à Madrid sur toute son œuvre qui a été rassemblée. J’avais fait connaissance avec Patinir grâce à un éditeur. J’avais toutes les reproductions étalées sur ce bureau et j’ai écrit un texte en me nourrissant de ses toiles. Je suis entré dans sa peinture avec beaucoup d’admiration et de fascination. Je pense qu’il a inventé la couleur bleue, il n’y a que lui qui fasse des bleus comme ça. Et ce que je trouve le plus beau, derrière les sujets religieux, ce sont les paysages fabuleux, tout petits, en arrière plan de la toile. On voit des arbres, des oiseaux qu’on ne connaît pas, on voit la mer et le ciel qui se fondent dans la mer. Je voyais justement dans Le Monde un grand article sur Patinir, le peintre flamand du XVIe siècle et il se trouve que j’ai participé à un magnifique livre sur Patinir, un très bel album qui est passé complètement inaperçu. Patinir était quasiment un inconnu et je vois qu’il y a maintenant une grande exposition à Madrid sur toute son œuvre qui a été rassemblée. J’avais fait connaissance avec Patinir grâce à un éditeur. J’avais toutes les reproductions étalées sur ce bureau et j’ai écrit un texte en me nourrissant de ses toiles. Je suis entré dans sa peinture avec beaucoup d’admiration et de fascination. Je pense qu’il a inventé la couleur bleue, il n’y a que lui qui fasse des bleus comme ça. Et ce que je trouve le plus beau, derrière les sujets religieux, ce sont les paysages fabuleux, tout petits, en arrière plan de la toile. On voit des arbres, des oiseaux qu’on ne connaît pas, on voit la mer et le ciel qui se fondent dans la mer.
Certaines de vos œuvres ont été adaptées au cinéma…
Oui, au cinéma, au théâtre, à la télévision, j’ai un peu touché à tout, pas toujours avec d’immenses satisfactions mais c’est intéressant quand même, ça fait partie de l’expérience d’un écrivain. Mais à tout cela, je préfère toujours l’écriture… le papier à la pellicule…
Le cinéma vous a donné un autre regard sur ce que vous avez écrit ?
Oui, c’est tout à fait autre chose. Ma première rencontre avec le cinéma, c’est à François Truffaut que je la dois. Truffaut, je ne le connaissais pas beaucoup mais il avait envie de tourner un film avec Les mistons, une des nouvelles de mon premier livre Virginales qu’il avait lue et qui l’intéressait. Je ne pensais pas que le jeune Truffaut avec lequel je travaillais allait devenir François Truffaut !!! Le film qu’il a fait est « son » film. Il avait toujours peur, « tu vas te sentir trahi » disait-il. Mais il n’y a pas de trahison, j’ai ma vision des choses et lui il a la sienne ; moi je trace avec mes images mentales des mots et des phrases, lui organise avec mes mots et mes phrases ses propres images, et voilà… Il avait peur de me décevoir alors que ce n’est pas pour moi qu’il faisait le film. Je n’avais aucune raison d’être déçu, il ne me devait rien. C’était une expérience intéressante dont j’ai été très heureux et dont je suis toujours très fier.
Vous n’êtes pas intervenu dans son travail ?
Non, il n’y tenait pas du tout, sauf par moments, quand il faisait le montage du texte. Il m’écrivait pour me demander des phrases. Il écrivait beaucoup et il disait : est-ce que vous pouvez me faire une phrase avec le mot « palissade », avec le mot « jupon »… Et il montait tout ça… C’était amusant…
Après ça, j’ai travaillé dans le cinéma avec d’autres amis, comme Robert Enrico, pour La belle vie, comme Bernard Queysanne… le cinéma c’est toujours fascinant… on m’a même proposé de faire moi-même un film. Que j’ai fait. Un petit film de vingt minutes, un court métrage qui s’appelle La dormeuse. C’était simplement la folle idée de filmer une jolie jeune personne qui dort, mais avec une machinerie très compliquée parce que je voulais que la caméra soit au-dessus d’elle et puisse tourner sur elle-même. On a tourné ici au Moulin, on avait bricolé un espèce de studio avec un treuil et une poulie. La pauvre Elisabeth, il fallait qu’elle dorme au milieu de dix personnes, avec le treuil qui montait et qui descendait au-dessus de sa tête et les projecteurs dans les yeux. Finalement, le film a été plutôt réussi mais j’ai vite senti que ce n’était pas mon truc, le cinéma ! Il faut beaucoup plus d’autorité et de volonté, il faut prendre des décisions à chaque instant, ce que je déteste, il faut commander, ce que je n’aime pas du tout… (quoique tout récemment, je vous dis cela à voix basse !… j’ai été promu "Commandeur" des Arts et Lettres !!!)
Dans votre parcours d’écriture, vous avez eu l’impression d’avoir plusieurs périodes ?
Oui, mais je verrai après. Si je relis une fois tous les livres que j’ai écrits, je tirerai peut-être des conclusions, mais ce sera trop tard et à quoi bon ?
Et en ce moment, vous avez un projet ?
Je relis beaucoup, des livres que j’ai lus il y a longtemps. Par exemple, Lawrence Durrel. Le quatuor, Montolive, c’est magnifique. C’est étrange la mémoire, il y a des pages qu’on retient quarante ou cinquante ans et que l’on retrouve. D’autres qu’on découvre soudain. J’ai relu aussi Kundera. L’insoutenable légèreté de l’être, c’est éblouissant.
Propos recueillis par Brigitte Aubonnet
Mise en ligne : Novembre 2007
|
|
|

(Cliquer sur la couverture
pour lire sur ce site
un article concernant
Délicieuses frayeurs)

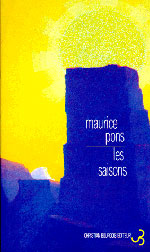



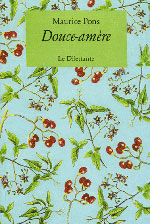


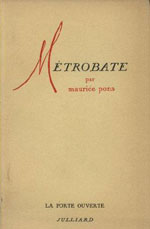

|
|