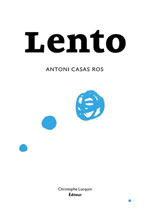Christine Bini : Vous publiez en ce mois de septembre 2014, chez l’éditeur Christophe Lucquin, un roman intitulé Lento. Lento est à la fois un adjectif et le prénom de votre personnage. Sur une photo que vous avez postée sur un réseau social où vous êtes très actif, on voit une coccinelle sur le capot de votre ordinateur. Vous mettez en commentaire de la photo : « Tout a commencé comme ça ». Par-delà le clin d’œil à Céline, est-il vrai, donc, que l’histoire de Lento vous a été inspirée par l’observation d’un insecte ?
Antoni Casas Ros : La coccinelle était un clin d’œil à mon éditeur. Je lui avais fait lire le texte par amitié, pour mieux se connaître et surtout parce que j’avais beaucoup aimé Polleri, Bellatín et d’autres qu’il avait publiés. Il m’a proposé de l’éditer et comme je réfléchissais à cette probabilité, la coccinelle s’est posée sur mon ordinateur mais le plus drôle c’est que chez lui, à Paris, une autre coccinelle s’est posée sur sa fenêtre. Simple et net ! Lento est plus un conte qu’un roman et il m’a été inspiré par un enfant trisomique qui dansait nu sur la plage de Barcelone. J’étais fasciné. Je voulais entrer dans son monde, lui parler mais lorsque je suis revenu sur la plage après avoir nagé, il avait disparu, alors j’ai imaginé sa vie.
C.B. : Lento est le cinquième ouvrage que vous publiez, après les romans Le Théorème d’Almodovar, Enigma et Chroniques de la dernière révolution, et le recueil de nouvelles Mort au romantisme. Y a-t-il un point commun entre ces publications ? Pensez-vous que vous tracez un sillon particulier, que vous travaillez un motif récurrent ?
A.C.R. : J’ai un côté adolescent, je voudrais encore changer le monde. Un côté radical aussi. Faire la révolution est une idée assez romantique et réversible dans le sens où les révolutions ne tiennent pas longtemps l’idéal révolutionnaire. Le titre de mes nouvelles, Mort au romantisme était un message à moi-même : arrête et creuse ! Mon sillon, c’est une sorte de spéléologie sensorielle et émotionnelle, descendre au cœur de la sensibilité, explorer, faire sauter les limites sur tous les plans. Lento était un personnage idéal pour ça et puis j’ai toujours senti l’hypersensibilité et l’intelligence des autistes avec lesquels je communique assez facilement. Ils m’attirent. J’en suis un. Je ne communique pas avec des mots mais simplement avec une présence qui n’établit pas de distinction, de hiérarchie. Ils vivent une harmonie très fragile qui est tellement aiguë qu’elle provoque de la souffrance et nous ne les comprenons pas, nous les reléguons, nous voulons pas savoir comment ils voient notre chaos, nous ne voulons pas apprendre. La ligne de démarcation est à la fois fragile et arbitraire.
C.B. : Votre personnage, Lento, pose sur le monde un regard à la fois détaché et profond. Il a une compréhension autre des objets et des personnes, et parvient à aiguiser ses sens jusqu’à l’exacerbation. Quelle est la part personnelle de l’auteur dans ce personnage ?
A.C.R. : L’ascèse de Lento est mon ascèse, c’est une sorte d’enquête très rationnelle et permanente dont le sujet pourrait être: « Où notre corps s’arrête-t-il ? ». Et quand on commence à se poser ce genre de question les surprises affluent et c’est peut-être une clé pour comprendre les autistes. Leur corps ne s’arrête nulle part, les sensations et les émotions sont donc trop puissantes, le système implose. Si les choses commencent de cette manière dans l’enfance, on arrive vite au trop plein. En ayant la chance de suivre la route inverse, après avoir cru au mensonge, on peut faire couler cette perception sur un fond plus stable et le dissoudre peu à peu. Je sors de la dichotomie matérialiste/mystique. Quand je lis Hafiz ou Rumi, je sens bien qu’ils parlent de cet autre corps illimité.
C.B. : Sur la quatrième de couverture de Lento, on peut lire que le personnage évolue dans une société malade. De quelle maladie vous semble-t-elle souffrir, en premier lieu ?
A.C.R. : Une inversion du réel qui se traduit par un culte de cette inversion. Dans l’enfance j’avais cette sensation extrêmement puissante que les êtres et la société qu’ils forment sont des illusions, que les rapports humains sont fondés sur cette illusion que les conflits sont fondés sur cette illusion. J’ai lu beaucoup et très tôt, j’ai écouté beaucoup de musique et cet univers là me semblait absolument réel. Je m’y baignais et chaque fois qu’on me demandait d’être dans la réalité je ressentais cette confusion majeure qui engendre toutes les idées perverses, comme l’ordre et la sécurité. Ce sont des idées qui ne fermentent plus. Le Chaos en revanche m’attirait comme le noyau en fusion de ce que j’appelais la réalité et j’y suis toujours. Certains appellent cela de la naïveté ! S’ils savaient !
C.B. : Les rapports de Lento avec sa mère sont tendres, sans heurt. De la même façon, les personnages féminins du roman, infirmière, thérapeute, amante, sont toujours des alliés. Pensez-vous, comme Romain Gary et quelques autres, que le monde sera sauvé s’il accepte de mettre en avant le féminin ?
A.C.R. : Le féminin pour moi, ce n’est pas seulement les femmes mais c’est la partie la plus féconde de l’homme, et plonger dans la sensation et dans l’émotion nous la fait découvrir. Le monde masculin est très conceptuel, contrôlé, apeuré. Il est sans innocence en quelque sorte. Mes personnages sont des androgynes qui se rapprochent du féminin par tous les moyens, y compris la sexualité, la bisexualité, l’homosexualité pour découvrir justement cette richesse émotionnelle, cette intelligence du fruit.
J’ai eu la chance de rencontrer beaucoup de femmes, et d’apprendre beaucoup à travers elles. Lorsqu’elles trouvent leur territoire de liberté, rien ne les arrête. Elles sont vraiment capables de tout quitter pour découvrir une nouvelle jungle où s’ébattre. J’y vais avec elles ! Elles ont déjà sauvé le monde mais les fanatiques de tous bords tentent de le leur reprendre.
C.B. : Vous citez André Hardellet dans votre texte, avec un extrait de Lourdes, lentes… et Michaux en exergue du roman. Vous sentez-vous à l’aise dans la littérature française ? On connaît votre admiration pour Mario Bellatín, Rodrigo Fresán et la littérature hispanophone en général…
A.C.R. : Ma culture française s’était un peu arrêtée à mes années d’étudiant, J’avais fait quelques incursions mais j’étais très attaché à la folie, à la liberté, à l’exploration de la littérature hispanophone. Depuis que je suis publié, je me suis remis à lire des français, j’ai fait de belles rencontres et de belles découvertes, des écrivains comme Sébastien Doubinsky qui échappent totalement à ce que je vais dire. J’aime les écrivains qui galopent dans les steppes ! Mais il y a chez nous un fond assez timoré, un réalisme qui appartient encore au 19ème et surtout le fantôme du style qui nous paralyse tragiquement. Ce fantôme me fait penser aux peintres pompiers. C’est parfait mais tellement ennuyeux. Bien écrit ! Je suis pour la sauvagerie de l’écriture, pour l’exploration. Le plus curieux c’est que nous prenons Flaubert comme référence alors qu’il était complètement fou et que son style est un hymne constant au Chaos et à la sauvagerie. C’est là toute sa beauté comme celle de Delacroix. Je crois aussi que l’ennui vient de la stabilité politique. Dans tout le monde hispanophone, ce n’est qu’une succession de révolutions, de dictatures terribles, de libérations, de retours au chaos et cela ne peut qu’engendrer une littérature aventureuse. Nous en sommes à compter les républiques : la troisième, la quatrième, la cinquième. On vit dans un palais de glaces qu’on appelle démocratie et on s’endort en la chantant et en célébrant ses vertus. C’est ce qui m’a fait imaginer une ultime révolution dans Chroniques de la dernière révolution, pour que l’espace devienne vraiment créatif.
C.B. : Quelle serait la question à laquelle vous ne pourriez pas répondre ? À part celle sur votre véritable identité, bien sûr…
A.C.R. : Est-ce que je serai encore vivant demain matin, capable de descendre au fond du cratère ? Et puis ma véritable identité, c’est un jeu d’adolescent auquel je prends beaucoup de plaisir. C’est basé sur un diamant de José Saramago : « Ce qui est important, ce n’est pas qui je suis mais ce que je suis » et ça je ne le sais pas, je découvre en écrivant. Qui je suis, c’est toujours un masque, une fiction, un réalisme tragique, un défilé de mode auquel je ne tiens pas à participer.
Entretien réalisé par mail le 4 août 2014
Christine Bini
(18/09/14)
Lire d'autres articles de Christine Bini sur http://christinebini.blogspot.fr/