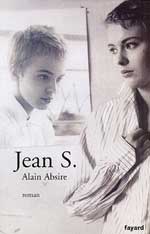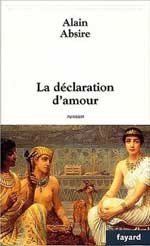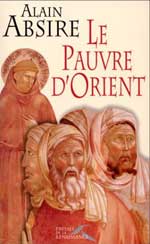|
|
 Alain
Alain
ABSIRE
"D'un livre à l'autre, j'expérimente toutes sortes d'écritures et de constructions nouvelles."
Vous venez de publier un roman sur Francis Bacon, Deux personnages sur un lit avec témoins. Quelle a été l’origine de ce texte ?
C’est la rétrospective Francis Bacon au Centre Georges Pompidou à Paris, de juin à octobre 1996. Quel saisissement ! J’avais déjà vu des toiles de Bacon, en particulier à Londres et au Musée d’Art Moderne à New York, mais je n’avais jamais été confronté à une telle concentration d’œuvres majeures. Je dirai que cette peinture sans merci m’a sauté à la gorge. Ces chairs en lambeaux, ces nerfs comme détressés… c’est l’équarrissage de notre nature humaine. Ce pourrait être simplement un massacre, mais c’est surtout la mise à nu de nos peurs et de nos douleurs existentielles les plus enfouies. C’est violent (à la limite de l’insupportable parfois !) mais jamais désespéré : si l’homme parvient à porter un tel regard sur lui-même c’est qu’il a une longueur d’avance sur sa propre condition. C’est une question de lucidité. Après avoir vu cette rétrospective, je suis resté sous le choc pendant une semaine. À croire qu’un événement énorme m’était arrivé dessus, de plein fouet. La seule comparaison qui me vient à l’esprit, c’est lorsque que j’ai eu mon accident de voiture en 1985, quand j’ai vécu des jours et des jours avec le bruit et l’odeur de ce heurt qui aurait pu être mortel incrusté en moi.
Comment avez-vous construit ce livre ?
Sans préméditation, même si j’y ai pensé pendant des années avant d’écrire un mot. Je n’avais que deux certitudes : je voulais raconter un amour cannibale, et cette dévoration des êtres passait forcément par un dialogue entre Bacon (Frankie dans le livre) et son amant et modèle George Dyer (Tony). Tout devait se jouer entre ces deux personnages-là, que je plaçais sur un lit, devant ces témoins que sont les visiteurs dans les expositions de peinture et les musées du monde entier… Ensuite je voulais écrire un vrai roman. Comme le faisait Bacon avec sa peinture, j’ai donc trituré la vérité. Pour le reste, en particulier l’enchaînement inhabituel de ces différentes formes de dialogue que j’utilise, je m’en suis remis au hasard, et j’ai regardé ce que ça donnait. Encore un trait commun avec mon personnage central qui ne savait jamais à l’avance ce qui allait surgir de ces toiles.
Quel lien pouvez-vous établir avec votre roman Lazare ou le Grand sommeil ou avec votre autre roman Lapidation ?
La filiation est directe. Lazare ou le Grand Sommeil est celui de mes livres que je préfère. Il m’habite encore vingt ans après sa parution, et je ne peux rencontrer de lecteurs sans qu’au moins l’un d’entre eux vienne m’en parler. Là aussi, à travers le ressuscité de l’Évangile qui porte les stigmates de la mort sur lui, et qui ne peut ni les effacer, ni mourir, il y a ce dépérissement des chairs et cette torture de l’esprit qui refuse la lumière. Pour Lapidation, où il y a beaucoup de corps suppliciés, et qui est une sorte de "thriller religieux", je me suis rendu compte, en écrivant mes Deux personnages… que cela avait été une répétition générale, une sorte de dernière mise en jambes, avant de sauter le pas pour de bon.
Quel rôle joue le corps, sa transformation, sa déchéance ou sa décomposition dans vos écrits ?
L’intégrité et la dignité du corps sont si précieuses ! Hélas, même si nous le commandons, c’est pourtant notre corps qui finit par avoir le dernier mot. Il faut le nourrir, le ménager pendant des dizaines d’années, le tutoyer, le soigner, parfois le contraindre et le rudoyer, sinon il n’en fait qu’à sa tête. J’entends souvent des gens dire qu’ils ne sont pas sympathiques avec leur corps, moi je dirai, à l’inverse, que notre corps a une forte propension à devenir notre pire ennemi. Il ne faut jamais relâcher ni sa laisse ni son collier, sinon il part en vrille. Puisque c’est son corps que l’individu mortel donne à voir de lui-même, Bacon, qui est un maître créateur, fait ce qu’il veut des corps dans son œuvre. Sous son impulsion, ils cessent d’être un paravent entre le paraître et l’être. En toute modestie, je m’efforce de suivre ses pas.
Dans Jean S., vous parlez aussi des périodes où Jean Seberg était très mal dans sa peau. Pourquoi avez-vous écrit sur ce personnage mythique ?
Il fallait voir comment, vers la fin de sa vie, cette femme, qui était la beauté même, réduisait son corps en une enveloppe quasiment monstrueuse ! C’était incroyable : elle était énorme, sans formes, presque sans visage. Et puis, quand je la revoyais trois mois plus tard, elle était redevenue la lumineuse Patricia de À bout de souffle. Non contente de fusiller sa santé, je crois que, par ces yo-yo fréquents entre laideur et beauté, elle s’autopunissait, sans répit. Sur Jean S., j’ajouterai que peu de temps avant sa mort, au printemps 1979, alors que je venais de publier mon premier roman : L’homme disparu, elle m’a demandé qui dirait un jour la vérité sur sa souffrance. Assez imprudemment, je me suis porté candidat, et elle m’a dit oui, qu’elle comptait sur moi… J’ai tourné autour pendant 25 ans, avant de me décider à tenir ma promesse. Je me suis efforcé d’être le plus vrai possible, mais j’ai mis aussi de moi-même dans mon livre, forcément.
Plusieurs de vos romans évoquent la culpabilité. Pourquoi ce thème récurrent ?
Ce qui est terrible, c’est de ne plus pouvoir rien changer dans ses actes passés. Frankie se sent coupable de la mort de Tony, comme Jean S. se reproche la mort de Mina sa fille. Il n’y a ni pardon, ni rémission possible. On cherche à se racheter comme on peut, tout en sachant que c’est impossible. Bacon a peint Dyer jusqu’à la fin de sa vie. C’est au centre de mon roman : Tony revient hanter Frankie, même si tout cela ne se passe que dans la tête du survivant.
La religion est aussi très présente dans vos livres. Quelle rôle joue-t-elle pour vous et comment l’avez-vous abordée dans votre parcours littéraire ?
J’ai été élevé dans la plus pure tradition catholique. À part la Bible, il y avait peu de livres chez moi quand j’étais enfant. C’est pratiquement là-dedans que j’ai appris à lire. Mon lien avec la religion est donc d’abord culturel. Pour le reste… Il y a, pour moi comme pour Lazare, toute cette lumière refusée, dès que la foi est perdue. J’y reviens régulièrement. Mais Deux personnages sur un lit… n’est pas un livre sur la foi, même pas de manière déguisée, pas plus que Jean S.. Tout au plus, je dirai que c’est un livre autour de l’homme sans Dieu.
Plusieurs de vos personnages sont des exclus ou se situent en marge. Est-ce un projet qui vous tient à cœur ?
Jeune, je me sentais exclu, en effet. C’est une sensation qui m’a quittée vers mes trente ans. Mais je garde en mémoire cette peur de la marge qui ne sera jamais comblée.
Vous devez publier un livre sur les Sans-Papiers. Comment s’est élaboré ce projet ?
C’est un roman dont le projet est né le jour où un millier de sans-papiers a envahi le siège de La Société des Gens de Lettres dont j’étais alors le président. Là, j’ai été confronté à la vraie marginalité, et j’ai été touché, même si, parfois, cela ne va pas sans une certaine manipulation. Nous parlions de culpabilité tout à l’heure… On traite mal ces gens, sans discernement. Alors que, de par son passé colonial, une société comme la nôtre a un devoir de générosité. Nos voisins européens, qui ont régularisé, l’ont mieux compris que nous. Mais il y a toujours, en France, cette peur de l’étranger. Malien, ou plombier polonais… à croire qu’ils vont nous manger notre pain, nous prendre nos métiers, voler nos femmes ou violer nos enfants. Il serait temps de s’apercevoir que, même si cela nous dérange, notre société est la plus multiraciale d’Europe. Ah, ces couleurs de l’équipe de France de foot ! Regardez : nous sommes les seuls à aligner tant de couleurs de peau différentes face à l’hymne national. Est-ce que cela nous empêche de gagner ?
Comment vous situez-vous par rapport à l’engagement en tant qu’écrivain ?
Je n’ai pas de vérité à délivrer. Tant mieux si, en tant que romancier, je peux prendre ma part dans l’éveil des consciences, mais je ne me reconnais ni le droit ni la capacité de les diriger. Je suis moi-même devenu assez flou politiquement, je ne crois plus en la vérité d’un camp contre l’autre, même si Sarkozy représente l’essentiel de ce que je déteste. Parons à l’urgence : à la Société des Gens de Lettres, je me suis efforcé, entre autres, de renforcer l’action sociale envers les écrivains dans le besoin. Je suis peut-être idéaliste, mais je crois que l’esprit de solidarité est une attitude politique incontournable.
Vous avez écrit sur l’écrivain cubain Alejo Carpentier. Pourquoi un essai sur cet auteur ?
Il n’existait rien en français sur Alejo Carpentier qui, à mon sens, est à placer au même niveau que Borges ou Garcia-Marquez. Carpentier a éveillé en moi tant d’images ineffaçables ! Je crois que, en France, il paye son engagement aux côtés de Fidel Castro dans les années 60. Mais on oublie que, à cette époque-là la majorité des intellectuels était castriste, comme on oublie que Carpentier était chargé de l’alphabétisation de Cuba, première réussite (dans ces années lointaines) de la révolution.
Vous avez écrit plusieurs romans se situant en Italie. D’où vous vient cette passion ?
De Fellini, du bleu du ciel et des ors des églises, de Mastroianni, de Sophia Loren et de Claudia Cardinale, des péplums, d’Antonio Tabucci et de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, de la pizza à la rughetta, des spaghetti à la sardine ou à l’encre de seiche, de l’Amaretto et du vin blanc de Toscane, des chats du Colisée, des falaises de Sorrente et d’Amalfi, des arcades de Bologne, de l’hôtel Villa San’ Andrea à Taormine, du café ristretto, des engueulades entre automobilistes, du bel canto, de la villa de Tibère à Capri et du chemin ombragé qui redescend du Mont Palatin jusqu’au forum, des fanfares et de Nino Rota, des faire-part de décès collés sur les murs, des voix dans les haut-parleur des télés quand la nuit est tombée et que les fenêtres sont ouvertes, de Fra Angelico et de Botticelli, des roues des trains qui grincent, de Sergio Leone, de la commedia dell’arte, des tranches fines de San Daniele au marché du Ponte Rialto, du Campari soda à la terrasse des cafés et du parmesan à la coupe.
Quelle relation établissez-vous avec l’Histoire et le passé car vous avez aussi écrit des romans sur l’Egypte et plusieurs de vos romans se situent dans des époques passées ?
Je l’ai beaucoup fait, mais je n’ai plus très envie de me servir d’un cadre historique. Le dernier du genre : La déclaration d’amour qui se situe à l’époque d’Akhenaton, est une entourloupe autobiographique, puisque j’y raconte ma propre histoire d’amour transposée quelques millénaires en arrière. Cela dit, le passé est un territoire d’exception pour l’imaginaire.
Quel rôle jouent les voyages dans votre écriture car vous avez visité beaucoup de pays du Monde ?
J’adore parcourir le monde en effet. Paradoxalement, à part pour l’Italie qui est mon second pays et où je vais au moins deux fois par an, je me suis assez peu servi de mes voyages dans mes livres, à part dans mes nouvelles. Peut-être qu’un certain côté récupérateur de misère me gêne. Je suis ainsi incapable d’écrire sur l’Inde où je ne me lasse pourtant jamais de retourner.
La filiation qui existe entre vos livres est-elle une volonté consciente de votre part ou la réalisez-vous après coup ?
Il faut bien qu’il y ait un fil directeur entre mes vingt-cinq bouquins publiés. Je n’ai pas de plan pour construire une œuvre cohérente et, d’un livre à l’autre, j’expérimente toutes sortes d’écritures et de constructions nouvelles. En réalité, les thèmes récurrents s’imposent d’eux-mêmes, nous en avons distingué quelques-uns tout à l’heure.
Vous avez parlé d’un musicien Chet Baker, de peintres comme Botticelli ou Bacon, d’une actrice Jean Seberg, d’un écrivain Alejo Carpentier. Vous vous intéressez aux différents arts et aussi au théâtre. Pourquoi avez-vous choisi la littérature ? En quoi, les liens avec les autres arts vous paraissent-ils essentiels ?
À la différence de la plupart de mes confrères, je n’ai pas choisi la littérature, elle s’est imposée à moi. J’y suis venu vers l’âge de vingt ans, à cause du théâtre, et de la troupe que j’avais fondée avec quelques amis jeunes acteurs professionnels comme moi. Il nous fallait des textes originaux pour nos tournées. J’ai commencé par des montages, sur Ionesco entre autres, puis, petit à petit, j’en suis venu à écrire et à mettre en scène mes propres textes. Quand j’ai arrêté le théâtre, brusquement à vingt-six ans, je suis passé au roman "Pour voir… Au cas où…". Mais je n’y connaissais rien. J’ai travaillé chaque jour en revenant de mon boulot de salarié en entreprise. Ma femme m’a aidé, ne serait-ce qu’en me permettant de m’enfermer pour écrire pendant des heures. Je me suis accroché. J’ai commencé à adorer cette empoignade sans merci avec les images, les sentiments et les mots. Et puis j’ai eu de la chance, j’ai fait les bonnes rencontres au bon moment.
Dans votre dernier recueil de nouvelles paru chaque nouvelle est écrite avec un style différent comme ce que vous aviez réalisé dans Jean S. où différentes formes d’écritures apparaissaient. Pourquoi variez-vous ainsi les formes d’écriture ?
L’écriture est aussi un jeu. Quand j’écris, je redeviens acteur, je me coule dans mon sujet, dans la peau de mes personnages. Je joue tous les rôles, je parle de dix manières différentes à la fois. J’adore ça ! Je suis un écrivain caméléon.
Comment avez-vous constitué votre dernier recueil de nouvelles ? Avez-vous écrit ces nouvelles sur la même période ?
La nouvelle, pour moi, c’est un laboratoire. Dans Au voyageur qui ne fait que passer, certaines nouvelles ont vingt ans. Je les ai réécrites au moins dix fois, tous les deux ans environ. Ce coup-là, c’est leur version définitive. J’ai écrit aussi d’autres textes originaux spécialement pour ce recueil, comme la nouvelle sur le boxeur amoureux de son adversaire qui était une sorte de répétition du corps à corps de Frankie et de Tony. Ou comme la dernière nouvelle, écrite à mon retour du Japon, il y a quelques mois. Je suis assez surpris d’entendre certains lieux communs concernant la nouvelle, comme quoi rien ne serait plus difficile à réussir que la fiction brève. Pas du tout ! Que je la rate ou que je la réussisse, chaque nouvelle me paraît toujours facile à écrire. Je procède d’une traite : en trois ou quatre jours, au maximum en une semaine. C’est une vraie détente, alors que dans le roman, je rame assez souvent…
Vous avez participé à l’aventure d’une revue Nouvelles Nouvelles, créée par Daniel Zimmermann et Claude Pujade-Renaud. Que vous a apporté cette expérience ?
J’ai rencontré mes amis écrivains les plus chers, comme Claude Pujade-Renaud et Daniel Zimmermann, Annie Saumont, Georges-Olivier Châteaurenaud, Hugo Marsan, Paul Fournel ou Christiane Baroche à cette époque. À leur différence, j’étais alors exclusivement romancier. J’ai publié d’abord sept romans avant mon premier recueil de nouvelles. Ces gens-là partageaient une telle passion ! Comment y aurais-je échappé ?
Vous avez aussi participé à l’écriture d’ouvrages collectifs avec d’autres écrivains. En quoi, cela diffère-t-il du travail d’écriture solitaire et quel en est l’intérêt pour un écrivain ?
L’écriture collective est une autre forme de jeu. Dans un roman écrit à six ou sept, de nouvelles règles apparaissent sans cesse, cela devient vite un casse-tête du fait des différences d’univers, d’écritures, de sensibilités… Nous sommes actuellement sur un projet en ce sens avec Annie Dana, Jean Claude Bologne, Denis Borel, Michel Host et Jean-Luc Moreau. Ça dure depuis un an et on n’est pas encore au bout, mais je crois qu’on va y arriver.
Vous avez été Président de la Société des gens de lettres pendant quatre ans. Pouvez-vous nous rappeler les fonctions de la SGDL. Quel bilan pouvez-vous établir à la fin de votre mandat ?
La Société des Gens de Lettres est la plus ancienne (fondée en 1838), et la plus importante association d’auteurs de l’écrit en France (6 000 membres, écrivains, traducteurs, auteurs pour la radio, scénaristes et auteurs du multimédia). Reconnue d’utilité publique, elle remplit une triple fonction : une mission de promotion des œuvres de langue française et de leurs auteurs ; une mission d’ordre social de défense, de soutien et d’accompagnement, des auteurs en difficulté financière, professionnelle, etc. ; et enfin une mission d’ordre juridique et normatif, avec, entre autres, un service de conseil juridique à destination de tous les écrivains sous contrat d’édition et une action de défense des droits des auteurs. Il faut savoir par exemple que la SGDL est à l’origine de la création de l’AGESSA, la caisse de Sécurité sociale et de retraite des auteurs, et de la nouvelle Loi sur le droit de prêt en bibliothèque qui, dès 2007, va nous permettre à tous de toucher des revenus sur l’achat de nos livres par les bibliothèques, sans que cela ne coûte un centime d’euro supplémentaire aux lecteurs emprunteurs. Pour plus d’infos, je vous renvoie sur notre site : www.sgdl.org. Quant au bilan de mes 4 ans de présidence (délai légal), il est un peu tôt pour le tirer. D’un point de vue personnel, ce fut une expérience inattendue et passionnante. Je laisse entre autres derrière moi une importante réforme statutaire qui devrait modifier assez profondément le fonctionnement de cet organisme unique en son genre, entièrement voué à l’information et au service des auteurs.
Cette fonction est bénévole. Est-ce que c’est aussi une façon de s’engager comme écrivain ?
En l’occurrence, je suis très partisan du bénévolat, même s’il s’agit quasiment d’un travail à temps plein. Il ne peut y avoir un quelconque intérêt personnel à se consacrer à une pareille tâche. En plus, comme il faut quand même bien gagner sa vie…. cela élimine toute tentation de s’accrocher au poste plus que de raison.
Quel est l’avenir de la littérature à votre avis ?
Je crois en cet avenir, à deux conditions. La première c’est que nos droits d’auteur (droit moral et droit patrimonial) soient consacrés et respectés, malgré ce cancer de la gratuité qui ronge notre société vouée à l’accès immédiat et dérégularisé de toutes les sources de culture et de savoir. Faute de réaction immédiate de notre part, le danger qui menace la circulation et l’intégrité de nos œuvres peut non seulement éliminer les vrais auteurs, mais aussi les éditeurs qui les publient et les libraires qui vendent leurs livres. La seconde condition, c’est que nous trouvions de nouvelles formes de création originales sur Internet, en rapport avec les potentiels énormes d’un tel média, et que nous fixions vite les règles qui en encadreront équitablement le partage.
Propos recueillis par Brigitte Aubonnet
Mise en ligne : 28 août 2006
|
|
|

(Cliquer sur la couverture
pour lire sur ce site
un article concernant
Deux personnages sur un lit
avec témoins)
Bibliographie :
ROMANS
L'Homme disparu
Albin Michel, 1979
Roman d'une ville
en douze nuits
Albin Michel, 1980
Un vieux fusil italien
dont plus personne ne se sert
Calmann-Lévy, 1982
Vasile Evanescu,
l'homme à tête d'oiseau
Calmann-Lévy, 1983
(prix Libre 1984)
118, rue Terminale
Calmann-Lévy, 1984
Le Livre de Poche
Lazare ou le Grand Sommeil
Calmann-Lévy, 1985
Pocket
L'Égal de Dieu
Calmann-Lévy
Le Livre de Poche
(prix Femina 1987)
Baptiste
ou la dernière saison
Calmann-Lévy, 1990
Le Livre de Poche
Jo... ou la Nuit du monde
Calmann-Lévy, 1992
Sulpicia
Zulma, 1992
Pocket
L'Affaire Grimaudi
(en collaboration avec Jean Claude Bologne, Michel Host, Dominique Noguez, Claude Pujade-Renaud, Martin Winkler, Daniel Zimmermann)
Le Rocher, 1995
L'Enfant-lune
Julliard, 1995
Alessandro
ou la guerre des chiens
Flammarion, 1997
Les Noces fatales
Flammarion, 1999
Le Pauvre d'Orient
Presses de
la Renaissance, 2000
Lapidation
Fayard, 2002
Le Livre de Poche
La Déclaration d'amour
Fayard, 2003
Jean S.
Fayard, 2004
NOUVELLES
L'Éveil
Le Castor Astral, 1985
La Vierge au creux du chêne
Le Verger Éditeur, 2002
Au voyageur
qui ne fait que passer
Fayard, 2006
ESSAIS
Sénèque
(en collaboration
avec Joël Schmidt)
Nouvelles-Nouvelles, 1990
Alejo Carpentier
Julliard, 1994

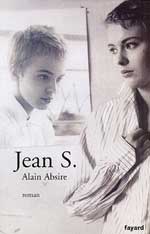
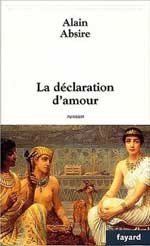

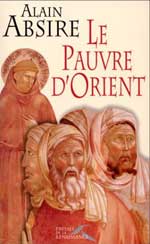





|
|