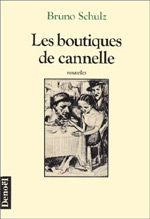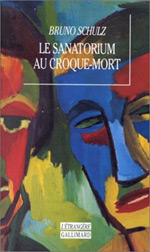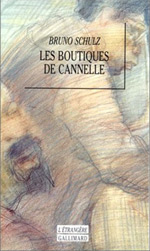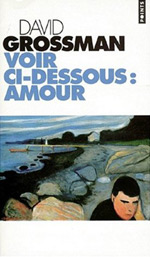|
|
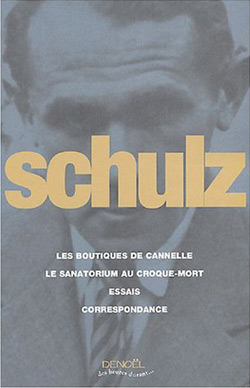 |
Bruno Schulz,
le magicien
par Monique de Carvalho
Je n’oublie pas, Bruno, je n’oublierai jamais le moment où tu es entré en moi, la brûlure que j’ai sentie à l’instant où tu as sauté de la jetée, la chaleur qui se dégageait de ton corps, et il y avait autre chose- à l’époque, je ne savais pas ce que c’était […] c’est seulement après que j’ai compris qu’il s’agissait de l’odeur du désespoir […]
(David GROSSMAN, Voir ci-dessous : amour, p.126)
|
On n’entre pas par hasard dans l’œuvre de Bruno Schulz. Et si on le fait, on n’en sort pas indemne. On l’a parfois comparé à Kafka, à Musil, à Rimbaud – à Chagall aussi pour son œuvre graphique. Schulz, c’est tout cela à la fois – et bien plus… « Parfois il écrivait comme Kafka, parfois comme Proust et il a fini par atteindre des profondeurs auxquelles ni l’un ni l’autre n’ont accédé » disait Isaac Bashevis Singer quand il a découvert Schulz en 1963. Il ajoutera plus tard, interviewé par Philip Roth : « Plus je lis Schulz, plus je le trouve meilleur que Kafka » (Philip Roth, Parlons travail).
L’époque de Schulz, c’est celle du début du 20ème siècle, dans cette Europe germano-slave de l’empire austro-hongrois qui connaîtra bien des vicissitudes. La ville où Schulz naît, vit et meurt, c’est Drohobycz au destin tumultueux : rattachée à la Pologne en 1918, à l’URSS en 39, à l’Allemagne nazie en 41, puis à l’Ukraine. On y a parlé, entre autres, le polonais, l’allemand, le yiddish. La famille de Schulz fait partie de la communauté juive mais n’est pas pratiquante. C’est le polonais qu’elle parle, c’est en polonais que toute l’œuvre de Schulz est écrite, et c’est du polonais que toute une équipe l’a (excellemment) traduite pour l’édition Denoël de 2004 : petite œuvre complète par la taille mais tellement immense par le talent ! Le volume comprend Les boutiques de cannelle et Le sanatorium au croque-mort plus des récits divers et des essais qui sont souvent des critiques littéraires parues dans des journaux ou revues ainsi qu’une correspondance à divers destinataires. Bien entendu, il s’agit là de ce qui a été retrouvé, bien des manuscrits et des lettres ayant été perdus – et notamment le roman auquel il travaillait avant son assassinat par un SS en 1942 (Le messie).
Comment définir Les boutiques de cannelle et Le sanatorium au croque-mort ? Chaque chapitre de chacun de ces recueils ressemble à une nouvelle dont l’ensemble serait un roman. Mais l’ensemble n’est pas un roman non plus. Il n’y a pas une histoire avec un commencement et une fin. Ce sont plutôt des récits où l’on retrouve les mêmes personnages, les mêmes lieux et d’où se dégage finalement une atmosphère, une vision du monde, une métaphysique.
L’impression d’étrangeté qui règne naît de la rencontre du fantastique et de la réalité (La rue des crocodiles, La nuit de la grande saison), de l’hyperréalisme et du fantasme (Jojo), du contraste entre le tas d’ordures et le cadre idyllique (Août) ou de l’horreur qui surgit dans le quotidien (La dernière fuite de mon père). Et dans ce monde ou, bien avant Ismaïl Kadaré (Le palais des rêves), on peut être arrêté pour un rêve (Le printemps), l’imagination n’a pas de limites et l’absurde pas de frontières. Dans Le sanatorium au croque-mort, on peut retarder le temps (p.264) ou le disloquer (p.274) parce que tout est finalement une lutte incessante contre la mort : En ce temps-là mon père était déjà définitivement mort. Il avait été mort plusieurs fois, mais jamais sans reste, toujours avec certaines réserves qui nous obligeaient à réviser le fait même de son décès. (p.326).
Des personnages qui peuplent les récits, le père est le plus important, omniprésent, poète incompris et qui fuit la réalité sordide (Les mannequins) en élevant des oiseaux dans l’appartement (Les oiseaux) ou en se métamorphosant (La morte-saison), pourchassé par la servante Adèle, figure emblématique féminine, représentante de l’ordre et objet de désir.
Caricatures et masques (La rue des crocodiles), poupées de cire et mannequins (Traité des mannequins, Le printemps) surgissent du passé, recréent le présent et donnent à vivre dans une ville, Drohobycz, personnage à part entière, avec ses maisons, son lycée, sa place du marché, ses boutiques (Les boutiques de cannelle).
Base et support à la fois de ces fantasmagories, le Livre. Qu’il soit almanach, catalogue illustré (Le Livre) ou album de timbres (Le printemps) : je l’appelle tout simplement le Livre, sans autres précisions ni épithètes, et il y a dans cette retenue un soupir d’impuissance, une silencieuse capitulation devant l’immensité du transcendant, car aucun mot, aucune allusion ne sauraient briller, embaumer, vibrer de ce frisson d’effroi, de ce pressentiment de la chose sans nom dont le seul avant-goût sur le bout de la langue dépasse les limites de l’émerveillement (p.126). Objet de fascination, c’est aussi le titre d’un recueil de gravures de l’auteur qui fut peintre, graveur et professeur de dessin avant d’être écrivain : Le livre idolâtre.
Sa découverte des couleurs et de la peinture est d’ailleurs évoquée dans L’époque de génie : Et quand je prenais le crayon rouge, des fanfares d’un rouge heureux s’en allaient à travers le monde […] Et quand je prenais la couleur bleue, par toutes les rues et sur toutes les fenêtres passait le reflet pervenche du printemps […]
Est-ce aussi pour cela que le style de l’écrivain est à ce point marqué par l’ombre et la lumière, que les couleurs de ses descriptions font partie intégrante de ses récits ? Ah ces bleus du ciel qui me glaçaient de terreur, ah les verts plus verts que l’étonnement, ah les prémices des couleurs à peine pressenties (L’époque de génie p.142)[…] ou nous préparent, comme la musique dans un film, à une étape décisive de la narration ? Le ciel sans soleil s’ordonna en stries colorées, en couches tranquilles de cobalt, de vert-de-gris, de céladon, cernées, sur leur lisière même, d’une blancheur propre comme de l’eau (Le retraité p.314).
Ce qui est sûr, c’est que les saisons, toujours en arrière-plan, rythment le déroulement des faits et parfois prennent le pas sur eux. Deux récits ont pour titre Le printemps, l’un dans Les boutiques de cannelle, l’autre indépendant et plusieurs portent des titres de saison ou de mois particuliers : Août, La nuit de la grande saison, La nuit de juillet, L’autre automne, L'automne… : voici l’histoire d’un printemps qui fut plus vrai, plus éblouissant et plus violent que les autres (p.151) ou encore : Nul n’a encore dressé la carte topographique de la nuit de juillet (p.221).
On l’aura compris, l’écriture est luxuriante, baroque, métaphorique (les journées en flaques d’eau et braises ardentes laissaient sur le palais le goût du feu et du poivre), poétique en un mot, au sens où Schulz la définit dans un article (La mythification de la réalité), permettant de décrire non la réalité mais sa signification, ce que l’écrivain explique à plusieurs reprises dans sa correspondance (notamment à Witkiewicz et à Anna Plockier).
Et c’est ainsi qu’on peut analyser le caractère "autobiographique" de l’œuvre : non en tant qu’histoire de la vie de l’écrivain mais comme une évocation de souvenirs, d’émotions, de sentiments transposés par l’imagination et le processus littéraire. Schulz disait qu’il n’était pas possible d’atteindre les tréfonds d’une biographie… par la description extérieure ni par l’analyse psychologique… Les données ultimes d’une vie humaine se situent […] non dans la catégorie des faits, mais dans celle de leur signification spirituelle. (Sur Les boutiques de cannelle p.379). La même transfiguration se fait dans son œuvre graphique.
L’Histoire cependant rejoint le mythe quand on sait que dans sa ville occupée par les Soviétiques, Bruno Schulz fut contraint de peindre des portraits de Staline puis sous l’occupation allemande des fresques pour les Nazis. D’abord épargné (la population juive soit meurt dans le ghetto soit est massacrée ou déportée), il est finalement abattu.
Destin tragique certes mais qui ne suffit pas à expliquer l’étrange malaise qui nous vient à lire cette œuvre. Car, au-delà de l’horreur qui peut surgir à chaque coin de page (La dernière fuite de mon père), derrière les fantasmes les plus extravagants (Le printemps), c’est l’extrême solitude que nous touchons du doigt, c’est le désespoir d’un être tourmenté qui vient nous hanter. Et la lecture de la correspondance confirme ce que nous pressentions : un mal de vivre récurrent s’est abattu sur l’auteur : La faute en est à cette dépression qui ne me lâche pas et m’empêche de vivre normalement p.674, Je suis dans l’abattement le plus complet p.704, ces périodes de dépression qui me paralysent p.715.
Le lecteur qui sort littéralement terrassé de cette œuvre ne peut que s’interroger sur l’audience somme toute assez mince de cet immense écrivain. De son vivant, il était cependant reconnu dans les milieux d’avant-garde, ami de Witold Gombrowicz, traducteur en polonais de Kafka. En France, c’est Maurice Nadeau qui, le premier en 1959, a fait paraître La morte-saison dans Les Lettres nouvelles. L’hiver 2004-2005, le musée d’art et d’histoire du judaïsme expose ses œuvres (gravures et dessins) sous le titre La république des rêves, titre d’un de ses récits et Arte diffuse le documentaire allemand de Benjamin Geissler. Et rappelons qu’en 1973, un film tiré du Sanatorium au croque-mort, La clepsydre de Wojciech Has avait obtenu le prix spécial du jury au Festival de Cannes.
On peut ne pas entrer dans l’univers de Schulz mais on ne peut pas y être indifférent. Certains continuent d’être hantés par son univers angoissant, mêlant dans leurs fantasmes œuvre et auteur. Ainsi Bruno Schulz devient lui-même personnage de roman, comme dans la biographie romanesque de Ugo Riccarelli (Un nommé Schulz) ou le roman de Cynthia Ozick (Le messie de Stockholm). Mais le personnage le plus émouvant, celui qui obsède le narrateur, c’est celui du magnifique roman de David Grossman : Voir ci-dessous : amour. Occupant toute la seconde partie du roman, Architecte génial d’une œuvre linguistique unique, dont la magie réside dans la fertilité, une abondance quasi pourrissante de sucs verbaux […] Don Juan qui s’accouple sauvagement avec la langue, il bouleverse la vie de Momik car, dit celui-ci, Bruno est un beau rêve. Et il est plus encore : les choses qu’il m’a fait découvrir m’ont effrayé…
Mise en ligne : juillet 2008
|
|
|
Retour
sommaire
Pour mémoire

Bruno Schulz
(1892-1942)




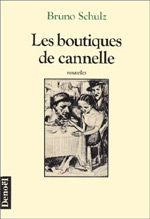
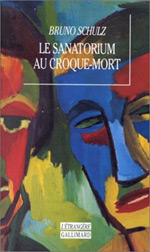
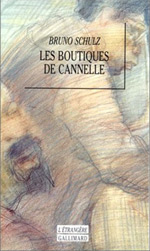

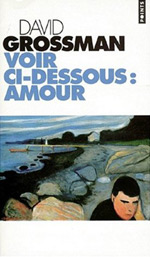
|
|