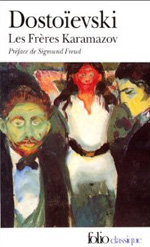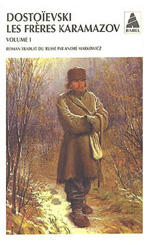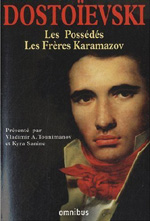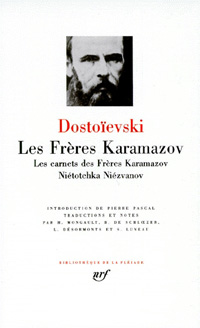|
|
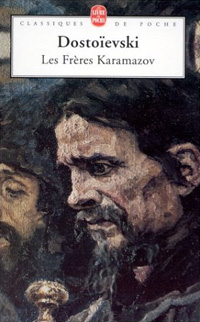 |
Fedor Mikhaïlovitch
Dostoïevski
Les frères Karamazov
|
Les frères Karamazov est le dernier roman de Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski. Il a été publié d’avril 1878 à janvier 1880 sous forme de feuilleton dans le magazine le Messager russe. Cette même année 1880, en édition séparée, sort un tirage de 3000 exemplaires dont le succès est immédiat.
Considéré « comme le génial écrivain de la terre russe », Dostoïevski y fait la synthèse des thèmes philosophiques religieux et moraux qui ont hanté son existence. Il aborde la question de l’existence de Dieu, « est-ce Dieu qui a inventé l’homme ou l’homme qui a inventé Dieu ? » D’autres sujets y sont développés comme l’athéisme et les rapports des hommes entre eux.
C’est un drame spirituel, segmenté en parties, livres et chapitres. L’écrivain y dissèque dans ses moindres détails l’histoire d’un parricide en utilisant la trame d’un roman policier. On retrouve ce thème déjà abordé dans Crime et Châtiment et L’idiot. Comme moyen d’introspection, Dostoïevski utilise un narrateur extérieur, véritable ombre active de lui-même. Cette approche contribue à faire un livre, d’une rare clarté, chevillé en quatre parties.
La première consiste en la mise en place du décor et à la présentation des personnages. Vers le milieu du XIXème siècle, une famille russe de petite noblesse, déracinée et sceptique, est livrée à ses passions. Le père Fiodor Pavlovitch Karamazov est un hobereau violent, rusé, avide d’argent et de sexe.
Son fils aîné Mitia (Dmitri) est l’enfant d’une première mère. Ignoré par son père, il est élevé par Grigori un vieux domestique. Adulte, il devient lui aussi violent, obnubilé par les femmes et l’argent. Il possède néanmoins une âme sensible cadenassée au fond de lui-même et ouverte à la purification par la souffrance.
Le second fils Karamazov, Ivan, est le plus instruit. Enfant d’une deuxième mère, il est lui aussi élevé par Grigori. Solitaire, il est un idéaliste qui « n’admet pas le monde ». Il voue à son père une haine jamais clairement exprimée.
Quant au cadet Aliocha (Alexéi) – même mère qu’Ivan – il est paradoxalement un cœur pur. Engagé dans la voie de l’Eglise, il suit les préceptes religieux de son directeur de conscience le saint starets Zosime qui le prépare à purifier le monde.
On n’oubliera pas Smerdiakov, le redoutable fils naturel, bâtard épileptique.
La deuxième partie contient le thème idéologique : le plaidoyer pour l’athéisme. Face à la condition du peuple russe « ployant sous le travail et le chagrin », quelles sont les solutions envisageables ? Faut-il se positionner laïque ou religieux ? La religion n’offrirait-elle pas la possibilité de se dominer soi-même et de tendre ainsi vers la liberté ? Quelle voie choisir ? Et si l’idéal était en fin de compte une combinaison « Etat-Eglise ».
A l’instar de cela, les rivalités amoureuses se précisent. Catherine, fiancée délaissée de Dmitri, aime souffrir à ne pas être aimée. En position sacrificielle, elle ressasse une illusion de bonheur à se vivre « refusée ». Ainsi accepte-elle que Dmitri s’en aille convoler vers son nouvel amour, Grouchegnka, jeune femme de bon plaisir. Mais cela se complique parce que Fédor Karamazov, le père, aime Grouchegnka à la folie. Alors Dmitri le fils et Fiodor le père, outre des questions d’argent, ne vont pas tarder à en découdre. On en oublierait presque qu’Yvan, l’austère idéaliste, aime Catherine, mais n’est pas aimé par elle.
Alors on a, en lecture, un embrouillamini d’émotions et de sentiments. Les errements passionnés se succèdent à l’envi. Je t’aime, tu m’aimes, je ne t’aime plus, mais si je t’aime encore. Que de promesses confuses ! Que de personnages immatures dominés par leurs hyper-fragilités affectives ! Et quel plaisir compensateur et masochiste à les ressasser. On peut se demander au fond, dans quelle mesure cet « Etat-Eglise » tant prôné, pourrait subvenir à toutes ces carences puériles.
Et pour complexifier la situation, voilà que le saint starets Zosime, référent d’une certaine stabilité de pensée, meurt et dégage une odeur « délétère ». Autour de sa dépouille les moines en restent cois. Comment Dieu autorise-t-il cette puanteur cadavérique ! Le starets était-il un saint authentique ? Aliocha, son disciple, chargé d’aller porter la bonne parole à travers le monde, en vient à douter de son défunt directeur de conscience. Sa perception d’un monde idéalisé vacille. Le monde est avant tout terrestre et les prières y sont de peu d’effet.
La troisième partie est celle du crime.
Dmitri, accusé, se révèle incapable de se défendre. Là, Dostoïevski pousse le bouchon et recense presque toutes les composantes psychologiques de l’âme humaine. Il précède Freud dans le désir inconscient de la mort du père avec la horde originelle des frères et du fils naturel, le redoutable Smerdiakov. On assiste à une longue descente dans les profondeurs de l’homme. A une recherche de thésard. Car qui est coupable dans ce nœud de vipères ? La réponse est claire : tous. Nous sommes tous coupables. On ne peut s’empêcher d’avoir une pensée pour Lettre au père de Kafka. « Quel homme ne désire pas la mort de son père ? » s’écrie Dmitri. Et la tare familiale dont nul n’est exempt apparaît au grand jour, c’est la sensualité. S’y ajoute, sauf pour Aliocha, la soif de l’argent.
La trame policière est bien construite et la quatrième partie résout finalement la question : qui a tué ?
Smerdiakov se révèle dans les faits être le coupable. Il est celui qui porte au plus haut la tare contenue dans le père. Ivan est, quant à lui, un assassin potentiel miné par le désir. Mais c’est Dmitri qui est condamné.
Il y aurait d’autres façons d’aborder cette œuvre aux richesses inépuisables. Elle est en soi une tragédie intime où l’écrivain a mis beaucoup de lui-même. Mais il demeure un angle fort, l’image du père, qui a probablement hanté Dostoïevski toute sa vie. Son père, Mikhaïl Andreïevitch qui, retiré à la campagne, buvait et tyrannisait ses serfs. Il fut retrouvé mort dans son champ, probablement assassiné.
Alors cet homme, quel mystère ? De quelle nature est faite ce mal qui lui colle à la peau et le dévore. Pourquoi y a-t-il en lui cet appétit de domination, ce besoin de faire souffrir les autres et lui-même. D’où proviennent ces pulsions autodestructrices ? Son âme ne serait-elle pas le champ où « le diable avec Dieu se livrent combat » ? Et que vaut la société où il habite?
A force de s’interroger, l’écrivain opère une véritable analyse d’ordre psycho-sociétale, car quelles perspectives envisager dans ce galimatias ?
Début 1880, épuisé par d’incessantes attaques d’épilepsie, Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski termine son ouvrage à bout de forces.
Les frères Karamazov ont influencé un grand nombre d’auteurs et de penseurs. Sigmund Freud a signalé cet ouvrage comme « le roman le plus imposant qu’on ait jamais écrit. »
Patrick Ottaviani
(27/12/10)
Ainsi commence le roman :
Alexéi Fiodorovitch Karamazov était le troisième fils d’un propriétaire foncier de notre district, Fiodor Pavlovitch, dont la mort tragique, survenue il y a treize ans, fit beaucoup de bruit en son temps et n’est point oubliée. J’en parlerai plus loin et me bornerai pour l’instant à dire quelques mots de ce « propriétaire », comme on l’appelait, bien qu’il n’eût presque jamais habité sa « propriété ». Fiodor Pavlovitch était un de ces individus corrompus en même temps qu’ineptes – type étrange mais assez fréquent - qui s’entendent uniquement à soigner leurs intérêts. Ce petit hobereau débuta avec presque rien et s’acquit promptement la réputation de pique-assiette : mais à sa mort il possédait quelque cent mille roubles d’argent liquide. Cela ne l’empêcha pas d’être, sa vie durant, un des pires extravagants de notre district. Je dis extravagant et non point imbécile, car les gens de cette sorte sont pour la plupart intelligents et rusés : il s’agit là d’une ineptie spécifique, nationale.
Il fut marié deux fois et eut trois fils ; l’aîné, Dmitri, du premier lit, et les deux autres, Ivan et Alexéi, du second. Sa première femme appartenait à une famille noble, les Mioussov, propriétaires assez riches du même district. Comment une jeune fille bien dotée, jolie, de plus, vive, éveillée, spirituelle, telle qu’on en trouve beaucoup parmi nos contemporaines, avait-elle pu épouser pareil « écervelé », comme on appelait ce triste personnage ? Je crois inutile de l’expliquer trop longuement.
J’ai connu une jeune personne, de l’avant-dernière génération « romantique », qui, après plusieurs années d’un amour mystérieux pour un monsieur qu’elle pouvait épouser en tout repos, finit pas se forger des obstacles insurmontables à cette union. Par une nuit d’orage, elle se précipita du haut d’une falaise dans une rivière rapide et profonde, et périt victime de son imagination, uniquement pour ressembler à l’Ophélie de Shakespeare. Si cette falaise, qu’elle affectionnait particulièrement, eût été moins pittoresque ou remplacée par une rive plate et prosaïque, elle ne se serait sans doute point suicidée.
Les frères Karamazov
Bibliothèque de la Pleiade, Gallimard 2009
Traduction : Henri Mongault
|
|
|
Retour
sommaire
Pour mémoire

Fedor Mikhaïlovitch
Dostoïevski
(1821-1881)
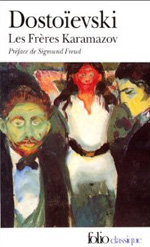
Folio
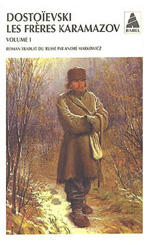
Actes Sud / Babel

Actes Sud / Babel
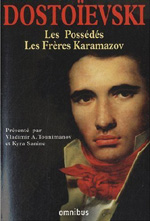
Omnibus
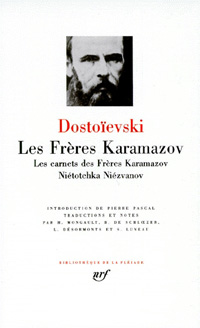
Gallimard / Pleiade
Voir la page de
Dostoïevski
sur Wikipedia
|
|