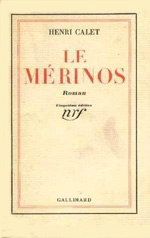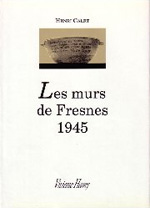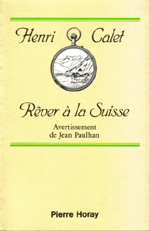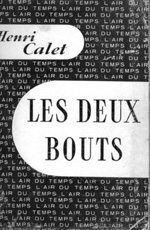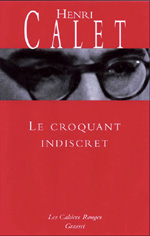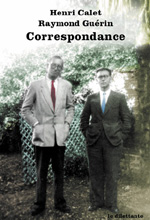|
|

Henri Calet
(1904-1956)
par David Nahmias
Des rides au cœur
Dimanche, au marché du livre, Parc Georges-Brassens, sur un étalage, un Bouquet d’Henri Calet à un prix "europhorique" !… Je demande au bouquiniste l’aumône d’un rabais.
- S’ils sont chers, c’est parce que je dois les acheter ! me dit-il.
Un argument choc qui ne permet aucune réplique, aucun commentaire. Je me hasarde à le questionner sur les éventuels autres exemplaires de l’œuvre d’Henri qu’il pourrait posséder…
- Aucun !… dit-il. D’ailleurs, je n’en cherche pas ; si j’en cherchais, j’en trouverais ; mais je n’en cherche pas…Demandez plutôt à lui, là-bas, il a une tête à lire Calet.
L’homme qu’il me désigne porte un chapeau mou, une veste en cuir râpé, une écharpe rouge et une barbe grisonnante. Assis devant son stand sur une chaise pliante, il lit une revue scientifique, j’entrevois sa tête.
Une tête à lire Calet… Sans doute de nos jours y a-t-il une tête à lire Calet ou untel ou tel autre, comme si l’on pouvait deviner nos lectures sur nos traits, en filigrane, comme si elles avaient fini par laisser des traces.
Je pense à la sienne de tête, celle d’Henri bien sûr, sa tête de cadre moyen harassé par ses responsabilités ; une tête d’homme grave, le visage crispé, comme si une douleur, un souci persistait dans sa chair et ses pensées ; la tête de quelqu’un à qui on hésiterait, dans la rue, à demander l’heure, ou pire une cigarette.
On parle souvent de l’ironie des écrits d’Henri Calet. Lorsqu’on le lit on l’imagine arborant un sourire moqueur : « Il y a toujours sur le coin des lèvres un petit rire ironique qui se moque de lui-même et de la vie. »1, « L’ironie qu’il y a dans ses récits, sa tendresse exprimée à demi mot, son sourire un peu désabusé de qui n’attend rien du ciel ou de l’État, tout cela le reflète, tout cela lui ressemble. »2 Sur une photo de lui, vue récemment, il porte des lunettes d’écailles et ses yeux, aux paupières lourdes, lui donnent le regard d’un poisson que l’on a sorti de l’eau. Sans doute sa grande déception a-t-elle été de rester parmi les hommes, d’essayer de les comprendre, de les aimer ; on s’use vite à cette tâche et le seul recours qui lui était donné ne pouvait être que l’ironie. C’est ainsi que l’on finit par avoir une tête à écrire du Calet…
Enfin, mon bouquiniste dont, semblait-il, la tête laissait présager qu’il lui était coutumier de lire du Calet, je ne l’ai pas abordé ; d’ailleurs sur son étalage aucun, de ceux que cite dans son journal, un écrivain dont la tête et les idées ne me reviennent suffisamment pas pour que sous ma plume, je daigne laisser apparaître son nom, les nullettantes des années cinquante (Bove, Calet, Dabit)…
Je traîne encore parmi les stands, en me demandant si j’ai, moi, une tête à lire Henri Calet. Peut-être que l’un des bouquinistes que je croise, me reconnaîtra-t-il et se précipitant vers moi, sortira de derrière ses fagots, un vieil exemplaire des Murs de Fresnes ou de Fièvre des polders : Tenez ne cherchez pas plus loin… J’avance parmi les membres de cette corporation pour qui, même les vieilles choses sont au goût du jour ou ne le sont pas. Je ne sais pas au fond si cette tête, je dois l’arborer fièrement ou baisser les yeux sur les pavés pour qu’elle ne soit pas trop visible : lire Calet de nos jours ! Ou alors, les yeux exorbités et rougis par le manque, aller d’une pile de livres à l’autre, les fouiller nerveusement et balbutier, la voix tremblante, au quidam de service : Vous en avez...
Biographie
1898 l’affaire Dreyfus bat son plein. Le 2 janvier L’Aurore publie « J’accuse » de Emile Zola. Pour l’Exposition Universelle de 1900, on a construit des bâtiments autour du grand chandelier creux3 élevé pour celle de 1889 : la Tour Eiffel.
Un soir d’automne, dans un faubourg de Bruxelles, Anne Barthelmess, née Clauss, (la mère du futur Henri Calet) quitte son mari et ses deux enfants. Elle traîne dans la capitale belge, croise des hommes ivres, tourne autour de la gare en rêvant de prendre un train qui part. Elle finit par se réfugier dans le vieux quartier où elle trouve une chambre pour la nuit.
À Saint-Josse-ten-Noode, Louis Barthelmess observe la campagne noyée dans la nuit en espérant apercevoir la silhouette de son épouse qui ne se décide pas à revenir. Il pense sans doute aussi à ce navire, Le Bourgogne, qui a sombré (tout comme lui sombre), comme il l’a lu dans le journal, en emportant avec lui plus de 500 passagers.
Louis Barthelmess tente d’élever seul ses enfants, Ida-Sophie, 7 ans, et Eugène-Théodore, 6 ans. Le père espère toujours le retour de son épouse. Il épie chaque pas, chaque silhouette qui passe devant ses fenêtres pour, au bout du compte, se résigner et se remettre en ménage avec une autre femme.
1900 L’Exposition Universelle bat son plein dans la capitale.
Henri Calet n’a pas encore fait son apparition en ce monde, mais Marc Bernard, qui sera l’un de ses plus fidèles compagnons, voit le jour à Nîmes. Son père est un pêcheur de Majorque.
Dans ce Paris de la belle époque où il semble que l’on ne pense qu’à s’amuser, les théâtres ne désemplissent pas.
Pour se faire quelque argent, Raymond Feuilleaubois, dit Théo, (le père du futur Henri Calet) se retrouve à faire partie de la claque dans certaines salles de spectacles quand il ne monte pas lui-même sur scène pour tenir un modeste emploi de figurant : « Il joua dans "Aphrodite", c’est une de ses meilleures créations : Aphrodite était amenée nue sur la scène par deux nègres. Mon père était un nègre. »4
Le reste du temps, Feuilleaubois vit au petit bonheur d’expédients ou de petites tâches. Il en oublie même de se présenter au conseil de révision. Peut-être rêve-t-il déjà de quitter Paris pour un temps.
Le monde du théâtre fascine Théo. Qui sait s’il n’assistait pas à la première du Roi Candaule d’André Gide, le 9 mai, au Théâtre de l’Œuvre ? En rêvant un peu, on peut même l’imaginer, réglant les éclairages quelque part en coulisses.
Raymond Feuilleaubois s’est décidé à quitter Paris. Peut-être est-ce parce qu’il se trouvait aux abords de la gare du Nord qu’il a choisi de prendre un train pour Bruxelles, sans billet bien sûr, avec un simple ticket de quai.
C’est dans cette ville qu’il va rencontrer Anne Barthelmess, toujours entre deux fugues. Il la croisera sur un trottoir du centre-ville ; la retrouvera devant une tasse de café à la terrasse d’une brasserie et croira l’apercevoir, assise seule, sur un banc de square.
Tous deux sont des fugueurs, deux enragés de vivre. Ils ne peuvent que se reconnaître et s’aimer.
Dans une chambre, à Bruxelles, Anne et Théo font l’amour. Ils le font si fort, ils le font si bien qu’ils engendrent un enfant. Ils rêvent de départs, de voyages, de monter à bord de ce Transsibérien qui, cette année-là, achève enfin sa voie royale, ou bien de se rendre à Paris que la jeune femme ne connaît pas encore ... enfin, ils rêvent...
À Bruxelles, Anne Barthelmess et Théo Feuilleaubois se sont décidés à prendre le train pour Paris. Ils débarquent gare Saint-Lazare. Anne va enfin connaître ce Paris dont elle a tant rêvé. Il fait froid. Derrière les vitres embuées du wagon, elle n’aperçoit que le quai. Il faut attendre un peu. Ni l’un, ni l’autre des deux voyageurs n’a de billet. Théo n’a jamais su se déplacer autrement.
Sur le quai, ils se séparent pour échapper plus facilement à la vigilance des contrôleurs. Grelottante dans son manteau trop serré sur son ventre trop plein, Anne avance lentement, craintive et effarouchée. Elle n’a pas appris à biaiser, à tricher, à fuir ... « Elle se fit prendre par un contrôleur zélé qui la mit entre les mains du commissaire spécial qui l’envoya au dépôt. »5 Théo, lui, habitué à « brûler le dur », est déjà passé de l’autre côté de la barrière, à Paris !
Pour avoir voyagé sans titre de transport, Anne est conduite à la maison de Saint-Lazare. Allongée sur sa couche, une main posée sur son ventre, elle écoute, hébétée parler toutes ces femmes qui l’entourent : des prostituées, des voleuses, des ivrognesses. Elle se demande si les parisiennes sont toutes semblables à ses compagnes d’infortune.
Tout contre la tendre paroi de sa mère, l’enfant qu’elle porte perçoit ce brouhaha, comme un chuchotement prémonitoire du vacarme parisien, quelque chose qui ressemblerait à un prologue autour de cette ville qu’il va bientôt parcourir de long en large.
Quelque temps avant qu’elle n’accouche, Anne Barthelmess est libérée de la prison de Saint-Lazare. On la transporte à la clinique Tarnier, 89, rue d’Assas, et le jeudi 3 mars 1904, à huit heures du soir, naît en ce lieu un superbe bébé du sexe masculin.
Comme Théo a pris le large fuyant ses obligations militaires, – que les autorités du moment ont pourtant ramenées à une durée de deux années – la jeune mère, désespérée, doit donner à son fils le patronyme et la nationalité de son père putatif dont elle n’est pas encore divorcée, quitte à lui attribuer dérisoirement les deux prénoms de son géniteur ; il s’appellera donc : Raymond, Théodore Barthelmess, sujet belge.
La mère et l’enfant ne se portent pas trop mal. Ni l’une ni l’autre ne savent encore qu’Henri Calet vient de pousser ses premiers vagissements en ce bas monde.
C’est dans la rue que j’ai vu l’jour
Dans le quartier du Luxembourg.6
De quelle couleur était le ciel, avenue du Maine, lorsqu’Anne Barthelmess promenait son chérubin en attendant Théo ? Il devait être gris... Anne a depuis peu quitté la clinique Tarnier pour se réfugier dans l’asile maternel tenu par des sœurs et proche de l’église Saint-Pierre de Montrouge. Elle n’a que le regard de son petit Raymond pour se changer de la grisaille du ciel bas et des habits sombres qui circulent dans les couloirs de l’asile.
Puis, Théo étant revenu, le couple s’installe avec l’enfant dans un hôtel de Belleville, passage Julien-Lacroix. Anne est fourchetteuse et Théo écoule de la fausse monnaie.
Ils habitent ensuite rue de Tanger, à la Villette. Théo vend des journaux à la criée avant de trouver un emploi de manutentionnaire dans une usine de paratonnerres.
Décidément, cette année-là, tout est gris... Paris manque de couleurs. Il faut les chercher au Salon d’Automne sur les toiles de Matisse, de Derain... sur ces toiles blanches où se disposent des sensations de bleu, de vert, de rouge...7
Dans les rues du dix-huitième, du quatorzième, on brandille L’Humanité, quotidien que Jean Jaurès a créé l’année précédente. Les ouvriers ne voient pas encore assez rouge. Au fond de leurs bouteilles, leurs âmes restent grises.
Le 6 de la rue Lacordaire n’existe plus. On a ouvert une voie à son emplacement. Celle portant le nom du Général Estienne. Dans son enfance, Raymond Barthelmess y vécut des jours heureux auprès de ses parents enfin réunis.
Anne et Théo emménagèrent dans cette rue de la plaine de Grenelle après avoir séjourné quelque temps dans un hôtel miteux de la rue Sainte-Lucie.
Plus tard, avec nostalgie, Raymond devenu Henri Calet revint sur ces lieux. Rien n’avait changé, ni la cour, ni l’immeuble, ni les pavés, ni la fontaine d’eau dont - le progrès étant passé par là - on avait remplacé la pompe à bras par un robinet. C’était en 1945. Depuis, un général, le « Père des Chars » comme on le surnommait a creusé une tranchée pour y installer une rue, la sienne. « Le passé tombe en miettes dès qu’on y met la main. »8
1907, naissance de Christiane Martin du Gard, qui, par la suite, épousera Marcel de Copet, l’ami intime de son père. Elle sera la dernière compagne d’Henri Calet.
Louis Barthelmess s’est mis en ménage avec Céline Clause. En parcourant une revue bruxelloise, il découvre l’existence d’une colonie utopique, installée dans l’état de Paranâ : Thérèseville. Sans hésiter, il décide de s’embarquer pour le Brésil avec son fils Eugène et la sœur cadette de sa propre femme.
Ida se retrouve seule à Bruxelles.
Les parents du jeune Raymond déménagent à nouveau. Ils quittent la plaine de Grenelle pour le quartier des Ternes où ils dénichent un appartement à la mesure de leurs moyens.
Le déménagement se fait à la cloche de bois, comme le racontera Calet dans Le tout sur le tout, en pleine nuit dans les rues inondées de Paris. Ils emportent le peu qu’ils peuvent dans une barque empruntée pour l’occasion. C’est l’hiver et l’eau monte, ne laissant à la tour Eiffel que l’aspect d’un mât à la dérive. Le niveau de la Seine atteindra son paroxysme le 28 janvier avec une hauteur de 8 mètres 62.
Rue des Acacias, l’existence de la famille de Raymond Barthelmess est douce. Raymond ne va pas à l’école. Son père travaille dans un garage et arrondit ses fins de mois grâce à quelques affaires : majoration de factures, grattage d’écritures, fausse monnaie dont il avait initié la pratique à son épouse. Tout cela permet d’oublier les privations passées.
On déjeune chez Chartier. Théo s’habille chez Hiche-life Tailor (sic). Le soir, la famille réunie s’installe dans les cafés du quartier. Vêtu d’un chandail rouge, le jeune Raymond monte sur les tables et crie "Vive l’Anarchie !", ce qui fait rire tout le monde. On le trouve bien précoce, cet enfant...
« ... Je n’avais peur de rien, on ne m’avait pas encore parlé du bon Dieu ... »9
Mais un triste jour, c’est la chute, celle du petit Raymond qui tombe, la tête en avant, dans la fosse du garage où travaille son père. En le serrant dans ses bras, Théo le transporte à l’hôpital. Il ne cesse de lui parler pour que l’enfant ne ferme pas les yeux.
Raymond restera longtemps à l’hôpital où on l’opérera. Il échappe à la méningite, mais contracte une maladie des os.
A partir de cette chute, il lui semblera que le monde autour de lui a changé.
Suite à son accident et à ses conséquences, Raymond Barthelmess est envoyé en septembre, et pour une année, dans un pensionnat spécialisé à Berck-sur-plage. Il voit pour la première fois la mer, mais elle est grise comme un ciel parisien.
Quand, après son séjour à Berck-sur-plage, Raymond Barthelmess regagne Paris, il retrouve sa mère qui vit seule dans une chambre de bonne, 18 rue Brunel, dans le XVII°.
Théo est parti pour se mettre en ménage avec Ida, la propre fille de son épouse.
Anne gagne difficilement sa vie et pratique des métiers aussi divers que variés, de plumassière à femme de chambre. Sans doute se livre-t-elle même à la prostitution du côté de la place de l’Etoile.
C’est une bien triste période pour Raymond. Une brève tentative de réconciliation de ses parents se termine dans la violence la plus inouïe.
Durant quelques mois, Anne et son fils habitent Levallois-Perret.
1914, Raymond Barthelmess poursuit sa scolarité à Levallois-Perret jusqu’en mars avant de retrouver l’école de la rue Saint-Ferdinand dans le dix-septième.
Prémonition, le 31 juillet, André Gide écrit dans son Journal : « ... l’on s’apprête à entrer dans un long tunnel plein de sang et d’ombre ... »
Suivant sa bonne habitude, dès le début des hostilités, Théo Barthelmess a déguerpi avec Ida. Le couple s’est réfugié aux Pays-Bas sous une fausse identité et va y résider durant cinq ans.
De son côté, Anne s’enfuit avec son fils, âgé de dix ans, en Belgique occupée. La jeune femme travaille dans la restauration et l’hôtellerie. Raymond va d’école en école.
« ... Ma mère servait la clientèle, derrière le comptoir. Je m’occupais en menus travaux ; je perçais les tonneaux à la cave ; je remontais le piano mécanique; je semais de la sciure sous les pas des valseurs ... » (…) « Mes dimanches, je les passais à l’hôtel où ma mère était affectée à l’entretien des lavabos et des W.C. Le personnel l’appelait Madame Caca ; sans intention injurieuse, c’est le titre de la charge... »10
Le 3 juillet 1915, à Leyde (Pays-Bas), naissance de Louis, Nicolas Barthelmess, fils d’Ida et de Théo. Le bambin réussit le paradoxe d’être à la fois le demi-frère et le neveu de Raymond.
Celui-ci continue d’aller d’école en école. Il séjourne à Bruxelles chez sa tante Louise : « …Bruxelles était une étuve, un dépotoir, un boxon grandiose, un arrêt court dans le voyage de la vie au trépas. Une pause pour les officiers avant d’aller respirer le parfum des violettes par en-dessous. »11
À Bruxelles, Raymond Barthelmess observe du haut de ses onze ans la suite des événements : « ... la nuit et le jour, au loin, la guerre continuait. Nous collions l’oreille au sol pour entendre les grondements du canon et notre foi en la victoire finale restait intacte : ils se faisaient grignoter… »12
1916 Raymond se trouve toujours en Belgique : « ... J’ai passé, usé si l’on veut, cinq années de ma jeunesse à Bruxelles – de dix à quinze ans – Ce sont des années importantes durant lesquelles le corps et l’esprit prennent plus ou moins forme humaine ; c’est la période de la dentition, et du cerveau, si j’ose ainsi dire ... Nous habitions dans une rue pauvre au nom triste : rue des Charbonniers, en bordure de la Senne ... »13
Après avoir fréquenté l’école moyenne de la rue Traversière à Saint-Josse-ten-Noode, il se retrouve à l’Institut Steyaert : « ... pendant quelques mois, j’ai été interne dans une petite pension du faubourg d’Anderlecht. Je ne pense pas qu’il existe au monde des régions plus sinistres que celles que nous parcourions en rangs, le jeudi, le parapluie réglementaire de coton au bras ... nous étions tous affamés ... »14
Au collège des Bourgmestres et des Echevins, rue des Coteaux à Bruxelles, Raymond Barthelmess est noté comme un "bon élève".
Il va rester scolarisé dans cet établissement qui lui prodigue un excellent enseignement général jusqu’en octobre 1919. Il regagne ensuite Paris en compagnie de sa mère. Anne va se remettre en ménage avec Théo, tandis qu’Ida et son jeune enfant restent aux Pays-Bas. Les études de Raymond sont terminées. Il se prépare à entrer dans le monde du travail.
1920, Théo et Anne Barthelmess habitent désormais dans un deux pièces assez misérable dans l’immeuble de la rue Brunel dans le XVII° arrondissement où la jeune femme vivait avant la guerre. Tous deux occuperont ce logement jusqu'à la fin de leur vie. Il existe une photo du couple dans la salle à manger, l’un face à l’autre plongé dans leurs occupations.
Les retrouvailles de Raymond et de son père sont difficiles. Le jeune homme n’a pas oublié la violence de Théo envers sa mère avant leur séparation.
Durant quelques années, il va connaître la ronde des "petits métiers". Il sera successivement – mais sans succès excessif – petit clerc d’huissier près de la Porte Saint-Denis, représentant d’une marque de savon à barbe, aide-chimiste chez Nicolas et assistant-potard dans une pharmacie de la rue Pavée.
Il poursuit, ainsi sa chasse aux petits boulots. Il trouve un poste d’aide-comptable dans une société d’accessoires automobiles, puis à Levallois-Perret, de secrétaire dans une usine d’aéroplanes.
1922 Ida, la sœur d’Anne Barthelmess est de retour à Bruxelles. Elle rencontre Jean de Boe, personnage haut en couleurs : anarchiste, il a sans doute appartenu à la bande à Bonnot. Lui aussi revient en Belgique après avoir effectué un séjour forcé en Guyane. Très cultivé, parlant plusieurs langues, il est typographe de métier et devient un grand leader syndical.
Ida et lui se mettent en ménage. Ils auront un enfant, deux ans plus tard.
Janvier 1923. Depuis un mois, Raymond Barthelmess travaille en tant que mécanographe dans une épicerie en gros du quartier de la Bastille.
Il conservera cette place jusqu’en juin 1925.
En juin 1925, Raymond Barthelmess entre, comme aide-comptable, à la Société L’Electro-Cable, 2 rue de Penthièvre, dans le VIII° arrondissement. Il y restera cinq ans, "actif" et "consciencieux", donnant entière satisfaction à ses supérieurs. Les midis, il descend les Champs Elysées fouillant du regard les belles parisiennes, les abordant parfois.
Théo Feuilleaubois épouse enfin Sophie-Anne Clauss, divorcée de Louis Barthelmess, le 9 octobre 1926. Raymond est désormais officiellement le fils de Monsieur et Madame Feuilleaubois, mais il n’effectue aucune démarche pour acquérir le nom de son vrai père, sans doute par rancœur vis-à-vis de son géniteur et en se souvenant des douleurs que celui-ci avait infligé à sa mère.
Raymond Barthelmess habite toujours chez ses parents. Durant l’été 1927, il part en vacances dans les Pyrénées-Orientales. Au cours de son périple, il fait la connaissance d’un garçon de son âge avec lequel il se lie d’amitié et qui lui fait découvrir un univers inconnu de lui jusqu'à ce jour : la peinture, la musique, le théâtre et surtout, la littérature.
Raymond se sent à cette époque "communiste, pro-allemand et pacifiste".
En revenant un soir de L’Electro-Cable, il découvre sa mère en pleurs : Louis Barthelmess, son premier époux est mort au Brésil.
Appelé sous les drapeaux Raymond Barthelmess effectue un très bref service militaire, du 10 mai au 13 juin 1928. On ne trouve aucune trace de ce petit mois dans ses écrits ni sa correspondance.
En vacances dans les Landes, il rencontre Sima, une cantatrice russe, mariée et mère d’une petite fille. La jeune femme va devenir sa compagne et le restera jusqu’en 1932.
De retour à Paris, où Raymond continue ses activités de comptable à la Société de L’Electro-Cable, le couple habite dans un meublé, rue de l’Armaillé.
Promotion : Raymond Barthelmess est nommé chef-adjoint de la comptabilité à L’Electro-Cable
Son train de vie s’améliore. Il achète une automobile, effectue de nombreuses sorties, part en vacances avec Sima sur la Rivièra, et pour tenter d’améliorer l’ordinaire, joue aux courses des sommes de plus en plus importantes. Toutes ces dépenses l’amènent progressivement à se livrer à des manœuvres frauduleuses au sein de son entreprise : fausses écritures, transfert d’argent illissides etc. Mais cela ne suffit pas, Raymond Barthelmess est de plus en plus acculé. Le 23 août 1930, ses impératifs besoins d’argent poussent « l’employé modèle » à dérober une somme importante, environ 250.000 francs, dans le coffre-fort de L’Electro-Cable dont, de par ses fonctions, il détient la clé.
Le soir même, à la gare du Nord, il prend le train pour Liège avec Sima. Il espère rencontrer en Belgique Jean de Boe, le compagnon de sa tante Ida qui, vu son passé aventureux, pourra lui indiquer la filière à suivre pour quitter l’Europe dans les meilleurs délais.
À Liège, Raymond et Sima se séparent. Elle regagne son pays et lui, réussit à prendre à Ostende un bateau qui le mène en Angleterre. De là, il s’embarque sur le Highland Hope à destination de l’Argentine, via le Brésil et l’Uruguay.
C’est le 10 octobre qu’il arrive à Montevideo, mais désormais Raymond Barthelmess, désormais recherché pour escroquerie, doit disparaître.
Il se procure, le 27 octobre, un faux-passeport attribué à un certain Henri Calet, commerçant Nicaraguayen, né à Léon le 13 mars 1903, de père hollandais et de mère belge.
Raymond Barthelmess n’existant plus, avec vingt-six ans de retard, Henri Calet fait son apparition sur cette planète...
À l’autre bout du monde, en Uruguay, celui qui est devenu Henri Calet dépense d’une manière dérisoire l’argent qu’il a volé. Il fréquente des proscrits, des agitateurs professionnels qui utilisent ses fonds sans vergogne.
Là-bas, il a retrouvé son frère Eugène et il envisage d’aller tenter sa chance au Brésil en sa compagnie.
Cette tentative d’expédition pour le Brésil entreprise, sans grande conviction par Henri Calet et son demi-frère, échoue lamentablement. Quelques jours plus tard, Calet est déjà de retour à Montevideo où, désemparé, il continue à multiplier échecs et expériences navrantes. Il a créé un fond de librairie dont il ne s’occupe guère, mais par contre, il a repris sa triste habitude de flamber sur les champs de courses. Il fréquente assidûment l’hippodrome de Maronas.
Il se lie avec Mana, une réfugiée politique qui travaille comme serveuse à L’Internacional Bar. Tous deux vont vivre ensemble plusieurs semaines.
Mais Henri Calet tombe sous la coupe ambiguë de Luis Eduardo Pombo, un jeune homosexuel uruguayen plein de charme, très cultivé, amateur d’art et de poésie. Les deux hommes s’étaient rencontrés peu de temps avant le départ avorté de Calet pour le Brésil. Lorsqu’ils se sont revus, Henri Calet, fasciné par Pombo a très vite rejeté sa compagne. Pombo qui lui est devenu indispensable l’initie à la cocaïne. L’engrenage est rapide. Les ressources financières de Calet commencent à diminuer. Tandis que son accoutumance à la drogue s’accentue, sa relation avec son ami se détériore. Il vit reclus et accélère comme volontairement sa descente aux enfers. Il envisage le suicide, mais un ultime sursaut lui donne la force de réagir. Il s’embarque le 12 avril 1931 sur le Vigo, un vapeur à destination de l’Allemagne.
À bord, Henri Calet noue une éphémère histoire d’amour avec une jeune danoise, et le 15 mai, via Hambourg, il arrive à Berlin où il retrouve Sima. Le couple se reforme et connaît une période de grande gêne financière. Calet envisage un temps de retourner an Uruguay afin de s’occuper de sa librairie de Montevideo, mais il doit y renoncer ayant appris la faillite du magasin.
Il effectue divers séjours mystérieux en Belgique, dans le nord de la France et à Paris.
1932 Henri Calet réside toujours à Berlin. La période de vaches maigres continue et, pour subsister, il donne des leçons particulières de français. Il se sépare de Sima qui regagne Moscou.
Le 31 juillet, Henri Calet est de retour près de Paris. Il loge dans une pension de famille à Puteaux. Il connaît une période trouble et de grande solitude car il reste un "illégal" qui doit se cacher en permanence. Il est amené à effectuer de fréquents déplacements dans la capitale avec l’angoisse permanente d’être contrôlé par la police. Cela ne l’empêche pas de militer dans des organisations prolétariennes.
Il écrit à Pombo qui ne répond pas à ses lettres.
Á la fin de l’année, Henri Calet fait la connaissance de Cathy Grabscheid, une autrichienne au visage disgracié dont il brossera un tableau pathétique dans Le Mérinos et dans Le Tout sur le Tout.
Il rencontre un peintre hongrois, Roland Dedié et sa compagne Rozsi pour laquelle il éprouve une passion sans espoir.
Il écrit des poèmes et rédige sa première nouvelle, Vie de famille.
Après avoir vécu dans une chambre de bonne, rue Changarnier, dans le XII° arrondissement, il habite désormais 7 impasse du Rouet dans le XIV°.
Pombo ne répond toujours pas à ses lettres passionnées.
Henri Calet se cache toujours dans le XIV° arrondissement. Il poursuit sa vie d’errance. Sa nouvelle, Vie de Famille, est publiée en novembre 1933 dans la revue "Avant Poste", grâce à son ami Michel Matveev.
En mars 1934 Henri Calet séjourne au Portugal avec Roszi, puis au Açores, à Ribeira Grande, où il commence à écrire La belle lurette.
Le 16 octobre, Raymond Barthelmess refait surface : il est condamné par défaut à cinq années d’emprisonnement et à 3.000 francs d’amende, suite à une plainte des "Tréfileries, Laminoirs et Fonderies de Chauny".
Henri Calet, quant à lui, reste toujours planqué et continue d’écrire son roman. Il s’est réfugié le 18 du même mois dans une chambre de bonne, rue Edgar-Poë, près des Buttes-Chaumont.
Courant janvier 1935, Henri Calet entame une liaison avec Marthe Klein, veuve du sculpteur Alexandre Grossmann.
A nouveau, le 12 mars, Raymond Barthelmess revient sur la sellette : par défaut, il est condamné à restituer au titre de dommages et intérêts la somme de 250.000 francs, pour le délit d’escroquerie et d’abus de confiance concernant les faits remontant à 1930.
A la même époque, à la N.R.F, Jean Paulhan reçoit avec enthousiasme son manuscrit de La belle lurette qui paraitra en d’octobre 1935 chez Gallimard. Bon accueil de la critique et témoignages d’estime de la part de Gide, Max Jacob, Marc Bernard et Eugène Dabit.
Henri Calet entame sa correspondance avec Georges Henein et devient ami avec Pascal Pia.
Il habite désormais avec Marthe Klein, 31, rue Jeanne, dans le XV° arrondissement.
1936 Jean Paulhan fait engager Henri Calet comme correcteur au journal « La Lumière ». Calet occupera ce poste, deux jours par semaine, jusqu’en 1940.
Tout en écrivant parallèlement des articles, des critiques et des nouvelles il commence un nouveau roman : Le mérinos.
Le 11 février, Calet écrit à son ami Pombo qui ne répond que parcimonieusement à la correspondance qu’il lui adresse depuis son retour en Europe : ... j’ai été heureux de recevoir une lettre de toi -, n’est-ce pas la troisième en cinq années ?... Voici toutes sortes de nouvelles au sujet de La belle lurette : Les critiques furent assez nombreuses et favorables, à part quelques unes d’extrême droite. Entre autres j’ai eu les honneurs de la première page du "Flambeau", le journal du Colonel Comte de la Rocque, chef de nos fascistes. Deux colonnes pour le "misérable romancier". André Gide m’a félicité de vive voix, très chaudement et c’est le plus valable témoignage... Malraux n’a pas aimé mon livre, je le regrette... J’ai reçu beaucoup de bonnes lettres, la tienne est parmi celles-ci...
Alors, quand viens-tu à Paris ? Tu sais, Paris ce n’est pas mal. Je prépare un deuxième livre, je fais de petites choses pour les journaux. Je crois, quand même, que tu es un bon ami et pour cela je t’embrasse...15
En mai 1938, Marthe, la compagne d’Henri Calet, doit subir une délicate intervention chirurgicale. Elle part en convalescence jusqu’au mois de juillet chez son frère, le docteur Alfred Klein qui exerce au Maroc.
Calet connaît toujours d’insidieux problèmes d’argent. Pour le dépanner, Jean Paulhan le fait engager à Radio 37, station où il est chargé de la programmation du "Quart d’heure de la N.R.F". Cette émission sera diffusée tous les mardis à 21 heures 45 jusqu’au mois de janvier 1939.
Henri Calet se sent de plus en plus mal à l’aise : le drame de la guerre d’Espagne et, en Allemagne, les menaces hystériques de Adolf Hitler, le terrifient. Il envisage, un temps, de retourner en Amérique du Sud.
Pourtant, à la fin du mois d’octobre, il s’engage et donne son adhésion au Centre d’Aide aux Intellectuels d’Espagne.
A la fin de cette année, il reprend l’écriture de Fièvre des Polders et entame sa correspondance amicale avec Raymond Guérin.
Depuis le début de l’année 1939, Henri Calet, suivant les chaleureux conseils de Jean Paulhan, s’est remis à l’écriture de Fièvre des Polders.
En mai, il écrit à son ami Pombo : …Je viens de terminer un roman … il paraîtra en automne. Si nous avons un automne … Maintenant, je m’accorde un peu de répit et je regarde autour de moi notre terrible époque. Une fatalité pèse sur nous et nous mène à un immonde destin sans que nous puissions rien faire. Et tout cela est sans grandeur. On mourra pour rien … Nous voilà au printemps. Des avions puants sont au ciel. On distribue des masques à gaz. L’air est déjà empoisonné…16
Le 3 septembre 1939, la guerre est déclarée.
Toujours "hors la loi", car sans état-civil légal, Henri Calet avoue être totalement désespéré et, incapable d’écrire, il continue à se cacher dans Paris.
Puis, enfin, la peine judiciaire de Raymond Barthelmess étant prescrite, Henri Calet peut réapparaître au grand jour.
Le 23 janvier 1940, il épouse Marthe Klein à la mairie du XV°.
Reconnu apte au service armé, le caporal Raymond Barthelmess, dit Henri Calet se retrouve à la Caserne Vauban à Auxerre, le 17 avril, enrôlé d’office dans une compagnie de mitrailleurs. A peine deux mois plus tard, le 15 juin, il est fait, avec bien d’autres, prisonnier à Coulanges-sur-Yonne. C’est donc cette fois en qualité de prisonnier de guerre qu’il rejoint la Caserne Vauban d’Auxerre, avant de se trouver affecté en tant qu’interprète à l’usine Hotchkiss.
C’est sous une troisième identité, celle du mitrailleur Adrien Gaydamour qu’il racontera son odyssée militaire en 1942 dans Le Bouquet, roman dédié à Pascal Pia, qui ne sortira chez Gallimard qu’en 1947.
Le 21 décembre, grâce à la complicité de Marthe, Raymond Barthelmess parvient à s’évader et il redevient Henri Calet. Le couple regagne Paris.
Le 18 janvier 1941, Henri Calet franchit seul la ligne de démarcation. A Lyon, il est accueilli par son ami Pascal Pia qui occupe le poste de secrétaire de rédaction du journal Paris-Soir, replié en zone non-occupée.
Dans la préface de Contre l’Oubli, ouvrage posthume qui paraîtra l’année de la mort de Calet, Pascal Pia écrivait : « Une longue amitié comme la nôtre suppose au moins une certaine connivence. Avec Calet, je me suis toujours senti en confiance. Peu de mes familiers m’ont donné autant que lui le sentiment rassurant d’une complicité naturelle. Entre les chances qui me sont échues, j’aurai eu la chance d’avoir Henri Calet pour ami. »17
Démobilisé quelques jours plus tard, mais ne réussissant pas à trouver du travail, Calet se rend à Tarbes chez des amis qui peuvent l’héberger et où Marthe viendra le rejoindre dans le courant du mois de février.
Le 1er mars, Henri Calet est engagé comme statisticien dans une usine de la Compagnie Générale de l’Electro-Céramique à Bazet, à côté de Tarbes. Pascal Pia lui conseille de continuer à écrire, notamment un ouvrage relatant ses souvenirs de guerre. Ce sera Le Bouquet qui ne sera achevé, dans un premier temps, qu’en 1943.
En avril 1942, Henri Calet jette l’éponge : il laisse tomber son emploi de statisticien à la Compagnie Générale d’Electro-Céramique de Tarbes et va s’installer avec Marthe à Cadéac-les-Bains, dans les Hautes-Pyrénées.
Il s’attaque sérieusement et à temps plein à la rédaction du Bouquet.
Les rafles se multiplient en zone libre. Marthe, l’épouse d’Henri Calet, parvient à obtenir la nationalité française, le 30 juin.
Durant l’été, accompagnés de Jean de Boe, Anne et Théo Feuilleaubois, les parents de Calet, viennent s’installer à Caduc-les-Bains où ils vont rester jusqu’en avril 1944.
Grand ami de Marthe et d’Henri Calet, Marc Bernard séjourne quelques semaines auprès d’eux avec sa famille. Il va bientôt recevoir le Prix Goncourt pour son roman Pareils à des enfants, édité par Gallimard.
A la fin de l’année, Henri Calet doit impérativement trouver du travail. Il reprend contact avec la Compagnie Générale d’Electro-Céramique. Les responsables ne lui tiennent pas rigueur de sa récente démission et, bons princes, lui proposent le poste de directeur-adjoint de l’usine d’Andancette dans la Drôme où il va rester en fonction deux longues années.
1943 Marthe et Henri Calet s’installent à Andance, petit village Ardéchois. C’est une année de découragement et de culpabilité pour Calet qui se sent plus investi dans la céramique que dans l’écriture. Un an déjà ou presque, la première mouture du Bouquet que Pascal Pia n’a pu faire publier en France, paraît le 6 février à New York dans le journal Pour la Victoire.
Henri Calet est nommé directeur de l’usine de céramique en janvier. Après le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, la Résistance entre dans une phase active en Ardèche. Sabotages, bombardements, l’usine dirigée par Calet ferme ses portes.
En septembre, lorsque l’Ardèche est libérée, Henri Calet donne sa démission à la Compagnie Générale de l’Electro-Céramique et en novembre, regagne la capitale où grâce à Pascal Pia, il entre à Combat que dirige Albert Camus.
1945. Cette année sera particulièrement faste pour Henri Calet. Il publie avec un succès croissant ses chroniques dans Combat jusqu’au mois de Juin et devient une sorte de révélation dans les milieux littéraires et journalistiques.
Dans une lettre adressée le 16 janvier à Georges Henein, il l’informe des mille petites choses de la vie parisienne et lui donne des nouvelles de leurs amis communs : « Jean Cassou, après avoir été enfermé et à demi massacré (emprisonné par des français, battu par des allemands) a été nommé commissaire général de la République à Toulouse. Picasso a adhéré au Parti Communiste. Aragon est malade. Marc Bernard qui a obtenu le Prix Goncourt durant l’Occupation, vit retiré à Saint-Julien. Nous nous sommes vus dernièrement… Aucune nouvelle de Pombo. Pouvez-vous correspondre avec lui ? Etiemble est à Alexandrie. Le voyez-vous ? Malaquais à New York, Gide en Algérie (on les malmène un peu)… Jean Paulhan s’est très courageusement comporté durant la guerre ; je trouve qu’il n’a pas changé. Des morts, des déportés, il y en a beaucoup. Morts : Crémieux, Jean Prévost, Politzer, Jacques Decour, Harbaru… Déportés : Jean Vaudal, Martin-Chauffier… Mais peut-être savez-vous tout cela… »
Le Bouquet d’Henri Calet paraît chez Gallimard en mai, et reçoit un excellent accueil de la critique. Depuis Alexandrie, Etiemble écrit dans Valeurs : Et puis comme c’est bon, un type qui ne vous bourre pas le crâne, qui ne le fait pas au héros, ni au héros de la lâcheté… c’est un livre bien sympathique, ce Bouquet …
Calet devient l’un des meilleurs amis de Francis Ponge, rencontré avant la guerre.
En septembre, Pierre Herbart demande à Henri Calet d’écrire des chroniques pour sa revue Terre des Hommes et c’est en décembre que sont publiés Les murs de Fresnes aux Editions des Quatre Vents.
Six années s’étant écoulées depuis que Raymond Barthelmess a bénéficié de la prescription concernant ses "erreurs de jeunesse", Henri Calet est définitivement réhabilité. Sa condamnation est effacée, et il recouvre tous ses droits.
Il continue à publier des chroniques dans Terre des Hommes et dans la presse issue de la Résistance. Après un voyage en Suisse, il publie une série d’articles ironiques qui déclenchent une polémique en Helvétie. En pleine lancée créatrice, il envisage d’écrire le scénario d’un film consacré aux exploits de la bande à Bonnot. Il compte sur son parent Jean de Boe qui, dans ses jeunes années, a personnellement fréquenté Bonnot et ses acolytes, pour le conseiller utilement. Mais de Boe a désormais pignon sur rue. Craignant pour sa respectabilité, il refuse d’apporter sa contribution et le projet cinématographique de Calet est abandonné.
Henri Calet connaît une période de flottement. A la demande de nombreux lecteurs - entre autres, celle d’André Gide – il reprend ses chroniques dans Combat : Je ne me dépêtrerai pas de cette vieille liaison, écrit-il à son ami Georges Henein.
En mai 1947, il publie un recueil de nouvelles, Trente à Quarante, aux Editions de Minuit.
Par les belles journées de printemps, Calet traverse souvent Paris pour rejoindre l’atelier de Jean Dubuffet qui fera de lui plusieurs portraits.
En juin, il commence l’écriture d’un livre sur Paris intitulé Aux vingt arrondissements. Initialement prévu pour Calmann-Lévy, puis pour les Editions de Minuit, l’ouvrage paraîtra finalement chez Gallimard l’année suivante sous le titre Le Tout sur le tout.
Durant le mois d’octobre, Henri Calet écrit pour la radio. Tirée de trois de ses nouvelles, la pièce intitulée Les Mouettes, obtient un vif succès.
A la fin de l’année, durant le séjour qu’il effectue en Algérie avec Marthe et son ami, le poète Francis Ponge, il travaille au Tout sur le tout.
Henri Calet passe un mois à Rabat où il termine Le Tout sur le tout. Il travaille pour Radio Maroc à l’ adaptation de plusieurs de ses nouvelles.
Le Tout sur le tout reçoit un excellent accueil de la critique. Il est couronné du "Prix de la côte d’amour". Mais Calet qui espérait le Goncourt ou le Renaudot se montre déçu de ce demi-succès.
A la fin du Tout sur le tout, Henri Calet évoque avec émotion le fantôme d’Eugène Dabit, lors d’une promenade qu’il effectue avec son père : « Nous dépassâmes L’Hôtel du Nord, une sorte de square, un bâtiment pour les secours au noyés, le pont tournant ; nous bûmes un verre à La Chope aux Singes ; nous nous accoudâmes un moment au garde-fou de la passerelle en dos-d’âne qui surplombe le canal inutile qui va s’enfoncer dans un trou obscur. Ce n’est pas là-dedans que j’irais me noyer, j’aimerais mieux de l’eau courante qui me roulerait jusqu’à la mer… Nous cherchions une station de métro. Un arc en ciel s’ouvrit soudainement, et l’air, les gens, les choses prirent une teinte de soufre. Mais mon père pensait peut-être aux coups qu’il avait reçu sur les yeux, et moi à un ami qui avait habité L’Hôtel du Nord et qui est mort loin d’ici. »18
Le 17 août, Calet fait la connaissance d’Antoinette Nordmann avec laquelle il engage une liaison violente et passionnée. Il s’installe chez elle, 82 rue Vaneau. A la fin de l’année, il retourne habiter avec Marthe. Durant cette période, il va partager son existence entre ces deux femmes et leurs deux domiciles.
1949. Sous le titre Rêver à la suisse, Henri Calet a réuni les articles qui avaient suscité une polémique de l’autre côté des Alpes, lors de leur publication dans la presse. Précédé d’un petit avertissement pour le lecteur suisse écrit avec un humour décapant par Jean Paulhan, le livre paraît assez discrètement en janvier aux Editions de Flore.
Tout en continuant sa collaboration chaotique à Combat, Calet travaille à la première version de Huit quartiers de roture, consacrée aux XIX° et XX° arrondissements de Paris.
Son divorce avec Marthe est prononcé le 29 juillet.
Le 2 septembre, à cette même clinique Tarnier où Calet était né quelques quarante-cinq années plus tôt, on enregistre la naissance de Louis, François, Paul Nordmann, fils de Antoinette Nordmann et de Henri Calet qui, tout comme le fit son père, ne reconnaît pas son enfant.
En dépit de ses multiples activités, littéraires, journalistiques et radiophoniques, Henri Calet éprouve de graves difficultés pour arriver, selon l’expression qu’il utilisera pour le titre d’un de ses livres, à joindre les deux bouts : outre l’entretien de son fils et d’Antoinette, outre la pension alimentaire versée à Marthe, s’ajoute l’aide financière qu’il apporte à ses parents.
Il écrit à Georges Henein, le 26 octobre : « … Je mène une vie absurde. Il ne me reste pas un instant. La télévision, la radio, les journaux me dévorent à qui mieux mieux… »
1950. Les rapports entre Antoinette Nordmann et Henri Calet se dégradent. A la grande passion succède l’extrême violence…
« Aujourd’hui, trente et un janvier mil neuf cent cinquante, à neuf heures du soir, je vais commencer à parler… », ainsi commence Monsieur Paul que Calet entreprend d’écrire à Cerisy-la-Salle et qu’il achèvera au mois d’août à Paris.
Ce roman, dont le premier titre était Monsieur Louis, rapporte la confession d’un homme plein de larmes à son enfant qui vient de naître. Autofiction qu’il adresse à son propre fils, le petit Louis. Sans cesse bringuebalé entre ses deux femmes, Marthe et Antoinette, Henri Calet tente dans ce livre de mettre à plat son existence et sa vie tumultueuse, de voir plus clair dans son destin, tout en réglant ses comptes.
Henri Calet reçoit le Grand Prix de l’Académie de l’Humour pour L’Italie à la paresseuse, paru en mai chez Gallimard qui, dans la foulée, publie Monsieur Paul, au mois de novembre. La parution de ce "livre-testament" provoque un malaise certain et l’accueil de la critique est mitigé. Certains estiment même qu’il s’agit d’un ouvrage que l’auteur n’aurait jamais dû écrire…
Toujours assailli par les problèmes d’argent, Calet est de plus en plus las. Il a rompu avec Antoinette. Il décide de rompre également avec la littérature et reprend contact avec la Compagnie Générale d’Electro-Céramique.
Le lundi 19 février 1951, mort d’André Gide dans son appartement du 1bis rue Vaneau. Le fidèle Roger Martin du Gard se tient auprès de lui et note : « Tristesse recueillie, plutôt que douleur. Le calme de cette fin est bienfaisant… il faut lui savoir un gré infini d’avoir su mourir aussi bien. »19
Pierre Herbart écrira plus tard dans son ouvrage À la recherche d’André Gide : « Comme il l’avait souhaité, Gide meurt désespéré. Les catholiques sont refaits. »
En janvier, Henri Calet endosse à nouveau la tunique de Raymond Barthelmess pour effectuer un bref séjour comme attaché à la direction des services administratifs de la "Céramique", mais dès le mois d’avril, il est de retour à Paris et reprend ses activités journalistiques au Figaro Littéraire, à Carrefour et à Opéra.
Marthe étant partie vivre aux Etats-Unis, il revient habiter seul dans leur ancien domicile, rue de la Sablière.
Il écrit Les grandes largeurs, publié en novembre, aux Editions Vineta.
Henri Calet est toujours très perturbé par sa vie sentimentale et ses problèmes d’argent. Au début de l’année 1952, il signe un accord financier avec Gaston Gallimard pour l’écriture d’un roman. Ce sera Un grand voyage, un livre largement autobiographique racontant sa vie d’aventure en Amérique latine.
A la radio, Henri Calet présente avec Jacques-Charles une série de "portraits biographiques" sur des personnalités artistiques du siècle dernier ou de la "Belle Epoque" : Hortense Schneider, Max Dearly, les frères Isola… Pour le "Programme Parisien", il écrit une adaptation radiophonique de Huit quartiers de roture.
Un grand voyage est publié en octobre.
Claude Bellanger commande à Henri Calet une série de reportages sur des gens de conditions modeste vivant à Paris ou dans la proche banlieue. Réunie sous le titre Un sur cinq millions cette galerie de portraits hauts en couleurs paraît dans Le Parisien Libéré de mai à juin.
Lors d’une "décade" sur le roman à Cerisy-la-Salle, Calet fait la connaissance de Christiane Martin du Gard qui devient sa nouvelle compagne. Une grande histoire d’amour commence. Durant l’été, le couple effectue un long et heureux voyage en voiture à travers la France.
Le 3 octobre 1953, alors qu’il dicte un article dans les locaux du journal Marie-Claire, Henri Calet est victime d’une première crise cardiaque. Il doit se ménager. Il lui est désormais interdit de fumer et de boire de l’alcool.
Outre ses graves ennuis de santé, de gros problèmes personnels accablent Calet. Ses relations avec Antoinette qui a très mal vécu la publication de Monsieur Paul, sont de plus en plus tendues et difficiles. Après une absence de deux ans, Marthe est revenue des Etats-Unis avec l’espoir non dissimulé de renouer avec son ancien mari. Enfin, l’état de santé de sa mère, immobilisée dans son logement depuis plusieurs années, s’est aggravé. Hospitalisée à Beaujon, Anne disparaît le 20 décembre. La série noire continue, quinze jours plus tard, heurté par un camion, son père est sérieusement blessé.
1954 Henri Calet a très mal vécu la disparition de sa mère.
A la fin du mois de janvier, Marthe est retournée aux Etats-Unis, sans espoir de retour.
Réunie sous le titre Les deux bouts, la série de reportages publiée l’année précédente dans Le Parisien Libéré paraît en mars chez Gallimard, dans la collection "L’Air du Temps", dirigée par Pierre Lazareff. Cet ouvrage remarquable, qui n’a curieusement jamais été réédité, vaut à son auteur un certain nombre de voix pour le Prix Albert-Londres.
Le tant attendu Luis-Eduardo Pombo, de passage en Europe s’en retourne en Amérique du Sud à la fin de ce même mois de mars, sans que Calet ait été en mesure de lui servir de guide pour lui faire découvrir Paris, comme il l’avait si souvent espéré.
Une nouvelle attaque cardiaque, survenue le 27 mai, n’interrompt pas pour autant l’activité radiophonique de Henri Calet qui continue à enregistrer ses chroniques quotidiennes dans l’émission "Rendez-vous à cinq heures".
Il passe un été éprouvant dans le sud de la France. Il passe une partie de ses vacances à Bidart, auprès de son fils Louis et d’Antoinette Nordmann, et l’autre à Cabris, avec Christiane Martin du Gard.
De retour à Paris, Calet habite avec la jeune femme dans un des appartements de l’hôtel particulier de la rue du Dragon appartenant à son père. Les rapports sont tendus. François Nourissier se souvient : « On croisait le grand homme, bougon et lourd dans l’escalier. Il me semble qu’il saluait courtoisement Calet, mais pas sa fille, à qui à ce moment-là il ne parlait pas : il lui en voulait de son divorce ; affaire complexe, aux forts parfums de N.R.F… »20
Les Editions de Minuit avaient déjà refusé de publier Contre l’oubli que Gallimard rejette à son tour.
En dépit de son état de santé, en ce début d’automne, Henri Calet parcourt la capitale à la poursuite de jeunes filles et de jeunes garçons, représentatifs de l’époque : pour le compte du magazine Elle il réalise une enquête sur la jeunesse et ce travail d’archéologue l’amène à se considérer comme un dinosaure… En 2003, le Dilletante éditera avec bonheur cette série de reportages sous le titre Jeunesse.
En novembre, Le Nouveau Femina commande à Calet un reportage sur ce qu’il est convenu d’appeler "les femmes du monde" : « Lorsque j’ai entrepris de faire cette enquête (quel vilain mot !) sur le grand monde, je venais à peine d’en achever une autre sur, disons, le petit monde. Petit qualitativement, bien entendu, et non point par la quantité…Voilà que j’allais pénétrer en pays étranger. Après le petit monde, le grand. Je devais me préparer à une campagne difficile … »21
Sous le titre Les deux bouts dorés, Henri Calet entreprend, début février, de réunir les textes parus dans Le Nouveau Femina. L’ouvrage est tour à tour refusé par Gallimard, Plon, Le Seuil et Julliard. Rebaptisé Le Croquant indiscret, il ne sortira chez Grasset qu’en novembre 1955.
Il continue ses activités à la radio et effectue divers reportages pour Elle et Le Figaro Littéraire.
Durant l’été, profitant d’un reportage qu’il effectue sur l’île de Noirmoutier, Calet passe quelques jours avec Antoinette et le petit Paul. En septembre, très fatigué, il va se reposer à Vence. Christiane Martin du Gard l’accompagne.
Il rentre à Paris et s’engage par contrat à remettre en mars 1956 aux Editions Grasset le manuscrit d’un livre intitulé Paris à la maraude.
1956, Henri Calet abandonne son projet d’écriture sur Paris à la maraude, Gallimard ayant accepté de lui verser des mensualités pour Peau d’ours, un roman à venir.
Mais ce roman ne sera jamais écrit dans sa totalité, car le 11 février, une nouvelle crise cardiaque, plus sérieuse encore que les précédentes, interdit à Calet la moindre activité. Après de longues semaines de repos, les médecins l’autorisent à quitter la capitale. Début avril, il retourne à Vence avec Christiane. Il ne bénéficie que de trois mois de sursis…
« Vous ne serez pas près d’en avoir fini avec Calet » ainsi s’achève la préface de Contre l’oubli qui doit sortir chez Grasset en octobre. En écrivant ces lignes prémonitoires, Pascal Pia ne sait pas encore qu’il devra bientôt prolonger son texte de quelques pages, quelques pages qu’il aurait préféré ne pas avoir à rédiger.
Henri Calet reçoit la lettre de son ami le vendredi 13 juillet. Christiane Martin du Gard se tient à ses côtés : « Il était assis dehors, sous le figuier d’une petite terrasse. Il vous lisait et son visage s’éclairait… » écrira-t-elle par la suite à Pascal Pia.
*
« C’est sur la peau de mon cœur que l’on trouverait des rides.
Je suis déjà un peu parti, absent.
Faites comme si je n’étais pas là.
Ma voix ne porte plus très loin.
Mourir sans savoir ce qu’est la mort, ni la vie.
Il faut se quitter déjà ?
Ne me secouez pas. Je suis plein de larmes. »22
*
« Il faisait beau à Vence ce jour-là. On avait déjà dû pavoiser la mairie. Des bals publics se préparaient sans doute. Calet souriait peut-être à l’idée de ces spectacles populaires, que je l’ai si souvent entendu évoquer avec une sympathie amusée…Quelques heures plus tard, une nouvelle crise cardiaque l’emportait. Il était au lit lorsqu’il s’est mis à râler. La mort s’est saisie de lui à l’aube d’un jour de fête : le 14 juillet 1956 … »23
Notes
1 - Maurice Nadeau
2 - Pascal Pia, préface de Contre l’oubli
3 - K.J. Huysmans
4 - Henri Calet - Le tout sur le tout
5 - Henri Calet - Le tout sur le tout
6 - Chanson de café-concert dont Henri Calet se souviendra dans Le tout sur le tout en évoquant son enfance
7 - André Derain in La grande revue
8 - Henri Calet - Le tout sur le tout
9 - Henri Calet - Le tout sur le tout
10 - Henri Calet - Le tout sur le tout
11 - Henri Calet - La belle lurette
12 - Henri Calet - La belle lurette
13 - Henri Calet - Un très vieux client in Acteur et témoin
14 - Ibidem
15 - Henri Calet - Lettre à Luis-Eduardo Pombo, recueillie par Jean-Pierre Baril in Les Episodes (avril 2002)
16 - Henri Calet - Lettre à Luis-Eduardo Pombo, recueillie par Jean-Pierre Baril in Les Episodes (avril 2002)
17 - Pascal Pia - Préface de Contre l’oubli
18 - Henri Calet - Le tout sur le tout
19 - Roger Martin du Gard - Notes sur André Gide
20 - François Nourissier in Europe (novembre/décembre 2002)
21 - Henri Calet - Le croquant indiscret
22 - Henri Calet -Peau d’Ours
23 - Pascal Pia - Préface de Contre l’oubli
Instantanés
Ce soir, venant de mon quinzième, je traverse le pont Mirabeau à la rencontre d’un témoin, d’un être ayant eu le privilège d’avoir connu Henri Calet.
Le fait qu’il ait disparu une dizaine d’années après Emmanuel Bove et plus longtemps encore qu’Eugène Dabit, m’offrait plus de chance de trouver quelqu’un qui aurait pu croiser sa route.
Mon rendez-vous se situait de l’autre côté du pont, et j’allais défiant le temps, en fredonnant la musique dont Léo Ferré avait habillé les strophes d’Apollinaire :
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l’onde si lasse…
C’est Roger Grenier qui, avec un petit sourire, m’avait négligemment conseillé de téléphoner de sa part à Claudie Planet. J’obtempérai et après avoir obtenu un rendez-vous, me préparai à aller retrouver cette dame, la sœur d’Antoinette Nordmann, mère de Monsieur Paul, enfin du petit Louis, l’unique enfant d’Henri.
Lors de notre premier contact téléphonique, elle a eu peur de me décevoir, de ne m’apprendre que ce que je sais déjà. Se doute-t-elle que le seul fait de croiser son regard, celui-là même qui a autrefois rencontré celui de Calet est pour moi un moment privilégié… J’ai toujours eu un goût particulier pour les traces que l’on peut laisser sur les autres. Je suis tout à fait capable de me pâmer devant un ticket de métro qu’Henri Calet aurait tendu, dans les années cinquante, à une poinçonneuse à la station "Alésia".
Claudie Planet me reçoit dans son salon aux murs tapissés de livres et tout de suite, c’est elle qui me questionne. Je lui parle de notre projet… Un ouvrage où l’on retrouverait Henri Calet, bien sûr, mais également deux autres personnages, Eugène Dabit et Emmanuel Bove, ces presque oubliés de la littérature du siècle passé …
Au moment même où un glaçon tinte dans le verre de whisky qu’elle vient me servir, une décharge d’adrénaline traverse mon échine, lorsque le plus naturellement du monde, elle m’interrompt et murmure : « Emmanuel Bove… je l’ai croisé en 1941 à Lyon… C’était dans un hôtel de passe… enfin de passage… Il y avait beaucoup de passages à cette époque… »
J’étais venu chercher un témoignage sur l’un de Nos Amis, et sur un plateau, cette dame adorable m’en offrait un second en prime… Ce qui la surprend, elle, c’est ma stupeur et mon émotion. Elle continue son récit : « Notre famille s’était réfugiée à Lyon pendant l’Occupation… Je n’avais que quinze ans… L’endroit où nous logions s’appelait L’Hôtel des Artistes et avait très mauvaise réputation dans le quartier …Il y avait d’étranges allées et venues dans les escaliers. Tout comme nous, Bove avait échoué là avec son épouse. Je me souviens bien de lui. Il avait un visage rond et pâle, triste aussi. Il dégageait une impression de grande tristesse… Sa femme était volubile et passablement envahissante… Bove, on ne le remarquait vraiment qu’après avoir cessé d’être intrigué par les exubérances de sa compagne. Je le vois encore avec son long manteau beige, silencieux, comme affligé… Il n’est pas resté très longtemps à Lyon. Je l’ai croisé quelquefois dans les couloirs de l’hôtel, puis le couple a disparu, poursuivant sa route jusqu’à Alger. »
En écoutant Claudie Planet, émerge dans mon esprit un cliché, un de ceux que l’on ne trouvera jamais ni dans les papiers de l’écrivain, ni dans les pages de sa biographie.
Plus tard en traversant dans l’autre sens le pont Mirabeau, je la contemplerai avec attention cette photo, jamais saisie, d’un Emmanuel au bout du rouleau… au bout de son courage… au bout de tout… dans cet hôtel de passe ou de passages, un hôtel parmi tant d’autres, semblable à tous ceux qu’il a décrit dans Mes Amis, dans La Coalition, dans bon nombre de ses romans… un hôtel "bovien". J’aime utiliser cet adjectif lorsque je découvre dans une rue du quatorzième ou du quinzième, un de ces "deux étoiles" derrière les murs desquels des chambres se devinent, se sentent… et où se devinent aussi les solitudes qui les occupent.
L’image de Calet est plus nette dans la mémoire de Claudie Planet : Un homme distingué, un homme qui intimidait et inspirait le respect. Il était tel qu’on le voit sur les photographies publiées ici et là. Elle l’avait rencontré après lui avoir adressé une lettre, lors de la sortie du Bouquet, "un petit mot insignifiant dans lequel je lui faisais part de mon admiration", dit-elle, un petit mot conservé dans les archives de l’écrivain à la Bibliothèque Jacques Doucet. Plus tard, elle lui présenta Antoinette, sa sœur et la suite de l’histoire nous la connaissons à travers ce livre terrible qu’est Monsieur Paul. Ce roman n’est pas terrible pour nous simples lecteurs, mais pour les personnages décrits, croqués, dévoilés par Henri Calet… Un auteur ne peut écrire que s’il se moque des réactions de ceux qui pourraient se reconnaître à travers ses personnages s’il ne veut pas prendre le risque de s’infliger une intolérable autocensure. Mais avant tout, on ne raconte bien que soi-même et Henri Calet le sait, Henri Calet se raconte… ne sait que se raconter.
Si Claudie Planet a souffert du portrait que Calet avait tracé d’elle dans Monsieur Paul, aujourd’hui elle s’en amuse. « Il m’avait vieillie de quelque douze années et m’avait donné l’aspect d’un estomac… »
Après un deuxième whisky, nous tournons toujours autour d’Henri Calet, de sa sœur Antoinette qui incontestablement l’avait beaucoup aimé, allant jusqu’à haïr de toutes ses forces sa remplaçante, Christiane Martin du Gard, qui lui arrachait son amant, celui avec lequel elle s’était appliquée à faire un enfant. Partagé entre ces deux femmes obstinées, s’acharnant à conserver ce qu’elles pensent être leur bien propre, Henri Calet est une nouvelle fois semblable à cette coupe de larmes prête à déborder.
L’enfant, le petit Louis, il l’aimait… Jusqu’à sa mort, il viendra souvent le chercher quelques heures le temps d’une promenade. Claudie Planet se souvient d’une de ces visites. Il était arrivé, essoufflé d’avoir grimpé les escaliers d’un de ces immeubles du quartier des Ternes, ce même quartier où Bove était mort quelques années auparavant, le premier quatorze juillet d’après la Libération. Calet, déjà très malade, attendait sans le savoir cet autre jour de fête nationale à l’aube duquel il allait également mourir… À chacun son quatorze juillet !
Après avoir hésité, je ne peux résister et demande à mon hôtesse si elle possède des photos. Elle marque un temps, puis disparaît au fond de l’appartement. En l’attendant je consulte les titres des ouvrages qui garnissent les murs transformés en bibliothèque. Peut-être y-a-t-il, cachées là, des pièces rares de Calet, de celles qu’il m’arrive de chercher en vain chez les bouquinistes des quais ou ceux du parc Georges-Brassens.
Elle revient avec deux photos qu’elle ne me confie pas. Elle se contente de me les montrer en les tenant bien serrées entre ses doigts. La première est un beau portrait classique du Calet que l’on connaît. Sur la seconde, un cliché saisi au vol par un de ces photographes ambulants comme il y en existait à l’époque, le même Calet rigide, le visage fermé derrière ses lunettes, un foulard sombre recouvrant sa gorge peut-être souffrante, tient par la main un enfant, son enfant. Le petit Louis a la tête baissée, on n’aperçoit de lui qu’une touffe de cheveux noirs et son petit corps vêtu d’un chandail et d’un short. Ils ont l’air tous les deux de se traîner, dans une des rues de ce quartier, par nécessité, parce qu’ils ne peuvent pas se retrouver ailleurs. Sans doute Henri emmènera-t-il ensuite le gamin manger une glace dans une brasserie de la place des Ternes ou jouer dans un bac à sable du Parc Monceau. J’ai souvent rencontré, le dimanche, ce genre de couple – père, fils – scellés l’un à l’autre, maladroits, tout empotés dans un amour qu’ils ne savent pas encore montrer. J’ignore si cette impression était due à l’instant choisi par le photographe pour les immortaliser, mais Monsieur Paul et son père ne semblaient pas très heureux ce jour-là. Peut-être l’enfant avait-il fait un caprice quelques minutes auparavant, peut-être le père était-il déjà trop malade pour s’intéresser réellement à cette petite chose qui, comme tous les enfants du monde, désirait qu’on l’aime tout simplement.
Sur le Pont Mirabeau, là où coule toujours la Seine, je baladais dans ma mémoire l’image d’Emmanuel Bove dans cet Hôtel des Artistes, avec son visage blafard et triste, et celle de cet homme droit dans son long manteau gris, les traits du visage tendus, cet homme marchant dans une rue du quartier des Ternes en tenant par la main un enfant qui ne cherche pas à se serrer tout contre son père.
BIBLIOGRAPHIE
HENRI CALET
* LA BELLE LURETTE - roman - 1935 (Gallimard)
Réédition 1979 ( L’Imaginaire)
* LE MERINOS - roman - 1937 (Gallimard)
Réédition 1996 (Le Dilettante)
* FIEVRE DES POLDERS - roman - 1939 (Gallimard)
Réédition 1997 (Le Passeur)
* LE BOUQUET - roman - 1945 (Gallimard)
Réédition 2001 (L’Imaginaire)
* LES MURS DE FRESNES - reportage - 1945 (Editions Les Quatre Vents)
Réédition 1993 (Viviane Hamy)
* TRENTE A QUARANTE - nouvelles - 1947 (Editions de Minuit)
Réédition 1991 (Mercure de France)
* REVER A LA SUISSE - récit - 1948 (Editions de Flore)
Réédition 1984 (Pierre Horay)
* LE TOUT SUR LE TOUT - roman - 1948 (Gallimard)
Réédition 1980 ( L’Imaginaire)
* L’ ITALIE A LA PARESSEUSE - récit - 1950 (Gallimard)
Réédition 1990 et 2009 (Le Dilettante)
* MONSIEUR PAUL - roman - 1950 (Gallimard)
Réédition 1996 ( L’Imaginaire)
* LES GRANDES LARGEURS - récit - 1951 (Gallimard)
Rééditions 1984-1999 (L’Imaginaire)
* UN GRAND VOYAGE - roman - 1952 (Gallimard)
Réédition 1994 (Le Dilettante)
* LES DEUX BOUTS - reportages - Collection « L’air du temps » - 1954 (Gallimard)
* LE CROQUANT INDISCRET - reportages - 1955 (Grasset)
Réédition 1992 (Cahiers Rouges)
* CONTRE L’OUBLI - récits - Préface de Pascal Pia - 1956 (Grasset)
Réédition 1992 (Cahiers Rouges)
* PEAU D’OURS - notes pour un roman - 1958 (Gallimard)
Réédition 1985 (L’Imaginaire)
* ACTEUR ET TEMOIN - récits - 1959 (Mercure de France)
* CINQ SORTIES DE PARIS - récits - 1989 (Le Tout sur le Tout)
* UN SIECLE POUR LA CERAMIQUE - textes et documents inédits choisis par J.P. Baril – 1996 (Autodidactes)
* DE MA LUCARNE - Les inédits de Doucet - notes de Michel P. Schmitt - 2000 (Gallimard)
* POUSSIERES DE LA ROUTE - textes - seconde version annotée par J.P.Baril – 2002 (Le Dilettante)
* JEUNESSES - enquêtes - notes de Jean-Pierre Baril - 2003 (Le Dilettante)
SUR HENRI CALET
* Revue "LES GRANDES LARGEURS" 1981 - in n° 2/3 lettres de Georges Henein à Henri Calet (1936/1956)
* Pierre CHARRAS : MONSIEUR HENRI - roman - 1994 (Mercure de France)
* Revue "LES EPISODES" 2002 - n°13 (Jean-Pierre Baril : Henri Calet, reflets d’une année terrible - Lettres de
Henri Calet à L-E Pombo)
* Revue "EUROPE" 2002 - n° 883/884 - HENRI CALET (textes de Michel P.Schmitt, François Nourrissier,
Pierre Pachet, Alain Dugrand, Paul Fournel, Jacques Chessex, Jean-Noël Blanc, Gilles Quinsat, Pierre Vilar,
Philippe Wahl, Marc Dambre, Bruno Curatolo, Marc Kober, Jean-Pierre Baril et Mireille Hermet)
* Revue "THEODORE BALMORAL" 2002/2003 - n° 42/43 - "à Raymond Théodore BARTHELMESS"
* Henri Calet – Pièces et nouvelles radiophoniques - Textes de Jean-Pierre Baril, Antoine Blondin, S. Dhomme
* Montevideo, Henri Calet et moi - Christophe Fourvel - La Dragonne 2006
|
|
|
Retour
sommaire
Pour mémoire

Henri Calet


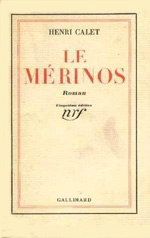
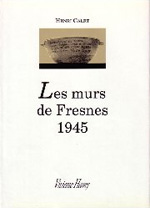
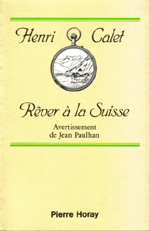







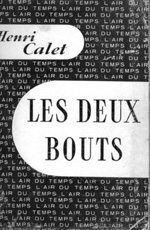
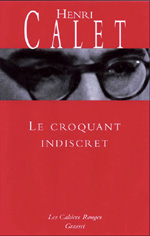








Version anglaise de
Monsieur Paul
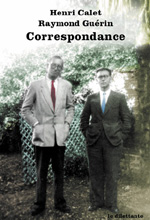
Mise en ligne :
Août 2010
|
|