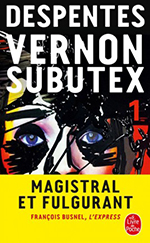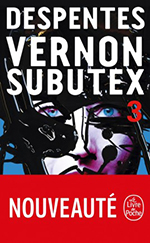Vernon Subutex
Sociologie pratique pour fin de siècle déglinguée
Devant moi, j’avais interposé toutes les raisons de ne pas lire Despentes. Elles étaient bien en place : la couverture choisie par l’éditeur, par trop racoleuse ; les titres, tellement crus, Baise-moi, Les Chiennes savantes ; je m’autorisais aussi de quelques paragraphes glanés ici ou là sur des tables de librairie pour décréter que cette plume était négligée… jusqu’au soir où, chez des gens, sans plus aucun goût pour les livres emportés, je farfouille dans un grenier pour tomber sur « Vernon Subutex »1. C’était décidé, j’en lirai quelques paragraphes de plus, peut-être même deux pages entières, et la messe serait dite… les deux pages se sont transformées en un premier volume… à peine achevé celui-ci, un deuxième était déjà à moitié englouti…
La dégringolade sociale d’un disquaire de rock. Dès la première page, nous plongeons dans la débâcle de Vernon, notre anti-héros quinquagénaire. Il vient de mettre la clé sous la porte de Revolver, son magasin de disques de rock dans le nord parisien. D’abord radié de son abonnement de mobile, il est bientôt expulsé de son logement. À l’heure du streaming, les offres d’emploi pour ce disquaire sont « plus rares que s’il avait travaillé dans l’extraction du charbon ».
Pendant les années 80, Vernon a été la référence musicale d’un groupe de punk-rock qui s’est délité. Au hasard des pérégrinations de Vernon en vue d’un canapé pour la nuit, on croise les visages des anciens punk-rockers. Alex Beach, l’un d’eux, a été propulsé au rang de rock-star. Jusqu’à sa mort d’une overdose dans une baignoire, c’est lui qui maintenait Vernon la tête hors de l’eau. Alex a laissé chez ce dernier une confession dans une cassette. Vernon perd ce document. La nouvelle s’ébruite et la cassette devient l’objet d’une recherche fébrile, fil ténu qui nous transporte parmi les membres de l’ancien groupe.
Une sociologie des années 90. L’intrigue est passablement lâche, mais là n’est pas l’important. On se fout de l’intrigue. Ce n’est qu’un prétexte pour un parcours haletant au pays des laissés-pour-compte d’un système où l’inégalité va croissant, auxquels s’adjoignent ceux qui certes sont intégrés, mais dont la dérive morale n’est pas moindre. À l’image de Vernon, la génération punk-rock est donc jetée à la rue par le capitalisme mondialisé, ou bien contrainte de vendre son âme. C’est le cas de Pamela Kant, ex-star du porno ; de Kiko, le trader qui tient ouvert son luxueux appartement pour de folles soirées rythmées par des lignes de cocaïne ; ou encore de Xavier, scénariste raté qui tisonne ses rêves calcinés ; et aussi de La Hyène, qui fait profession du lynchage cybernétique et « pourrit, à la demande, tel artiste, tel projet de loi… tel groupe électro » sur les réseaux sociaux ; sans oublier Olga, la SDF grande et costaude, qui initie Vernon à la « survie urbaine » et met en déroute des militants identitaires… celle-ci pourrait d’ailleurs bien être une manière d’autoportrait de l’auteure.
C’est par tableaux juxtaposés que la narratrice nous brosse la fresque d’une société déglinguée, ce qui vaut bien une sociologie appliquée des années 90. Nombre de ces petites peintures sont saisissantes. Ici, une femme très court-vêtue remonte le boulevard Richard-Lenoir un samedi soir, raide, ne cillant pas, prenant bien garde de ne pas dévier le regard une fraction de seconde, pour éviter tout prétexte à un dangereux accostage. Là, Xavier, assommé de routine conjugale, retrouve la griserie des discussions au bar ; cet « ancien mauvais garçon devenu grand bavard, ressemble à un enfant qui moulinerait du sabre dans l’espoir de dissuader les mauvaises idées de s’approcher ». Plus loin, en quelques pages qui serrent le ventre, c’est la descente de Cécile dans l’enfer des coups de Patrice, son conjoint. Et comme cela paraît vu de l’intérieur ! De même que ce retour de Vernon, quittant la rue pour revenir au monde des vivants, parmi les anciens du groupe ! Ahuri, pressé de questions, il perd la parole, et se laisse mettre sous la douche par La Hyène, tellement il pue.
Ce rapport sur la laideur des humains, comme du monde contemporain, parsemé de références à la musique punk-rock, est établi avec une distance caustique qui, à chaque page, en fait surgir un effet comique. Tout cela est lesté de vécu : nul doute que les galères de jeunesse de l’auteure ont ici trouvé leurs tréteaux pour la représentation.
Une écriture faussement désinvolte. Délibérément à l’emporte-pièce, le récit, où fleurissent les lieux communs2, héberge une oralité décapante. C’est brutal, c’est grossier. On ne compte plus les formules-choc telles que « des anorexiques suceuses de bites ». Et certaines tirades racistes gueulées par certains personnages sont à peine soutenables. Bien des phrases secouent le lecteur : « Sa mémoire était un compost, tout s’était mélangé là-dedans, en se putréfiant ». De longues énumérations défilent, sans ponctuation aucune, sous la poussée d’un ressentiment longtemps réfréné. Après une ou deux tournures lénifiantes, des paragraphes frappent comme un uppercut : « Dans un premier temps, (la vie) t’endort en te faisant croire que tu gères, et sur la deuxième partie, quand elle te voit détendu et désarmé, elle repasse les plats et te défonce ».
Des références littéraires courantes sont convoquées, mais de façon personnelle. Le vers de Baudelaire, « Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle » est suggéré. Mais ne comptons pas sur la narratrice pour nous ciseler un alexandrin alternatif. C’est à la va-vite qu’elle jette l’allusion, en nous servant à la suite l’image d’un Vernon qui aurait plaqué, comme avec un ruban adhésif, une frange de ciel bleu au ras des toits, rehaussant leur éclat gris… Leonard Cohen aurait enchaîné : « There is a crack in everything, that’s how the light gets in »3, c’est d’ailleurs le vers placé en exergue du deuxième volume.
Ce tableau oppressant sait ménager des intermèdes égayants, comme ce retour de courses, où poireaux et papier hygiénique « en pack de douze rouleaux » dépassent du cabas d’Emilie, au moment d’affronter Pamela, bien plus jeune… et tellement jolie qu’Emilie voudrait la voir disparaître « d’une combustion spontanée ».
Entre Céline et la « hard-boiled fiction » ? L’animosité envers la domination machiste bouillonne sans relâche. Cependant, comme à contre-emploi, on voit aussi émerger une défense des hommes, qui se font « choper par les couilles, à tout bout de champ », pour la pension alimentaire, entre autres ; « La masculinité, c’est bande et raque, sans alternative ». Dans cet environnement de sexe-marchandise, de lâcheté, de drogue et d’alcool, il faut bien chercher pour trouver un rayon de soleil. Peut-être, toutefois, dans une forme de solidarité entre les personnages…
Point n’est besoin de comparer Despentes à Balzac, pour lui trouver des qualités. Interrogeons-nous plutôt sur le type d’écrit que nous propose « Vernon Subutex ». Vernon, le personnage principal, incarne une déchéance sociale. Incarne ? toute la question est là : a-t-il une véritable épaisseur ? On ne sait pas grand-chose de lui. On ne voit guère sa famille, son origine est floue et il se laisse ballotter au gré des circonstances. En matière de personnages, c’est un éventail de portraits-types qui se déploient sous nos yeux. Le style parlé, argotique, de la narration évoque Louis-Ferdinand Céline, certainement, et aussi Charles Bukowski, référence revendiquée de l’auteure, mais les dimensions de la trilogie, son côté page turner font également penser à la « Hard-boiled fiction » américaine selon James M. Cain4 ou au feuilleton policier français de l’après-guerre5.
Au risque de faire se retourner dans leur tombe Gérard Genette et Roland Barthes, nos deux papes de la critique moderne, prônant la totale dissociation entre l’œuvre et l’auteur, on ne peut s’empêcher de chercher les rapports entre ce roman et la jeunesse tumultueuse de son auteure. Renvoyée du collège pour ses bagarres avec les garçons, très tôt fugueuse, puis squatteuse, alcoolique, chef de bande, sans parler d’autres aspects bien connus de sa biographie, la présence de Despentes, avec sa colère tous azimuts, imprègne chacune des pages de cette trilogie, qui n’a rien d’un roman autobiograhique, mais constitue plutôt le réceptacle d’une subjectivité écorchée, toutes griffes dehors contre le mâle blanc, qui pourrait être Kiko, le trader cocaïnomane. « Vernon Subutex » connaît sans doute ses limites et ses excès, mais ce n’est pas le moindre des mérites de Despentes que d’avoir su tremper sa plume dans cette rage viscérale pour une mise en scène où plusieurs générations retrouvent de larges pans du milieu urbain dans lequel ils ont grandi.
Dominique Perrut
(06/09/21)
Visiter le site de Dominique Perrut : www.dominique-perrut.org/fr/
1 Virginie Despentes, Vernon Subutex, trilogie, Grasset, 2015-2017.
2 Pierre Pachet, La Nouvelle quinzaine littéraire.
3 Leonard Cohen, Anthem. « Il y a une fêlure à chaque chose, c’est ainsi que la lumière peut entrer ».
4 James M. Cain, Mildred Pierce, par exemple, A.A. Knopf, 1941.
5 On peut évoquer ici André Héléna.