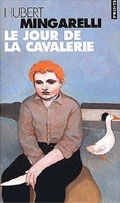|
|
Hubert MINGARELLI
Marcher sur la rivière
Absalon nous raconte son histoire. C'est un garçon simple, gentil mais solitaire, complexé par une jambe raide qui, si elle ne le fait pas vraiment souffrir, handicape sa démarche et le rend ridicule. Une infirmité qui fait de lui un être vulnérable, différent, exposé à la moquerie ou à la pitié. Certains en concluent même qu'il n'a pas toute sa tête. « Dans ma tête il n'y a rien qui cloche, c'est ma jambe qui refuse de plier, mais au dispensaire ils pensent le contraire, mais dites-moi Emmeth, s'ils sont dans ma tête au dispensaire ? Non, ils n'y sont pas, personne est dans la tête de personne, autrement ça nous rendrait fou. Moi je suis dans ma tête et je sais que c'est ma jambe qui refuse de plier. Je ne suis pas rentré dans votre tête pour vous dire de repeindre vos pompes en rouge. Vous les avez regardées et vous vous êtes dit : tiens en rouge ce sera plus joli et plus propre. Vous avez eu besoin de personne. Alors, pourquoi au dispensaire ils en savent plus que moi sur ma tête, hein ? Je suis en colère, j'aurais du foutre le feu au dispensaire avant de partir, ils n'auraient plus d'endroit où faire du mal aux gens. J'aurais du foutre le feu à tellement d'endroits qu'il n'y aurait plus que votre maison et vos pompes à essence qui seraient debout. »
Sa mère est morte quand il était encore tout jeune condamnant son père à la culpabilité, au désespoir et au mutisme. Entre eux, pas de mots, que des soupirs dans le sommeil. Depuis que, par besoin, il a vendu sa moto mythique, seule source de joie qu'ils partageaient tous deux, il déraille et passe ses jours à aplatir des boîtes de conserves vides qu'il récupère pour en faire des tuiles et en couvrir son toit.
Dans la vie de cet enfant mal grandi et livré à lui-même il y a aussi Rosanna, une fille bizarre et imprévisible qui vend ses charmes dans le billard du coin. Il lui rend de menus services et ensemble, selon les moments, ils rient ou se disputent. « Je n'avais plus rien à dire et j'étais fatigué. (...) Au bout d'un moment je l'ai entendue sangloter, mais pas très fort. (...) Je me taisais et j'écoutais Rosanna sangloter pas plus fort que ça et, c'est étrange, ses sanglots me consolaient. J'avais fermé les yeux, je l'écoutais et je me demandais pourquoi et à quel moment on sait qu'on aime les gens. » Elle parle souvent de départ et lui, secrètement amoureux, rêve parfois de l'accompagner dans sa fuite.
Mais son véritable ami, c'est Emmeth, le propriétaire de la station essence. Absalon sait bien écouter et le vieil homme l'accueille souvent pour des soirées poulet-bière où le pompiste peut se raconter et même pleurer parfois. L' univers affectif du narrateur se borne donc à ces trois exclus de la vie, son père, Rosanna, Emmeth, dans un concentré d'humanité où chacun cultive ses rêves pour survivre. « Chacun s'invente une façon de comprendre. Moi je regarde par la fenêtre, comme si les mystères habitaient dehors. Je regarde longtemps, sans rien fixer de précis, mais au bout d'un moment, je renonce à chercher. Alors je prends conscience de ce que mes yeux voient vraiment. »
En dehors de ceux-là, seuls l'épicier chez qui il s'approvisionne et un étrange pasteur dont la femme aux charmes épanouis éveille les désirs du jeune homme, croisent parfois son chemin.
L'adolescent navigue à vue entre la femme du pasteur et la putain sans que son désir, resté celui d'un enfant, ne lui permette de s'ancrer dans son existence. Il pressent le danger qu’il y aurait à s'effacer dans le quotidien et à rester vivre ici entre ces collines qui bornent l’horizon, du garage à la conserverie ou à l'entrepôt près de la voie ferrée mais il est tiraillé entre son rêve d'un ailleurs indéfini où il pourrait aller voir la mer et peut-être soigner sa jambe et sa culpabilité à abandonner ceux qu'il aime et qui ont besoin de lui.
Sa première tentative de départ échoue, car sur son chemin, il croise Georges Msimangu, un marginal installé à l'écart de l'agitation du monde dans un camion aux essieux posés sur des cales en bois. « De loin sans chercher à comprendre et en ne se fiant qu'aux apparences, on aurait dit que je faisais demi-tour. Que j'avais laissé tomber ma jambe et m'étais résigné à marcher toute ma vie comme un demeuré. Alors que non, je partais toujours pour Port Elisabeth, j'avais toujours l'intention d'y aller afin de m'occuper de ma jambe. Seulement je m'y prenais autrement. La lune se levait devant moi, et je pensais aux choses de l'avenir avec un enthousiasme vaste comme la nuit au-dessus des collines. » Ce colosse passe ses journées à creuser un grand trou près de la rivière depuis longtemps asséchée. Tous en ont entendu parler mais aucun ne se souvient avoir jamais vu l’eau couler dans le lit de ce cours d’eau qu’ils imaginent au creux des collines. « Son existence, on la tenait de gens qui étaient morts maintenant depuis longtemps. Peut-être qu’ils avaient menti. C’était tellement sec là-bas qu’il fallait avoir une grande confiance pour le croire. Il n’y avait pas de différence entre la couleur des collines et ce qui aurait dû être le lit de la rivière. » Le vieux fou embauche sur-le-champ le visiteur pour lui ramener sur place le matériel et les courses nécessaires à son installation et à sa survie.
Dans ce microcosme suspendu au temps, à la sécheresse, au vent, seul Absalon, que sa jambe rebelle condamnerait plutôt à l'immobilité, et les voitures sur la route semblent en mouvement. Marcher, marcher encore, chargé comme un baudet, malgré la fatigue, la douleur, la poussière, empocher son salaire puis repartir et revenir encore pour gagner de quoi quitter la petite cité ouvrière. Absalon fort de ses espoirs ne lésine pas sur l'effort pour se payer un ticket pour le bus qui le mènera à Port Elisabeth découvrir l'océan qui hante ses rêves et faire soigner cette jambe qu'il caresse, à laquelle il confie ses doutes ou chante des lendemains lumineux. Les jours, les nuits se succèdent, mais qu’importe, un pas après l’autre, un désir après l’autre, Absalon partira pour de vrai.
« J'ai remonté l'allée et j'ai pris un siège au milieu. De l'autre coté de l'allée, sur le siège à ma hauteur, une femme tenait un enfant dans ses bras et lui embrassait l'intérieur du cou. J'ai fermé les yeux, puis je les ai rouverts. Alors accordez-moi le don de revoir mille fois cette femme embrasser le cou de son enfant, pendant que la pluie crépitait sur la tôle du bus. (...) Je me suis allongé sur les sièges à l’arrière. Le bus filait maintenant dans la nuit et je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus. »
Comme d'habitude, l'histoire, ténue, n'est située ni dans le temps ni dans un espace précis mais, au-delà de la psychologie, se concentre sur l’évolution des pensées d’un être qui appartient à cette communauté des anonymes, des exclus, que l’auteur affectionne si particulièrement. Absalon est un personnage hypersensible qui s'inscrit dans la lignée des « Hommes sans mère ». La sienne lui a promis avant de disparaître de l'accompagner et de lui parler toujours à l'oreille. Mais ses appels restent vains et il lui faut se construire seul. On pourrait aussi établir une filiation entre Absalon et le fils d'« Une rivière verte et silencieuse » dans leur relation complexe au père resté seul à la mort de la mère. Comme tant d’autres personnages d’Hubert Mingarelli, malmené par la vie mais farouchement déterminé à survivre avec dignité, le jeune homme ne s’est pas résigné mais fait face et assume humblement, sans rancœur mais non sans espoir, avec amour et obstination, la vie qui s'impose à lui.
On retrouve aussi dans ce livre l’univers très personnel de cet auteur qui, de livre en livre, s'est fait une spécialité de dire magnifiquement les choses infimes, la permanence des éléments, les liens qui unissent la nature et les hommes, le désir de partir, d’aller ailleurs, plus loin, le voyage comme promesse de rédemption.
Une langue parlée basée sur une rare économie de mots qui parvient à nous rendre proches, dans leur universalité, des personnages pourtant singuliers dont l'auteur nous dévoile peu à peu avec bienveillance la vérité intérieure.
Un récit à la première personne qui, avec lenteur, de façon quasi impressionniste, nous dévoile les émotions, la détresse, les espoirs de cet étrange garçon auquel on s'attache. Un vrai plaisir de retrouver cette superbe écriture faite de phrases courtes, dépouillée mais cependant fortement évocatrice et poétique, qui sait "coller" au personnage et donner de l'épaisseur à la vie rude et simple. Là résident peut-être l'humanité, la poésie, la séduction magique qui émanent de tous les romans d’Hubert Mingarelli.
« Tout cela – des riens, morceaux de vie, morceaux de poésie – fait chez Mingarelli une histoire qui emporte, loin, au-delà des vagues à l’âme. Marcher sur la rivière, c’est croire. » (Télérama)
Un magnifique roman à déguster de toute urgence comme tous les autres romans de ce grand auteur incomparable qui tisse son univers à travers ses récits successifs en nous touchant directement au cœur.
Dominique Baillon-Lalande
(04/08/07)
|
|
|
Retour
Sommaire
Lectures

Editions du Seuil
246 pages - 18 €
Vous pouvez lire
sur notre site
un article
concernant
un autre livre
du même auteur :
Le voyage d'Eladio


Hubert Mingarelli
Pluisieurs de ses livres ont paru en Points-Seuil



Prix Médicis 2003


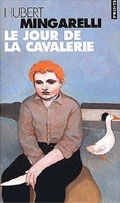
|
|