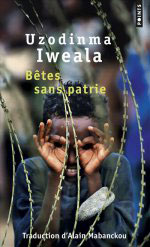|
|
Uzodinma IWEALA
Bêtes sans patrie
L'histoire racontée par Agu, gamin d'une dizaine d'années, se déroule en pleine guerre civile dans une contrée africaine indéterminée qui pourrait être la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone ou ailleurs. Quand les soldats envahissent le village et tuent son père sous ses yeux, sa mère et sa sœur avaient déjà eu la chance de trouver une place dans un camion de l'ONU pour être évacuées. Seul, en plein carnage, il ne lui reste donc plus qu'à fuir, vite, seul, à l'aveuglette. Avant qu'il ne soit pris dans cette tourmente qui fera basculer sa vie entière, il n'était qu'un banal fils d'instituteur, plutôt gentil, heureux dans une famille qui respectait les préceptes de la Bible, aimant l'école, la lecture, partageant ses jeux enfantins avec son ami Dick, rêvant à son futur métier d'ingénieur ou de docteur. Un enfant comme tant d'autres, tout simplement.
Découvert lors du saccage d'un autre village par une faction rebelle, il est contraint pour sauver sa peau de s'enrôler à leur côté comme enfant-soldat.
Agu, ce « minimum d'homme », observateur et malin, s'adapte vite à l'organisation de la milice dans laquelle il a été "accueilli" et comprend rapidement, à ses dépens et à ceux de ceux qui croiseront son chemin, que soldat « ça veut dire… obéir à des gens qui te font faire des choses que tu ne veux pas faire et non pas faire tout ce que tu veux toi-même comme c'est dans les films ». Il admire tout d'abord, pour sa stature et sa force, le « lieutnan » mais déchante vite. La crainte et la haine remplacent la fascination quand il s'aperçoit que celui-ci au premier doute n'hésite pas à tuer ses propres hommes et qu'il pourvoit régulièrement sa couche en jeunes garçons qu'il viole sans état d'âme. Sous les ordres de ce chef terrible appelé « l’homme qui pousse l’ennemi à la folie », il se soumet aux marches forcées, dort à la belle étoile, supporte sans broncher la chaleur suffocante, l'épuisement, la faim, la soif, l'envie de vomir, les piqûres de moustiques.
« Il fait nuit. Il fait jour. La lumière. Le noir. Il fait trop chaud. Il fait trop froid. Il pleut. (...) Tout le temps on combat. Quoiqu'il arrive on combat, on combat. Les balles ne font que tout avaler, les feuilles, les arbres, le sol, les gens – elles les avalent – par conséquence de quoi les gens ils saignent, il ne font que saigner partout partout, il y a une inondation de sang dans toute la brousse. Le sang fait hurler les gens, ils ne font que crier tout le temps, ça crie papa, ça crie maman, ça crie Dieu ou ça crie Diable, ça crie dans une langue que personne ne comprend. (...) et ça arrive que je crie, que je hurle moi-même aussi comme ça je n'entends rien d'autre que ma voix. Mais ça arrive aussi que j'ai envie de pleurer très fort, or personne ne pleure ici. Si je pleure on va me regarder à cause qu'un soldat il ne pleure jamais. »
Lors des massacres, à ses débuts, il n'a pour seule arme qu'un couteau, mais, très vite, il est initié au maniement des armes, goûte au « jus d'arme à feu » donné aux soldats pour les galvaniser et veut, comme les autres, tuer.
« Maintenant que l'arme c'est à moi-même, maintenant qu'elle va partout où moi je l'emmène, elle est là à se reposer tranquillement dans mon dos on dirait c'est une reine et moi son serviteur qui fais n'importe quoi qu'elle me dit »
Alors au cœur de cette guerre à laquelle il ne comprend rien, la violence le rattrape et
il franchit, pour survivre et sans s'en rendre compte, la ligne qui sépare l'humain de l'animal pour rejoindre le clan des bêtes féroces.
Tuer un ennemi « c'est pas dur, on dirait quand on tue une chèvre »
« Je ne suis qu’un soldat, et un soldat c’est pas méchant quand il tue. Je me dis tout ça dans moi-même à cause qu’un soldat doit tuer, tuer encore et encore sans pauser. Si moi je tue c’est que je fais ce que je dois faire. »
Lorsque la peur se fait trop grande, que le présent est insoutenable, Agu ferme les yeux et repense à ses lectures et à son enfance en famille.
« Quand je me souviens que j'ai fait des belles choses bien avant d'être soldat, eh bien, là alors je me sens mieux. D'ailleurs si vraiment j'ai fait toutes ces belles choses avant la guerre et que maintenant je ne fais que mon boulot de soldat, comment même, je peux être un mauvais garçon, moi ? ».
Et puis, heureusement, il y a Shrika, l'autre enfant-soldat du groupe, muet depuis le massacre des siens et hébété par le spectacle des vols, des viols, des tueries qui lui sont infligés au quotidien. Une vraie solidarité les lie et ce complice connaît les gestes apaisants quand, au retour des raids ou des séances de viol dans la maison du commandant, il sent Agu au bord du précipice de la haine et du désespoir.
« Plusieurs fois je me dis dans moi-même je dois fuir, fuir loin, loin là-bas où personne ne va me trouver ou me voir, je vais rester loin là-bas jusqu'à la fin du temps quand Dieu va venir juger les morts et les vivants. Je me dis ça dans moi-même , or quand je me lève pour courir, courir loin, loin, je pense encore dans moi-même à ces ethnies d'animaux et d'esprits qui sont dans la brousse, je me souviens donc de la carte-là que je voyais en ville et je me demande comment je peux courir comme ça si je ne sais pas la route qui va m'éloigner de la guerre »
Après l'assassinat du chef et la dissolution de la milice, l'enfant-soldat récupéré par une mission humanitaire, parviendra à se confier et tentera d'écrire ce cauchemar qu'il a vécu et qui ne cesse de le hanter. Non pas en vue d'un oubli ou d'un pardon impossible mais seulement pour pouvoir continuer à vivre et s'imaginer, peut-être, un avenir.
L'auteur ne cherche pas ici à situer précisément son récit pour dénoncer un massacre ou des évènements historiques en particulier. Ce qu'il souhaite, à partir de témoignages réels, c'est évoquer de l'intérieur la condition d'enfant soldat, sa psychologie, le phénomène de bestialisation dans lequel il se trouve entraîné.
Pour rendre supportable le récit des actes de barbarie subis ou commis par l'enfant-soldat et ceux qui l'entourent, l'auteur joue sur l'innocence, la spontanéité, le langage de son personnage principal. Cela positionne le lecteur en position de compassion pour ce « tout petit minimum d'homme » condamné à un destin de bête sauvage, fournit des circonstances atténuantes – comme la peur, l'inconscience, l'instinct de survie, la contrainte – à sa participation active aux massacres. Par ce subterfuge, il devient alors possible de percevoir derrière cet enfant tour à tour bourreau et victime, la trouille, la naïveté, la lâcheté, le désespoir, la haine des tous les autres. C'est ainsi la voix dérangeante des bourreaux que Uzodinma Iweala nous donne ici à entendre.
Des images comme filmées par une "caméra embarquée" à l'épaule nous plonge dans la tête du petit Agu. Lui use d'expressions enfantines, maladroites parfois, d'onomatopées approximatives – « kpwap » pour le bruit des balles qui tuent pour de vrai, « ngugungu, ngugungu, ngugungu » pour les battements de son cœur au plus terrible du massacre – et cette langue simple, spontanée, dans son contraste avec la violence des faits évoque de façon plus forte encore la sauvagerie absurde de la situation. De cette langue sans ponctuation et volontairement réduite à son squelette, les mots jaillissent comme le sang d'une blessure, de façon continue.
L'évocation des souvenirs de l'heureux temps de la petite enfance au village est comme une respiration, une suspension, pour permettre au lecteur comme à l'enfant-soldat de ne pas être englouti par le pire.
Ce livre initialement écrit "dans un anglais singulier : une espèce de pidgin mélangé avec des termes techniques et des emprunts aux langues nigérianes comme le yoruba ou l'igbo" est magnifiquement traduit en français par le Congolais Alain Mabanckou prix Renaudot 2006). Pour en restituer la puissance et l'originalité, le traducteur a su lui-même réinventer une langue et une musique originale, colorée et prenante.
Bêtes sans Patrie s’impose comme une dénonciation terriblement efficace des barbaries de la guerre mais, au-delà du réquisitoire et du tableau du fracas des armes et des âmes, il pose aussi les questions qui dérangent :
Peut-on vraiment pardonner au coupable, enfant ou adulte ?
La peur de ceux, enfants ou non, que seul le destin a transformés en guerriers, celle qui amène à l'obéissance et la soumission, qui conduit à la participation à des scènes d'horreur collective, à des actes qu'aucun ne se serait cru capable de commettre en tant de paix, est-elle une excuse ?
Reste-t-il, quand on a franchi la limite de l'horreur et qu'on s'est rendu coupable du pire, une vie possible, après ?
C'est à chacun qu'il appartient d'essayer d'envisager ses réponses. L'auteur, lui, se contente de pointer le doigt sur la sauvagerie des faits, la mouvance de la frontière entre le bien et le mal, le poids du contexte face à la responsabilité, la complexité et la fragilité de l'homme pour semer ses points d'interrogations.
Cette histoire, douloureuse, bouleversante, pleine d'humanité et de révolte, est un superbe chant à la mémoire de tous les enfants-soldats, transformés en chair à canon ou en "bêtes sans patrie" pour des causes qui les dépassent.
Uzodinma Iweala est un jeune auteur d'origine nigériane, né aux Etats-Unis. Dédié "à celles et ceux qui ont souffert", ce monologue intérieur a été salué par Salman Rushdie et l'ensemble de la critique américaine comme un des meilleurs livres parus en 2005. Bêtes sans Patrie, premier roman publié à 23 ans, a reçu de nombreux prix outre-Atlantique.
Dominique Baillon-Lalande
(12/02/09)
|
|
|
Retour
Sommaire
Lectures

Editions de L'Olivier
175 pages - 18 €
Traduit de l'anglais
par Alain Mabanckou,
écrivain congolais qui a notamment publié Verre Cassé, Mémoires de porc-épic (prix Renaudot 2006) et Black Bazar aux éditions du Seuil.
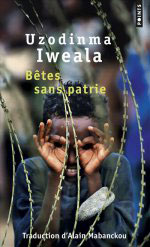
Points
(Juin 2017)
192 pages - 6,50 €

Uzodinma Iweala,
d'origine nigériane, est né aux Etats-Unis en 1982.
Bêtes sans Patrie
est son premier roman.
|
|