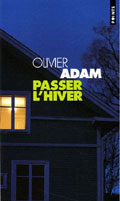|
|
Olivier ADAM
À l'abri de rien
Au cœur de l'histoire, Marie, jeune femme d'origine modeste, mariée à Stéphane, chauffeur de bus scolaire au salaire à peine suffisant pour les faire vivre, eux et leurs deux jeunes enfants, Lise et Lucas. Depuis qu'elle a perdu son boulot de caissière parce qu'elle avait envoyé paître un client qui « comme tant d'autres passait ses nerfs sur elle », Marie occupe ses journées comme elle peut, confinée entre ses quatre murs, entre lecture des petites annonces, ménage, courses, repassage dans l'attente du retour des enfants et de son compagnon.
Engluée dans un quotidien terne et répétitif, elle vit la détresse silencieuse de la pauvreté ordinaire dans les petites zones pavillonnaires de banlieue. « Millions de maisons identiques aux murs crépis de pâle, de beige, de rose, millions de volets peints s'écaillant, de portes de garage mal ajustées, de jardinets cachés derrière... millions de téléviseurs allumés dans des salons Conforama... Millions d'hommes et de femmes invisibles et noyés, d'existences imperceptibles et fondues ».
Marie et Stéphane se sont aimés et elle lui est redevable de l'avoir « ramassée à la petite cuiller » lors de la mort de sa sœur mais aujourd'hui tout cela est « planqué sous la graisse du quotidien et des emmerdes, une couche comme on en a tous ».
Le vide qu'elle n'arrive pas à combler la dévore. Sa vie ressemble à celle de tous ses voisins mais cette petite fille mal grandie qui a la nostalgie de la mer de son enfance, ne supporte pas cet ennui qui la mine. « Se lever se nourrir travailler manger voir des amis aller au cinéma regarder la télévision passer voir sa mère s’occuper des enfants faire ses comptes les magasins l’amour tout est profondément pareil ». Elle lutte contre l'angoisse avec l'impression que sa jeunesse s'est enfuie. « Pourquoi la vie nous abîme à ce point ? Cette foutue dent qu'elle a contre nous, est-ce qu'on a vraiment mérité ça ? » se demande-t-elle.
« Elle est devenue la spectatrice inerte de son monde qui se délite imperceptiblement, où ses envies et ses rêves ne sont plus qu'un lointain souvenir. » (O. Adam).
Déjà fragilisée, à l'adolescence, par la mort accidentelle de Clara , elle sombre dans la dépression, n'a plus de goût pour rien. Tout glisse, tout lui est insensible. Malgré le mari attentif et les enfants aimés et aimants, elle décroche et perd pied. Terriblement seule. Ceux qu'elle croise ont, avec leurs regards vides et leurs gestes convenus, l'air « de robots, de créatures déshumanisées ». Encaisser les coups de la vie, faire face aux fins de mois difficiles et aux soucis « sans espoir que cela puisse changer un jour ne serait-ce qu'un petit peu » car « Le reste c’était l’avenir et c’était pas pour nous on le savait trop bien, il suffisait de regarder autour de nous, nos parents et ceux des autres et toute la ville qui ne pensait qu’à se saouler la gueule et à oublier la pesanteur des choses », elle ne peut plus.
Une succession d'événements minimes mais déterminants, survient qui dévaste tout sur son passage. Un soir, alors qu’elle rentre avec son fils Lucas, sa voiture tombe en panne en rase campagne et sous une pluie battante. Un « Kosovar », terme générique car « Tout le monde les appelait les Kosovars, mais c'étaient surtout des Irakiens, des Iraniens, des Afghans, des Pakistanais, des Soudanais, des Kurdes. », sans un mot ni un regard, lui change la roue de sa voiture puis lui tend la main. Marie, effrayée, ne comprend pas.
Le lendemain, il lui semble le reconnaître dans un groupe d’hommes en haillons massés près du Monoprix. Quelques instant plus tard, sans trop savoir pourquoi, elle le suit dans une tente dressée près de la mairie et se trouve réquisitionnée par les bénévoles qui distribuent de la soupe et du pain à ces réfugiés sans papiers et sans identité qui, pétris de froid, de faim et de peur, errent par centaines dans la région depuis la fermeture en 2002 du camp de Sangatte, dans l’espoir de gagner l’Angleterre.
« Je n'ai jamais compris pourquoi ils l'avaient fermé ce camp. Les choses n'avaient fait qu'empirer. » pense alors Marie. Depuis, ils dorment n'importe où, dans la rue, les blockhaus, les passages, les entrées, près de la gare ou dans le parc public, au risque de se faire ramasser avec brutalité par les forces de l'ordre et abandonner quelques cinquante kilomètres plus loin.
A partir de ce jour-là, la vie de la jeune femme va changer. Elle se consacre totalement, aux distributions de repas, de couvertures, de chaleur humaine, soigne les blessés légers et se passionne pour ces hommes que tout le monde nie, que la police traque, Jallal, Drago, Béchir et les autres. Obsessionnellement, Marie s'étourdit dans cette activité qui occupe son temps et ses pensées, comme une échappatoire à sa réalité. Cette opportunité inattendue de s'ouvrir aux autres lui apparaît comme une chance inespérée de renouer avec la vie et, le cœur en bannière, elle fonce dans cet autre monde, en abandonne son foyer, en oublie même ses enfants.
Elle s'engage aux cotés d'Isabelle qui, le soir venu, poursuit son action de façon clandestine en accueillant illégalement des Kosovars pour qu'ils puissent se laver, se restaurer, danser, rire, boire, dormir au chaud et oublier. « Ils se sont mis à faire les cons et il fallait les voir ces mecs détruits deux par deux qui comptaient leurs pas, un deux trois un deux trois. La musique s'est arrêtée et on s'est rassis épuisés, le ventre tordu par les crampes de rire. C'était une soirée tellement particulière. J'aurais du mal à définir ce qui flottait dans l'air alors, c'était tiède et léger, si gai, comme avoir le cœur serré par la joie et des larmes dans la gorge en même temps. Une parenthèse au milieu des décombres. »
A mesure qu'elle se détache de son ancienne vie, le quartier la montre du doigt ou l'insulte ; des bagarres éclatent à l'école des enfants ; son mari, impuissant et en butte à la moquerie générale, perd patience au risque de perdre lui aussi son emploi. Mais Marie n'en a cure. Elle franchira sans hésiter toutes les étapes jusqu'à accompagner un de ses protégés dans ses démarches de demande d'asile, jusqu'à vider son maigre compte bancaire pour permettre à Bechir d'atteindre, peut-être, cet ailleurs tant espéré.
« – Le passeur a dit pas de problème, a fait Bechir. Ce camion pas fouillé.
– Et le contrôle CO² ? Comment tu vas faire ?
De sa poche il a sorti un sac plastique. Un instant je l'ai imaginé se plonger la tête dedans tandis qu'un type ouvrait le camion pour y passer la sonde. Je l'ai imaginé retenir son souffle pendant toute la durée du contrôle, respirer du carbone jusqu'à suffocation, je l'ai imaginé mort étouffé mais je n'ai rien dit, je me suis contenté de hocher la tête, j'ai regardé l'heure, je savais que c'était le moment. [...] J'ai pensé ce type va mourir et laisser une femme et un enfant, ce type va mourir parce qu'il voulait les rejoindre à Manchester. J'ai pensé que moi pour aller à Manchester je n'avais qu'à prendre le train et que lui allait mourir. »
Pour réparer l'injustice du monde elle a décidé de faire fi de l'illégalité et du regard des autres, de se perdre jusqu'au bout dans le don d'elle-même, au risque de tout perdre et de basculer dans la folie.
Marie, personnage fragile un peu moins armée pour le monde que certains mais aussi un peu moins résignée semble plus en quête de sens que de bonheur.
« Dans son Nord natal, elle suffoque. Elle plongera dans l'abîme pour se sentir exister, même maladroitement, même mal, jusqu'à la folie. Juste pour respirer. » (O. Adam).
Elle nous entraîne dans ses dérives, nous livre son parcours, déballe à l'état brut son effondrement et son exploration intérieure sans chercher la compassion pour mieux donner corps, à travers elle, à la détresse collective, à la vacuité de notre société mais aussi à son inhumanité et à sa violence, à l'insécurité permanente dans laquelle sont plongés les réfugiés.
Son monologue navigue de l'intime – lorsqu'elle évoque de façon touchante Clara, ses souvenirs de jeunesse, ou ses rapports avec ses enfants qu'elle voudrait ne pas voir grandir, ou qu'elle met en mots la spirale de la dépression – à la fresque sociale quand elle décrit la misère ordinaire du quotidien dans un quartier banal même pas stigmatisé en zone sensible ou le dénuement total d'exilés pourchassés.
Entre ces deux univers, gens d'ici modestes et démunis et malheureux venus d'ailleurs, « ombres rejetées à la périphérie de la ville », l'indifférence souvent, un peu de solidarité parfois, mais aussi la peur, et la haine tapie dans l'ombre prête à surgir à tout moment.
Pourtant comment blâmer le mari, rejeté, impuissant, qui tente désespérément de sauver sa famille mais ne comprend rien ? La ménagère à l'existence recluse et minimale, engluée devant la télé, que, dans sa volonté à épargner la misère à ses enfants, tout terrorise ? Le chômeur humilié qui n'a plus comme moyen d'afficher son appartenance au groupe que de mépriser ceux dont la réalité est pire que la sienne ?
Le tableau crédible par ses détails n’est pas exempt de brutalité. L'écrivain s'il manque parfois de nuances et peut alors sembler caricatural, excelle à faire émerger l'émotion vraie du trivial, la vérité de ce qui paraît de prime abord insignifiant. Olivier Adam, d'une écriture dense, rapide, nerveuse, nous précipite sans ménagement au cœur de la noirceur et de la violence de son récit. Son texte vif, serré, évite l’écueil du convenu ou du pathos pour montrer le malheur brut sous ses formes multiples mais dans sa banalité désolante. Son rythme saccadé, entre phrases longues et haletantes, énumérations parfois interminables, ponctuation fantaisiste, joue la correspondance avec l'urgence chaotique des situations et devient facteur de malaise. La langue très personnelle, libre, tantôt orale et ordinaire tantôt créative et riche d'images et de détails bouscule le lecteur et empêche la prise de repères. Tout cela ressemble à un parti pris cohérent de fragiliser le lecteur, le déstabiliser, pour faire appel à sa sensibilité plus qu'à son entendement devant l'absurdité et l'aspect tragique des situations. Pour privilégier l'humain au débat politique, donner à voir et non à juger.
« Ce qui a déclenché l’écriture du livre, ce sont plusieurs séjours à Calais, où j’animais des ateliers d’écriture. En fréquentant cette ville, j’ai été confronté à ce que tout le monde peut y voir, à savoir ces hordes de gens totalement démunis et pris au piège, puisqu’ils ne peuvent ni rentrer chez eux ni aller en Angleterre. On leur reproche d’être en France alors que pour eux ce n’est qu’un lieu de transit. On leur dénie tout, la dignité, l’égalité, le statut même d’être humain. On utilise des mots très cliniques comme "clandestins", "migrants" ou "incitation au retour volontaire" alors que derrière se cachent des gens qui fuient la guerre, la pauvreté, et se retrouvent harcelés, violentés en permanence. Il y a aussi Calais, cette ville portuaire où le chômage est assez fort, où beaucoup de gens vivent sous le seuil de pauvreté. […] Une espèce de tableau originel un peu cauchemardesque, qui provoque l'indignation. […] La 'realpolitik' ne justifie pas la manière dont sont traités les réfugiés. J'ai voulu rendre hommage à ceux qui se sont engagés auprès d'eux. » explique lors d'un interview Olivier Adam.
Il a su, effectivement, bâtir sur son trouble un récit bouleversant où l'émotion affleure à chaque phrase. Un roman, écrit sur un fil, empreint d’un profond humanisme, qui résonne comme un hommage à la vie brisée des humbles. Qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas un livre sur le centre d'hébergement et d'urgence humanitaire – inauguré en 1999 près du tunnel sous la Manche avec ses quatre-vingt mille réfugiés kurdes, afghans ou iraniens, fermé en 2002 – ni même la photographie cruelle d'une époque. Ce que l'on retrouve ici, comme dans les romans précédents de cet auteur, c'est une traque de l'humain et de ses fêlures à partir de la radiographie d'une femme à bout de souffle, entre révolte et tentation de disparaître, qui fait l'expérience de la compassion jusqu'à la folie.
Olivier Adam qui maîtrise si bien l'art de rendre singulier le quotidien et, par son regard non dépourvu de générosité et de respect, les êtres les plus ordinaires, réussit superbement à transcrire les émotions d'une façon juste et touchante. Il nous offre ici un roman dérangeant, parfois, mais fort et original qui ne peut laisser indifférent et mérite absolument lecture.
Dominique Baillon-Lalande
(11/10/07)
|
|
|
Retour
Sommaire
Lectures

Editions de l'Olivier
218 pages - 18 €

Olivier Adam,
né en 1974,
vit actuellement en Bretagne.
Son premier roman, Je vais bien, ne t'en fais pas (LeDilettante, 2000) ouvre un diptyque sur le thème de la disparition qui se poursuit avec A l'Ouest (L'Olivier, 2001).
Egalement scénariste
et auteur pour la jeunesse, Olivier Adam a notamment écrit Poids léger (L'Olivier,
2002), adapté pour le cinéma par Jean-Pierre Améris, Passer l'hiver (L'Olivier, 2004) qui a reçu le Goncourt de la Nouvelle et Falaises (L'Olivier, 2005).
Ses ouvrages ont été repris en collections de poche.



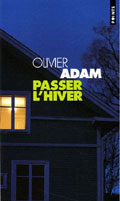

|
|