Les Papiers collés
de Claude Darras
Printemps 2015
Carnet : Méditerranée, une cause jamais perdue selon Jacques Berque
 L’expression de la barbarie et le déchaînement de violences vécus depuis le début de l’année incitent nos contemporains à résister à l’esprit de guerre et à éviter de se replier à l’intérieur de frontières tant physiques que morales. Jacques Berque (4 juin 1910, Frenda, Algérie-27 juin 1995, Saint-Julien en Born, Landes) dont 2015 marque le vingtième anniversaire de la disparition mérite à cet égard que nous réentendions sa parole et ses enseignements. Élu à la VIe section de l'École pratique des hautes études, l’orientaliste accède au Collège de France en 1956 où il occupe la chaire d’Histoire sociale de l’islam contemporain jusqu’en 1981. Ultime acte éditorial accompli au soir de sa vie, la réunion de ses écrits politiques (1956-1995) dispense les idées très édifiantes d’un des maîtres incontestés de l’histoire sociale et de l’anthropologie des sociétés méditerranéennes (pays du Maghreb et du Moyen-Orient), des réflexions opportunes et nécessaires à la compréhension de l’époque présente. L’expression de la barbarie et le déchaînement de violences vécus depuis le début de l’année incitent nos contemporains à résister à l’esprit de guerre et à éviter de se replier à l’intérieur de frontières tant physiques que morales. Jacques Berque (4 juin 1910, Frenda, Algérie-27 juin 1995, Saint-Julien en Born, Landes) dont 2015 marque le vingtième anniversaire de la disparition mérite à cet égard que nous réentendions sa parole et ses enseignements. Élu à la VIe section de l'École pratique des hautes études, l’orientaliste accède au Collège de France en 1956 où il occupe la chaire d’Histoire sociale de l’islam contemporain jusqu’en 1981. Ultime acte éditorial accompli au soir de sa vie, la réunion de ses écrits politiques (1956-1995) dispense les idées très édifiantes d’un des maîtres incontestés de l’histoire sociale et de l’anthropologie des sociétés méditerranéennes (pays du Maghreb et du Moyen-Orient), des réflexions opportunes et nécessaires à la compréhension de l’époque présente.
« Il faut encourager dans toutes les nouvelles générations, le développement d’un islam des lumières, compatible avec la démocratie, recommande-t-il. Il faut favoriser l’émancipation de la femme et la modernisation du culte, l’éclairage des esprits, initier la révolution culturelle du religieux, ce que les chrétiens poursuivent depuis un siècle. » Ailleurs, il appelle de ses vœux la création d’un « ensemble méditerranéen (en fait latino-arabe) qui pourrait ne pas associer des États ni se poser d’abord sur le plan politique, comme l’Europe occidentale ou la Ligue arabe, mais mener des liens entre des dynamiques socioculturelles de part et d’autre : mouvements de jeunes, de syndicalistes, de femmes, d’intellectuels, etc. » « C’est en quelque sorte le rêve des Omeyyades que les Arabes reprendraient, estime-t-il plus loin dans la même tribune, et, en même temps, cela rétablirait chez eux cet équilibrage méditerranéen qu’ils n’ont plus depuis la perte de l’Andalousie. » Les phénomènes d’intégrisme sont disséqués avec une égale clairvoyance : « Ce qui prévaut, croyons-nous, dans les phénomènes qualifiés d’intégrisme ou d’islamisme, ce n’est pas l’élan de la foi, mais une tactique temporelle. La dominante de mouvements tels que ceux de l’imam Khomeiny et du F.I.S. (Front islamique du salut) algérien nous paraît avant tout socio-politique. Il s’agit, pour les groupes concernés, non d’un renouveau de l’exégèse ou d’une renaissance spirituelle, mais d’accéder au pouvoir et d’assumer les tâches de la modernité sans emprunter les voies de la démocratie occidentale. D’où l’insistance sur les actes répressifs, les exclusives lancées, et la devise du retour à la "chari’a", c’est-à-dire à la norme religieuse, inscrite dans le Coran ou dérivée de lui. » La cause de la Méditerranée, celle de la Mer commune - de la Mer « mitoyenne », Mutawassit, disent les Arabes - est loin d’être perdue ; c’est ce que suggère le titre et le contenu de ce bel ouvrage d’intelligence et de raison. « Les deux rives de la Méditerranée, conclut Jacques Berque, se renvoient de longue date un double message de civilisation, l’arabo-islamique et le gréco-latin, l’un et l’autre s’articulant tour à tour et conjointement sur le mode religieux et sur le mode profane. Pourvu que nous y veillions, il y a peu de chances que ce message s’éteigne de sitôt. » Puisse l’espérance du passeur des deux rives s’imposer à l’épreuve des faits.
- Une cause jamais perdue - Pour une Méditerranée plurielle, écrits politiques (1956-1995), par Jacques Berque, éditions Albin Michel, 312 pages, novembre 1998.
(Lundi 2 mars 2015)
 Postes et lutte des classes Postes et lutte des classes
Je sais lire et écrire (j’ai d’ailleurs ce qu’on a bien voulu me donner). C’est tout. Il a fallu me débrouiller tout seul. Avec le certificat d’étude je suis entré en plein dans la vie, en août 1926. Je gagnais deux cent cinquante francs par mois, plus trois sous par dépêche portée. J’étais postier. Je me trimballais dans les rues qui avoisinent le Bon Marché avec la petite sacoche des télégraphistes. J’entrais au Lutétia et je pénétrais au bordel de la rue Saint-Placide. Je recevais dix sous du maquereau, une engueulade du "boock" (son télégramme lui arrivait trop tard, disait-il), une bouffée de fumée de la dame en déshabillé du grand hôtel. J’étais jeune, j’étais numéroté. En ce temps-là, au bureau de la rue Dupin, le "chef" nous parlait souvent de la Révolution et de la lutte des classes. "Lénine", commençait-il. Il faisait flotter sur nous autres, télés, l’ombre du drapeau rouge. "Lutte des classes". J’achetais l’Humanité. Il y avait une rubrique des martyrs du travail. C’était toujours triste à lire.
(Jules Mougin, dans « Mal de cœur : récit autobiographique », Le Jas du Revest-Saint-Martin, Robert Morel éditeur, 1962)
Jules Mougin à Rognes © Photo Christiane Ardisson
Le critique et l’auteur
Dès qu’un critique est intéressant, il le devient beaucoup plus que l’auteur qu’il étudie. L’homme qui lit n’est pas moindre que l’homme qui écrit. Enfin, nous sommes tous des critiques. Nous écrivons avec nos rêves, mais nous sommes lus avec la réalité d’autrui, ou le réel si vous préférez.
(Georges Perros, « Papiers collés » 2, Gallimard/l’Imaginaire, 2008)
Connaissez-vous Mikhaïl Bakhtine ?
Les critiques qui prétendent tout savoir, qui citent Mikhaïl Bakhtine sans l’avoir lu, devraient se rappeler les réflexions du grand maître russe : « Une œuvre ne peut vivre dans les siècles à venir si elle ne se nourrit pas des siècles passés. Si elle était seulement née dans le présent, si elle ne prolongeait pas le passé et ne se reliait pas consubstantiellement à lui, une œuvre ne pourrait pas vivre dans le futur. Tout ce qui appartient uniquement au présent s’éteint avec lui. »
(Vendredi 9 janvier 2015)
Faire oublier le mal de dent
Lisez, relisez Emmanuel Berl. Cet essayiste, historien et mémorialiste rêvait d’être Alexandre Dumas : « l’unique talent d’un écrivain, estimait-il, c’est de faire oublier le mal de dent à un lecteur ».
(Samedi 10 janvier 2015)
|
Billet d’humeur
Des écrivains sur les planches
Lectures pour tous, Post-scriptum, Italiques, Apostrophes, Des mots de minuit, La Grande Librairie, Bibliothèque Médicis : depuis plus d’un demi-siècle, le petit écran métamorphose l’écrivain en acteur à travers des émissions littéraires où le téléspectateur est ravi de voir et d’entendre l’auteur dont il ne connaissait jusque-là que les mots. L’habitude est ancienne. Les gens de lettres se transforment en personnages publics dès le XVIIIe siècle. Voltaire et Rousseau sont sommés d’assumer les rôles que leurs lecteurs ou leurs visiteurs leur assignent côté cour ou côté jardin. Le public se réjouit aujourd’hui de ce que la relation entre la vie et l’œuvre s’établisse dans la réciprocité. Et chaque nouvelle parution confère à leur auteur un regain d’actualité. On s’habitue ainsi à entendre l’un ou l’autre dire son mot sur ses propres écrits ou à propos de tout autre chose, on force leur silence et leur modestie. Ils charment ou ils agacent. Ils charment s’ils savent parer d’humour et de poésie la confidence ; ils agacent s’ils prennent le ton de l’ostentation ou du règlement de comptes. Quant à savoir si pareils spectacles favorisent les batailles de l’esprit…
|
Lecture critique
Les plantes des femmes, une vieille histoire
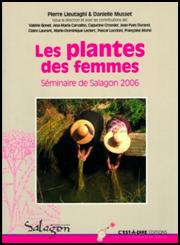 En choisissant pour thème de leur sixième séminaire « Les Plantes des femmes », les animateurs du musée et des jardins de Salagon à Mane (Alpes de Haute-Provence) et leurs invités étaient voués à faire œuvre à la fois d’historien et d’ethnologue. Venus d’horizons très différents, les intervenants ne se sont naturellement pas limités au temps rural et proche (XVIIe-XXe siècles) où les travaux de la terre et l’élevage des animaux étaient, avec la chasse, exclusivement dévolus aux hommes tandis que la médecine populaire en relation avec les plantes, activité jugée accessoire celle-là, incombait aux femmes. Dans cette perspective, il était tout à fait opportun de rappeler la savante expertise de Pline l’Ancien, dont l’Histoire naturelle constitue une contribution majeure à l’ethnobotanique. Selon Valérie Bonet (maître de conférences à l’université Aix-Marseille 1), le naturaliste et écrivain romain du Ier siècle de notre ère a réalisé une compilation des connaissances de son époque, à partir d’un très grand nombre de sources latines et grecques. « Mais il n’écrit pas pour la courtisane, la paysanne ou la femme du peuple, explique-t-elle, il écrit pour la matrone, la femme de la haute société de la Rome impériale. » « Pour certains végétaux, remarque-t-elle, Pline l’Ancien n’oublie pas de mentionner un pouvoir presque effrayant tellement il est puissant : une femme avorte si elle mange de l’orcanette jaune (Onosma echiioïdes L.) ou simplement si elle marche dessus ; elle subit le même sort, si elle enjambe une racine de cyclamen (Cyclamen hederifolium L.). Quant à la serpentaire (Arum dracunculus L.), à qui on attribue des propriétés brûlantes et mordantes, il suffit de la respirer pour avorter. » Beaucoup plus tard, dès le XVIIe siècle, la tradition orale, celle du colportage, témoigne de l’influence tenace exercée par la magie et la superstition sur la médecine populaire revendiquée par la gent féminine, une science empirique qui concurrence rudement alors les techniques et les pratiques de la médecine « scientifique ». Au cours du colloque, Marie-Dominique Leclerc (Université de Reims-Champagne-Ardenne) a d’ailleurs retracé l’exceptionnel succès de la Bibliothèque bleue, née en Champagne au début du XVIIe siècle, dans l’atelier de l’imprimeur troyen Nicolas Oudot. « Lorsqu’il souhaite se renseigner sur la nature qui l’entoure, détaille-t-elle, le lecteur de la "Bibliothèque bleue" dispose des brochures utiles pour se nourrir et se soigner. Or, parmi ces textes, nombre de conseils s’adressent manifestement aux femmes, soit parce que les tâches décrites (culture, cuisine, soins spécifiques) leur incombent traditionnellement, soit parce que les remèdes indiqués leur sont explicitement assignés ("maladies des femmes"). » « Dans l’esprit féminin, observe-t-elle, il y avait sans doute peu de différence entre élaborer un remède à base de plante (pratique pseudo-scientifique) et préparer une mixture avec des gestes spécifiques et des formules incantatoires (pratique magique). Les livrets s’en font l’écho et tout particulièrement lors du "travail d’enfant". » Abordant la pharmacopée des sages-femmes mexicaines et équatoriennes, Claire Laurant-Berthoud (Institut des hautes études de l’Amérique latine-Paris III Sorbonne Nouvelle) révèle qu’au XVIe siècle « les plantes médicinales constituaient l’un des objectifs des expéditions guerrières des Nahuas. Des échantillons étaient prélevés, peints sur place par les "tlacuilo" (peintres spécialisés dans les glyphes) qui accompagnaient les guerriers puis adaptés dans les jardins botaniques de l’empereur à Oaxtepec. Ces jardins étaient d’accès libre aux populations pour se soigner à la condition que les effets des plantes soient rapportés aux médecins de l’empereur et consignés par ceux-ci. » L’agronome Ana-Maria Carvalho (Centre de recherche sur la montagne de l’École supérieure d’agronomie de Bragance) signale d’autres rites féminins observés dans la province portugaise de Trás-os-Montes : « Autrefois, au mois de mai, souligne-t-elle, les jeunes filles préparaient, sur le parvis de l’église, des bûchers de cytise et de bruyères à fleur blanche. L’abbé éteignait le feu à l’eau bénite et bénissait les récoltes, les ânes et les bêtes avec du bois incandescent. (…) Le Mardi gras ou le dimanche de Pâques, les enfants cueillaient de petits bouquets de narcisses, pivoines, primevères et violettes qu’ils offraient à leurs marraines ». « Temps cyclique, argumente l’ethnobotaniste Capucine Crosnier (Direction régionale de l’environnement du Languedoc-Roussillon), le temps féminin comprend les stades impubère, pubère, fécond, ménopausé… Pour les décrire, les métaphores utilisées reposent sur des correspondances entre la femme et la plante : tout d’abord les promesses de la jeune fille : "Elle n’est pas encore femme, mais c’est du bois pour en faire !" ; puis l’on évoque le printemps de la femme : "Elle est à la fleur de l’âge, c’est une belle plante, le bel âge" ; et arrive l’automne de la vie : "Elle se fane"… ». « En ce qui concerne la manière qu’a cette société, ou qu’ont certains de ses membres de concevoir et d’organiser son rapport à son environnement et sa place dans le monde, il n’est pas sans signification, considère l’ethnologue et maître de conférences Jean-Yves Durand (Université du Minho, à Braga, Portugal, et Institut d’ethnologue méditerranéenne et comparative, Maison méditerranéenne des sciences de l’hommes, à Aix-en-Provence), qu’il y ait des ethnobotanistes et que s’affirme un intérêt diffus pour l’ethnobotanique, aujourd’hui, dans notre société. Que cet intérêt persiste à porter surtout sur les "plantes des femmes" montre que, pas plus qu’ailleurs, rien n’est jamais simple au royaume des plantes ». En choisissant pour thème de leur sixième séminaire « Les Plantes des femmes », les animateurs du musée et des jardins de Salagon à Mane (Alpes de Haute-Provence) et leurs invités étaient voués à faire œuvre à la fois d’historien et d’ethnologue. Venus d’horizons très différents, les intervenants ne se sont naturellement pas limités au temps rural et proche (XVIIe-XXe siècles) où les travaux de la terre et l’élevage des animaux étaient, avec la chasse, exclusivement dévolus aux hommes tandis que la médecine populaire en relation avec les plantes, activité jugée accessoire celle-là, incombait aux femmes. Dans cette perspective, il était tout à fait opportun de rappeler la savante expertise de Pline l’Ancien, dont l’Histoire naturelle constitue une contribution majeure à l’ethnobotanique. Selon Valérie Bonet (maître de conférences à l’université Aix-Marseille 1), le naturaliste et écrivain romain du Ier siècle de notre ère a réalisé une compilation des connaissances de son époque, à partir d’un très grand nombre de sources latines et grecques. « Mais il n’écrit pas pour la courtisane, la paysanne ou la femme du peuple, explique-t-elle, il écrit pour la matrone, la femme de la haute société de la Rome impériale. » « Pour certains végétaux, remarque-t-elle, Pline l’Ancien n’oublie pas de mentionner un pouvoir presque effrayant tellement il est puissant : une femme avorte si elle mange de l’orcanette jaune (Onosma echiioïdes L.) ou simplement si elle marche dessus ; elle subit le même sort, si elle enjambe une racine de cyclamen (Cyclamen hederifolium L.). Quant à la serpentaire (Arum dracunculus L.), à qui on attribue des propriétés brûlantes et mordantes, il suffit de la respirer pour avorter. » Beaucoup plus tard, dès le XVIIe siècle, la tradition orale, celle du colportage, témoigne de l’influence tenace exercée par la magie et la superstition sur la médecine populaire revendiquée par la gent féminine, une science empirique qui concurrence rudement alors les techniques et les pratiques de la médecine « scientifique ». Au cours du colloque, Marie-Dominique Leclerc (Université de Reims-Champagne-Ardenne) a d’ailleurs retracé l’exceptionnel succès de la Bibliothèque bleue, née en Champagne au début du XVIIe siècle, dans l’atelier de l’imprimeur troyen Nicolas Oudot. « Lorsqu’il souhaite se renseigner sur la nature qui l’entoure, détaille-t-elle, le lecteur de la "Bibliothèque bleue" dispose des brochures utiles pour se nourrir et se soigner. Or, parmi ces textes, nombre de conseils s’adressent manifestement aux femmes, soit parce que les tâches décrites (culture, cuisine, soins spécifiques) leur incombent traditionnellement, soit parce que les remèdes indiqués leur sont explicitement assignés ("maladies des femmes"). » « Dans l’esprit féminin, observe-t-elle, il y avait sans doute peu de différence entre élaborer un remède à base de plante (pratique pseudo-scientifique) et préparer une mixture avec des gestes spécifiques et des formules incantatoires (pratique magique). Les livrets s’en font l’écho et tout particulièrement lors du "travail d’enfant". » Abordant la pharmacopée des sages-femmes mexicaines et équatoriennes, Claire Laurant-Berthoud (Institut des hautes études de l’Amérique latine-Paris III Sorbonne Nouvelle) révèle qu’au XVIe siècle « les plantes médicinales constituaient l’un des objectifs des expéditions guerrières des Nahuas. Des échantillons étaient prélevés, peints sur place par les "tlacuilo" (peintres spécialisés dans les glyphes) qui accompagnaient les guerriers puis adaptés dans les jardins botaniques de l’empereur à Oaxtepec. Ces jardins étaient d’accès libre aux populations pour se soigner à la condition que les effets des plantes soient rapportés aux médecins de l’empereur et consignés par ceux-ci. » L’agronome Ana-Maria Carvalho (Centre de recherche sur la montagne de l’École supérieure d’agronomie de Bragance) signale d’autres rites féminins observés dans la province portugaise de Trás-os-Montes : « Autrefois, au mois de mai, souligne-t-elle, les jeunes filles préparaient, sur le parvis de l’église, des bûchers de cytise et de bruyères à fleur blanche. L’abbé éteignait le feu à l’eau bénite et bénissait les récoltes, les ânes et les bêtes avec du bois incandescent. (…) Le Mardi gras ou le dimanche de Pâques, les enfants cueillaient de petits bouquets de narcisses, pivoines, primevères et violettes qu’ils offraient à leurs marraines ». « Temps cyclique, argumente l’ethnobotaniste Capucine Crosnier (Direction régionale de l’environnement du Languedoc-Roussillon), le temps féminin comprend les stades impubère, pubère, fécond, ménopausé… Pour les décrire, les métaphores utilisées reposent sur des correspondances entre la femme et la plante : tout d’abord les promesses de la jeune fille : "Elle n’est pas encore femme, mais c’est du bois pour en faire !" ; puis l’on évoque le printemps de la femme : "Elle est à la fleur de l’âge, c’est une belle plante, le bel âge" ; et arrive l’automne de la vie : "Elle se fane"… ». « En ce qui concerne la manière qu’a cette société, ou qu’ont certains de ses membres de concevoir et d’organiser son rapport à son environnement et sa place dans le monde, il n’est pas sans signification, considère l’ethnologue et maître de conférences Jean-Yves Durand (Université du Minho, à Braga, Portugal, et Institut d’ethnologue méditerranéenne et comparative, Maison méditerranéenne des sciences de l’hommes, à Aix-en-Provence), qu’il y ait des ethnobotanistes et que s’affirme un intérêt diffus pour l’ethnobotanique, aujourd’hui, dans notre société. Que cet intérêt persiste à porter surtout sur les "plantes des femmes" montre que, pas plus qu’ailleurs, rien n’est jamais simple au royaume des plantes ».
- Les Plantes des femmes, actes du séminaire organisé du 23 au 25 novembre 2006 à Saint-Michel l’Observatoire par le musée départemental ethnologique de Haute-Provence (prieuré de Salagon, à Mane), actes publiés sous la direction de Danielle Musset (ethnologue) et Pierre Lieutaghi (ethnobotaniste), C’est-à-dire Éditions, 152 pages, 2010.
Portrait
Le combat et le credo de Jack Lang
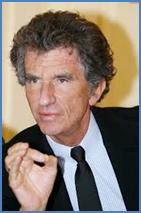 À peine plus épais qu’un passeport monégasque, le livre de Jack Lang, « Ouvrons les yeux ! » sonne à l’oreille du lecteur, notre contemporain, comme une impérieuse exhortation à dessiller notre regard sur l’espace où nous vivons. « Mais voyons-nous encore seulement cette laideur qui nous entoure ? déplore le ministre de la Culture de François Mitterrand et l’actuel président de l’Institut du monde arabe. Elle nous frappe rarement. Il semble que nous nous y soyons accoutumés, comme à quelque chose d’inévitable. » « Serions-nous devenus schizophrènes ? renchérit-il plus loin. Nous qui avons mené avec tant de force la lutte pour préserver les plus beaux monuments de nos villes, comment avons-nous pu avoir si peu d’exigence pour nos espaces publics, pour nos transports, pour nos maisons, pour tous ces lieux qui sont notre quotidien ? » À peine plus épais qu’un passeport monégasque, le livre de Jack Lang, « Ouvrons les yeux ! » sonne à l’oreille du lecteur, notre contemporain, comme une impérieuse exhortation à dessiller notre regard sur l’espace où nous vivons. « Mais voyons-nous encore seulement cette laideur qui nous entoure ? déplore le ministre de la Culture de François Mitterrand et l’actuel président de l’Institut du monde arabe. Elle nous frappe rarement. Il semble que nous nous y soyons accoutumés, comme à quelque chose d’inévitable. » « Serions-nous devenus schizophrènes ? renchérit-il plus loin. Nous qui avons mené avec tant de force la lutte pour préserver les plus beaux monuments de nos villes, comment avons-nous pu avoir si peu d’exigence pour nos espaces publics, pour nos transports, pour nos maisons, pour tous ces lieux qui sont notre quotidien ? »
Depuis longtemps, depuis toujours en somme, le tribun vosgien (né à Mirecourt le samedi 2 septembre 1939) mène le combat fondé sur un credo dont il a pu éprouver les principes et les difficultés en qualité de professeur (droit public), directeur de théâtre (Nancy, Paris et Milan), maire (Blois), député (Loir-et-Cher et Pas-de-Calais) et ministre (Culture et Éducation nationale). Publié à l’occasion du trentième anniversaire des Journées du Patrimoine qu’il a créées en 1984, son manifeste, particulièrement virulent, laisse à penser que la sauvegarde des espaces et des monuments, des paysages et de la biodiversité, doit être recommencée aujourd’hui avec la même acuité et la même urgence. Et de désigner le bétonnage des banlieues, des stations balnéaires et des villages de montagne, la standardisation des périphéries urbaines, l’invasion des enseignes géantes de publicité, les tours démesurées et sans âme. « J’entends les contraintes économiques, observe-t-il, l’urgence de reconstruire au sortir de la guerre, l’urbanisation galopante, la nécessité de loger les populations ouvrières, la démocratisation des loisirs, toutes les raisons essentielles qui ont présidé à la construction de ces ensembles. Je sais le progrès qu’elles ont constitué, à l’époque, pour les populations les moins aisées, qui ont enfin accès au confort de la vie moderne. Mais personne ne peut nier que nous payons aujourd’hui le prix de leur laideur, de leurs matériaux bon marché et de leur inadaptation à leur environnement. Un prix fort, à la fois esthétique, social et économique. »
« Notre patrimoine n’est pas réductible à Versailles, soutient-il, il n’est pas réductible au Louvre, au mont Saint-Michel, à la basilique de Vézelay, ou au palais des Papes… Il est l’ensemble des biens que nous allons léguer aux générations futures, nos paysages, nos maisons, le dessin de nos villes, les bancs sur lesquels nos enfants iront s’asseoir, les rues dans lesquelles ils se promèneront, les places où ils se rencontreront. »
 Exaltant les mérites d’illustres devanciers dont l’abbé Grégoire, Victor Hugo, Prosper Mérimée, André Chastel, l’ancien ministre ne ménage cependant pas André Malraux : « Pendant qu’il remporte des batailles cruciales pour le patrimoine, il autorise la construction de la tour Montparnasse », regrette-t-il. S’il n’autorise aucune concession à ses pairs coupables de défiguration de sites naturels ou d’abandon de monuments remarquables, il reconnaît les échecs subis sous sa mandature dont la reconversion des Halles de Baltard. Exaltant les mérites d’illustres devanciers dont l’abbé Grégoire, Victor Hugo, Prosper Mérimée, André Chastel, l’ancien ministre ne ménage cependant pas André Malraux : « Pendant qu’il remporte des batailles cruciales pour le patrimoine, il autorise la construction de la tour Montparnasse », regrette-t-il. S’il n’autorise aucune concession à ses pairs coupables de défiguration de sites naturels ou d’abandon de monuments remarquables, il reconnaît les échecs subis sous sa mandature dont la reconversion des Halles de Baltard.
Au fil de sa profession de foi, Jack Lang préconise de relier en un seul maroquin la Culture, la Ville, le Logement et le Développement durable. « Il ne s’agirait pas de créer une administration supplémentaire, argumente-t-il, mais bien de repenser leurs liens afin de mener une action cohérente et réfléchie sur l’ensemble de ces sujets. Le ministère de la Culture, qui est le ministère de la Beauté, celui du Patrimoine et de la Création, de la Mémoire et de l’Inventivité, serait à même de porter cette nouvelle politique si essentielle pour nos territoires. Il y a là une nouvelle forme d’action à inventer. Une politique ambitieuse, courageuse, du cadre de vie, qui replace l’homme au centre. » « Faire du Beau le seul pré carré des artistes et des musées est une grave erreur, ajoute-t-il, qui n’est sans doute pas étrangère à la construction de cette France à deux vitesses avec, d’une part, des monuments muséifiés et, d’autre part, un patrimoine du quotidien sans ambition esthétique. »
Éduquer le regard pour éveiller les consciences reste l’enjeu majeur de l’auteur. Son livre rappelle, par la taille et l’esprit, l’essai « Indignez-vous ! » (éditions Indigène, 2011) du résistant et ancien ambassadeur Stéphane Hessel (1917-2013).
Jack Lang © Photo X droits réservés
- Ouvrons les yeux ! La nouvelle bataille du patrimoine, par Jack Lang, Hervé Chopin éditions, 40 pages, 2014
Du même auteur :
- Michel-Ange, par Jack Lang et Colin Lemoine, éditions Fayard, 300 pages, 2012
- Laurent le Magnifique, par Jack Lang, éditions Perrin, 225 pages, 2002.
Varia : le portrait carbonique des pays de la planète
 « 36 milliards de tonnes (Gt) de gaz carbonique, issues de la combustion d’énergies fossiles et de la production de ciment, ont été rejetées dans l’atmosphère en 2013 ; soit une augmentation de 2,3 % par rapport à 2012 ! Ces données ont été publiées en septembre dernier par les auteurs du Global Carbon Atlas (projet de la fondation BNP Paribas coordonné par le LSCE, Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement). Lancé fin 2011, ce projet entend fédérer la coopération internationale dans la recherche sur le cycle du carbone. Au total, 88 scientifiques de 12 pays représentant 68 institutions y participent. Objectif : compiler chaque année les données scientifiques publiées et publiques qui permettront de quantifier les émissions anthropiques et les puits de carbone (réservoir, naturel - forêt, océan - ou artificiel, qui absorbe le carbone de l’atmosphère) partout dans le monde. Si la dernière édition du Global Carbon Atlas met en évidence une hausse significative des émissions de CO2 par rapport à 2012, la situation apparaît contrastée. L’Inde détient le "record" avec une augmentation de 5,1 %, principalement due à la croissance économique du pays. La Chine affiche un taux de 4,2 %, toutefois inférieur aux augmentations précédentes, signe d’un ralentissement économique et de l’amorce d’une moindre dépendance aux énergies fossiles. Cette conjoncture ne concerne pas les États-Unis dont les émissions de CO2 de + 2,9 % sont corrélées à la forte utilisation de charbon en 2013. Seule "bonne élève" des puissances économiques, l’Europe présente une diminution de 1,8 %, attribuée à la crise économique. "Toujours est-il qu’en l’absence de mesure politique et compte tenu des projections de croissance mondiale, ces tendances devraient se poursuivre au moins jusqu’en 2019…" commente Philippe Ciais, climatologue du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) au LSCE et membre du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat créé en 1988 par l’ONU). « 36 milliards de tonnes (Gt) de gaz carbonique, issues de la combustion d’énergies fossiles et de la production de ciment, ont été rejetées dans l’atmosphère en 2013 ; soit une augmentation de 2,3 % par rapport à 2012 ! Ces données ont été publiées en septembre dernier par les auteurs du Global Carbon Atlas (projet de la fondation BNP Paribas coordonné par le LSCE, Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement). Lancé fin 2011, ce projet entend fédérer la coopération internationale dans la recherche sur le cycle du carbone. Au total, 88 scientifiques de 12 pays représentant 68 institutions y participent. Objectif : compiler chaque année les données scientifiques publiées et publiques qui permettront de quantifier les émissions anthropiques et les puits de carbone (réservoir, naturel - forêt, océan - ou artificiel, qui absorbe le carbone de l’atmosphère) partout dans le monde. Si la dernière édition du Global Carbon Atlas met en évidence une hausse significative des émissions de CO2 par rapport à 2012, la situation apparaît contrastée. L’Inde détient le "record" avec une augmentation de 5,1 %, principalement due à la croissance économique du pays. La Chine affiche un taux de 4,2 %, toutefois inférieur aux augmentations précédentes, signe d’un ralentissement économique et de l’amorce d’une moindre dépendance aux énergies fossiles. Cette conjoncture ne concerne pas les États-Unis dont les émissions de CO2 de + 2,9 % sont corrélées à la forte utilisation de charbon en 2013. Seule "bonne élève" des puissances économiques, l’Europe présente une diminution de 1,8 %, attribuée à la crise économique. "Toujours est-il qu’en l’absence de mesure politique et compte tenu des projections de croissance mondiale, ces tendances devraient se poursuivre au moins jusqu’en 2019…" commente Philippe Ciais, climatologue du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) au LSCE et membre du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat créé en 1988 par l’ONU).
« "Les efforts requis pour limiter l’augmentation de la température moyenne terrestre à 2° Clesius en 2100 devront être considérables, poursuit le chercheur. Au rythme actuel, le seuil critique de CO2 dans l’atmosphère sera atteint dans 30 ans". Signe révélateur : pour la première fois, en avril dernier, les concentrations mensuelles de CO2 dans l’hémisphère nord ont dépassé les 400 ppm (partie pour million, unité de mesure qui exprime un rapport de 10-6, par exemple un milligramme par kilogramme). "Ce seuil est symbolique car les concentrations en CO2 étaient de 280 ppm avant la révolution industrielle (1850) et nous savons que pour éviter un réchauffement de 2°C, ce seuil ne doit pas dépasser les 450 ppm…". La station de l’Ile d’Amsterdam du LSCE, située dans le sud de l’océan Indien, sera sans doute l’une des dernières de l’hémisphère sud à pouvoir mesurer des valeurs en dessous de ce seuil… »
Extrait de « Climat : le portrait CO2 des pays », un article de Vahé Ter Minassian, issu du magazine du CEA, « Les Défis du CEA », n° 195, décembre 2014-janvier 2015.
Carnet : Les Joueurs de cartes
Pierre Dumayet aimait faire remarquer que Les Joueurs de cartes de Paul Cézanne qui sont à Orsay jouent avec des cartes blanches : « or, Cézanne, ce n’est pas Magritte ! », lançait-il, espiègle.
Cassoles d’Issel…
Robert J. Courtine, ce grand raconteur d’histoire gourmande, prétendait que le fameux cassoulet existait bien avant que Colomb ne découvre l’Amérique et que ses marins n’en ramènent les haricots. « C’est en bavardant, un jour, que je remarquai que le mot cassoulet est vieux sinon comme le monde, du moins comme la terre du village d’Issel et de laquelle on fabriquait les casseroles : cassoles d’Issel… Prononcez-le plusieurs fois de plus en plus vite et avec l’accent et cela donne cassoulet ! »
(Dimanche 25 janvier 2015)
Pékin, reine du futur
« Sur l’autre rive du fleuve, Pudong est un spectacle. La tour de télévision est un bilboquet géant sur ses jambes écartées et ses sphères scintillent dans la brume du soir. Poussé sur les ruines des cabanes, le colosse porte un nom de bijou : la Perle de l’Orient. » 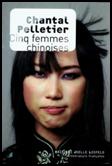 L’écriture de Chantal Pelletier est de celles qui fascinent et intimident à la fois. Plus loin, on lit encore :
« L’avant-veille de l’inauguration des Jeux olympiques, Mei, fermée aux vociférations de la radio, reprend souffle dans un taxi dont la vitre donne en spectacle les boucles neuves des échangeurs entre les cubes de verre et d’acier. Des passerelles enjambent les carrefours. Des façades enluminées d’écrans géants vantent sodas, voitures, vêtements de sport. De la capitale ont disparu les palissades des chantiers. Trottoirs propres et nets, terre-pleins plantés de verdure, croisements semés de panneaux neufs, le décor semble attendre le Moteur ! d’un metteur en scène : Cité millénaire, reine du futur pourrait être le titre du film dont le tournage va commencer. » (Extraits de « Cinq Femmes chinoises », de Chantal Pelletier, éditions Joëlle Losfeld, 2013) L’écriture de Chantal Pelletier est de celles qui fascinent et intimident à la fois. Plus loin, on lit encore :
« L’avant-veille de l’inauguration des Jeux olympiques, Mei, fermée aux vociférations de la radio, reprend souffle dans un taxi dont la vitre donne en spectacle les boucles neuves des échangeurs entre les cubes de verre et d’acier. Des passerelles enjambent les carrefours. Des façades enluminées d’écrans géants vantent sodas, voitures, vêtements de sport. De la capitale ont disparu les palissades des chantiers. Trottoirs propres et nets, terre-pleins plantés de verdure, croisements semés de panneaux neufs, le décor semble attendre le Moteur ! d’un metteur en scène : Cité millénaire, reine du futur pourrait être le titre du film dont le tournage va commencer. » (Extraits de « Cinq Femmes chinoises », de Chantal Pelletier, éditions Joëlle Losfeld, 2013)
La pédagogie de l’admiration
Y a-t-il, demande Jean Daniel, plus grand bonheur que d’admirer ? Rien ne l’irrite plus que l’esprit de dénigrement, ce « brio de la malveillance » qu’on tient en France pour l’un des beaux-arts. L’écrivain et journaliste voue à l’admiration une fonction pédagogique, pourvu qu’on l’assortisse d’une grande exigence de qualité.
Vous avez dit corbeilles de propreté ?
Le langage aussi évolue. Avant on parlait de poubelles. Laides, on cherchait à les cacher. Aujourd’hui, on parle de corbeilles de propreté.
(Mercredi 28 janvier 2015)
|
Billet d’humeur
La médecine guérit !
Dans le domaine de la critique littéraire, j’ai beaucoup appris en lisant un médecin, le professeur Jean Bernard (1907-2006). Le réputé hématologue qui avait revêtu l’habit vert des académiciens en 1975 (succédant à Marcel Pagnol au 25e fauteuil) se doublait d’un lecteur lucide et raffiné qui faisait part de ses admirations aux lecteurs du quotidien Le Figaro dans une écriture délicate et superbe qui l’avait rapproché de Paul Valéry et de Jules Romains. J’ai retenu de lui, dans l’ouvrage « C’est de l’homme qu’il s’agit » (éditions Odile Jacob, 1988), les dernières lignes où il retrace l’histoire de la médecine. « Pendant des millénaires (sauf au temps de Louis Pasteur), écrit-il, les médecins ont parlé latin et grec, charmant le malade sans le guérir. C’est en ce XXe siècle qu’enfin la médecine guérit ! Mais demain, elle agira, enfin, sur les vraies causes qui sont moléculaires et nous mourrons guéris… » À méditer.
|
Lecture critique
Les Chroniques d’une guerre ordinaire de Daniel Pierrejean
Centenaire 14-18
 Même s’il dissimule sous des noms d’emprunt l’identité des vrais acteurs de l’histoire, « Le Jour de la Victoire » observe plus ou moins scrupuleusement l’authenticité des faits et des lieux durant la Deuxième Guerre mondiale. L’intrigue se déroule en 1918 et 1919 sur le front champenois et dans le Val de Loire. Septembre 1918 marque un moment décisif en Champagne et en Argonne pour le général français Henri Gouraud dont la IVe armée, soutenue par la Ière armée américaine du général John Pershing, fait reculer jusqu’aux frontières belges et allemandes les troupes du Kaiser Guillaume II. Au château de la Bourdaisière, à Montlouis-sur-Loire, le capitaine Henri Martin se prépare à rejoindre le 415e régiment d’infanterie de la IVe armée après y avoir été blessé au bras droit. Marié à Clémence qui lui a donné deux enfants, Diane et Adrien, il a délégué la gestion du vignoble de chenin blanc à partir duquel est élaboré le vin de Vouvray à Alphonse qui a grandi à son côté dans la propriété et qui en est devenu le métayer comme l’était son père avant lui. Le domaine où est élevé le cépage blanc de Touraine est constitué de coteaux pierreux et de terres d’argiles à silex, paysage emblématique de la prestigieuse appellation. Passionné d’histoire contemporaine et sans doute influencé par l’attrait du génie militaire de Napoléon Bonaparte et de la pensée du stratège prussien Carl von Clausewitz, le châtelain a embrassé la carrière des armes en intégrant l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, près de Versailles. Dès le début des hostilités, ses qualités humaines lui valent le respect et l’estime de ses soldats mais aussi les réprimandes et les mises en garde de certains de ses supérieurs hiérarchiques qui condamnent sa complaisance avec ses subordonnés et sa bienveillance envers l’ennemi. Relevé temporairement de ses fonctions pour avoir refusé de faire tirer sur des Allemands qui se rendaient avec un drapeau blanc, il écope du Conseil de guerre. Les règles d’humanité prescrites par la Convention de la Haye prévaudront en octobre 1918 dans le jugement du tribunal militaire qui le lavera de toute trahison. Fait mémorable, le 25 septembre 1918, il reçoit dans son poste de commandement le président du Conseil Georges Clemenceau en visite aux premières lignes des unités françaises à la veille d’une offensive alliée d’envergure au mont de la Ferme de Navarin, un des lieux stratégiques du front champenois. Loin de l’image d’Épinal de la guerre « fraîche et joyeuse », le roman évoque, en demi-teintes, la boue glacée des tranchées et les milliers de « poilus » hachés par les obus et la mitraille. La terrible épreuve forge les solidarités de groupes qui ont résisté aux quatre années d’une lutte sanglante. Mais la réalité barbare de la Grande Guerre ruine peu à peu le noble idéal et les folles espérances de l’officier tourangeau qui s’efforce par tous les moyens de préserver ses hommes et qui n’aspire qu’à l’interruption définitive des combats. Quelques jours avant son audition au Conseil de guerre, une double tragédie le frappe alors qu’il poursuit sa mission sur le front. Sa femme Clémence meurt des suites de la grippe espagnole, contractée en soignant les victimes civiles et militaires évacuées dans leur résidence de la Bourdaisière, réquisitionnée par le service de santé aux armées. Peu après, le ministre de la Guerre l’informe du décès, au cours de combats près de Verdun, de son fils Adrien, fraîchement incorporé dans une unité d’infanterie. Le samedi 9 novembre 1918, alors que les pourparlers d’armistice se prolongent à Rethondes, son chef de division, le général Edmond Boichut, lui transmet l’ordre du chef d’état-major général Ferdinand Foch de maintenir la pression sur l’adversaire et de franchir la Meuse coûte que coûte. Le 11 novembre, quelques heures avant que les cloches de France ne carillonnent de tout leur bronze la paix retrouvée, il est gravement blessé d’une balle dans la tête. Hospitalisé à Suippes puis au Val-de-Grâce, à Paris, il reprend la rédaction des « Chroniques d’une guerre ordinaire » à l’incitation de Diane qui tient la plume de son père rendu aveugle par la blessure. Commencée en septembre à l’hôpital de Suippes, la chronique se prévaut de répondre à l’incohérence et aux contre-vérités colportées sur les années de belligérance par les journaux d’informations générales dont L’Intransigeant, quotidien ordinaire de la famille Martin. Les mémoires qu’il dicte à sa fille veulent aussi soustraire à l’oubli le sacrifice de ces jeunes gens aux visages de vieillards livrés des mois durant à la fournaise. Le lecteur ne restera pas insensible à la démarche vertueuse du narrateur ainsi qu’à la cohésion de ses intimes et familiers : la leçon d’humanisme héritée de son père, le soutien à son procès du capitaine et saint-cyrien René Hénin, le rêve de son fils Adrien de prêter le serment d’Hippocrate, la tendre inclination de l’infirmière Marie de Valmont de Bourgueil pour le capitaine vigneron, le compagnonnage fraternel du métayer Alphonse et la rencontre si pleine de sens, au plus intense de l’apocalypse guerrière, du chirurgien et Hauptmann Helmut Ziegler dans un hôpital souterrain aménagé à 10 kilomètres à vol d’oiseau du mont de la Ferme de Navarin. Les Chroniques du capitaine Henri Martin seront éditées sous le titre -mais vous l’auriez deviné- Le Jour de la Victoire. Même s’il dissimule sous des noms d’emprunt l’identité des vrais acteurs de l’histoire, « Le Jour de la Victoire » observe plus ou moins scrupuleusement l’authenticité des faits et des lieux durant la Deuxième Guerre mondiale. L’intrigue se déroule en 1918 et 1919 sur le front champenois et dans le Val de Loire. Septembre 1918 marque un moment décisif en Champagne et en Argonne pour le général français Henri Gouraud dont la IVe armée, soutenue par la Ière armée américaine du général John Pershing, fait reculer jusqu’aux frontières belges et allemandes les troupes du Kaiser Guillaume II. Au château de la Bourdaisière, à Montlouis-sur-Loire, le capitaine Henri Martin se prépare à rejoindre le 415e régiment d’infanterie de la IVe armée après y avoir été blessé au bras droit. Marié à Clémence qui lui a donné deux enfants, Diane et Adrien, il a délégué la gestion du vignoble de chenin blanc à partir duquel est élaboré le vin de Vouvray à Alphonse qui a grandi à son côté dans la propriété et qui en est devenu le métayer comme l’était son père avant lui. Le domaine où est élevé le cépage blanc de Touraine est constitué de coteaux pierreux et de terres d’argiles à silex, paysage emblématique de la prestigieuse appellation. Passionné d’histoire contemporaine et sans doute influencé par l’attrait du génie militaire de Napoléon Bonaparte et de la pensée du stratège prussien Carl von Clausewitz, le châtelain a embrassé la carrière des armes en intégrant l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, près de Versailles. Dès le début des hostilités, ses qualités humaines lui valent le respect et l’estime de ses soldats mais aussi les réprimandes et les mises en garde de certains de ses supérieurs hiérarchiques qui condamnent sa complaisance avec ses subordonnés et sa bienveillance envers l’ennemi. Relevé temporairement de ses fonctions pour avoir refusé de faire tirer sur des Allemands qui se rendaient avec un drapeau blanc, il écope du Conseil de guerre. Les règles d’humanité prescrites par la Convention de la Haye prévaudront en octobre 1918 dans le jugement du tribunal militaire qui le lavera de toute trahison. Fait mémorable, le 25 septembre 1918, il reçoit dans son poste de commandement le président du Conseil Georges Clemenceau en visite aux premières lignes des unités françaises à la veille d’une offensive alliée d’envergure au mont de la Ferme de Navarin, un des lieux stratégiques du front champenois. Loin de l’image d’Épinal de la guerre « fraîche et joyeuse », le roman évoque, en demi-teintes, la boue glacée des tranchées et les milliers de « poilus » hachés par les obus et la mitraille. La terrible épreuve forge les solidarités de groupes qui ont résisté aux quatre années d’une lutte sanglante. Mais la réalité barbare de la Grande Guerre ruine peu à peu le noble idéal et les folles espérances de l’officier tourangeau qui s’efforce par tous les moyens de préserver ses hommes et qui n’aspire qu’à l’interruption définitive des combats. Quelques jours avant son audition au Conseil de guerre, une double tragédie le frappe alors qu’il poursuit sa mission sur le front. Sa femme Clémence meurt des suites de la grippe espagnole, contractée en soignant les victimes civiles et militaires évacuées dans leur résidence de la Bourdaisière, réquisitionnée par le service de santé aux armées. Peu après, le ministre de la Guerre l’informe du décès, au cours de combats près de Verdun, de son fils Adrien, fraîchement incorporé dans une unité d’infanterie. Le samedi 9 novembre 1918, alors que les pourparlers d’armistice se prolongent à Rethondes, son chef de division, le général Edmond Boichut, lui transmet l’ordre du chef d’état-major général Ferdinand Foch de maintenir la pression sur l’adversaire et de franchir la Meuse coûte que coûte. Le 11 novembre, quelques heures avant que les cloches de France ne carillonnent de tout leur bronze la paix retrouvée, il est gravement blessé d’une balle dans la tête. Hospitalisé à Suippes puis au Val-de-Grâce, à Paris, il reprend la rédaction des « Chroniques d’une guerre ordinaire » à l’incitation de Diane qui tient la plume de son père rendu aveugle par la blessure. Commencée en septembre à l’hôpital de Suippes, la chronique se prévaut de répondre à l’incohérence et aux contre-vérités colportées sur les années de belligérance par les journaux d’informations générales dont L’Intransigeant, quotidien ordinaire de la famille Martin. Les mémoires qu’il dicte à sa fille veulent aussi soustraire à l’oubli le sacrifice de ces jeunes gens aux visages de vieillards livrés des mois durant à la fournaise. Le lecteur ne restera pas insensible à la démarche vertueuse du narrateur ainsi qu’à la cohésion de ses intimes et familiers : la leçon d’humanisme héritée de son père, le soutien à son procès du capitaine et saint-cyrien René Hénin, le rêve de son fils Adrien de prêter le serment d’Hippocrate, la tendre inclination de l’infirmière Marie de Valmont de Bourgueil pour le capitaine vigneron, le compagnonnage fraternel du métayer Alphonse et la rencontre si pleine de sens, au plus intense de l’apocalypse guerrière, du chirurgien et Hauptmann Helmut Ziegler dans un hôpital souterrain aménagé à 10 kilomètres à vol d’oiseau du mont de la Ferme de Navarin. Les Chroniques du capitaine Henri Martin seront éditées sous le titre -mais vous l’auriez deviné- Le Jour de la Victoire.
- Le Jour de la Victoire, par Daniel Pierrejean, éditions Éditeur indépendant, 378 pages, 2007.
Éléments biographiques :
Scénariste et écrivain, ancien cadre d’Électricité de France, Daniel Pierrejean est l’auteur de plusieurs ouvrages dont : « Philippe Seguin, une certaine idée de la politique » (Presses de la Cité, 1998), « Les Secrets de l’affaire Raoul Wallenberg » (L’Harmattan, 1998), « EDF, tempêtes et solidarité » (Albin Michel, 2000), « Les Justes des Nations » (Éditeur indépendant, 2007) et « J.-F. Kennedy, l’homme au double visage » (Edilivre, 2008).
Portrait
Terrestre ou aquatique, l’escargot est en danger !
 Les quelque quatre cents espèces de gastéropodes - sans considérer les formes marines - sont menacées par les remembrements, la disparition des haies, les pesticides et la canicule. « D’après les spécialistes, observe Julien Perrot, rédacteur en chef de la revue "Salamandre" qui consacre un dossier à l’animal, 30 à 40 % des escargots sont en danger et certains auraient même déjà disparu. » Avec les limaces, les escargots appartiennent à l’embranchement des mollusques. Leurs ancêtres habitaient les mers et on estime qu’ils ont produit, au fil de l’évolution, plus de 100 000 espèces réparties en diverses classes. Celle des gastéropodes, la plus évoluée de toutes, a donné naissance à la sous-classe des pulmonés terrestres, elle-même divisée en plusieurs familles : les hélicidés regroupent les escargots, les aronidés et les limacidés se partagent les limaces. Dès le IVe siècle avant notre ère, Aristote s’était intéressé de façon scientifique à l’escargot dans son Histoire des animaux. Le philosophe grec avait remarqué une tête porteuse de deux sortes de cornes qui pouvaient se rétracter par peur ; une bouche garnie de dents aiguës, petites et fines, presque immédiatement suivie de l’estomac d’où partait un œsophage long et simple qui allait jusqu’à l’hépatopancréas logé au fond de la coquille et prolongé par un intestin aboutissant à l’orifice anal…
Les quelque quatre cents espèces de gastéropodes - sans considérer les formes marines - sont menacées par les remembrements, la disparition des haies, les pesticides et la canicule. « D’après les spécialistes, observe Julien Perrot, rédacteur en chef de la revue "Salamandre" qui consacre un dossier à l’animal, 30 à 40 % des escargots sont en danger et certains auraient même déjà disparu. » Avec les limaces, les escargots appartiennent à l’embranchement des mollusques. Leurs ancêtres habitaient les mers et on estime qu’ils ont produit, au fil de l’évolution, plus de 100 000 espèces réparties en diverses classes. Celle des gastéropodes, la plus évoluée de toutes, a donné naissance à la sous-classe des pulmonés terrestres, elle-même divisée en plusieurs familles : les hélicidés regroupent les escargots, les aronidés et les limacidés se partagent les limaces. Dès le IVe siècle avant notre ère, Aristote s’était intéressé de façon scientifique à l’escargot dans son Histoire des animaux. Le philosophe grec avait remarqué une tête porteuse de deux sortes de cornes qui pouvaient se rétracter par peur ; une bouche garnie de dents aiguës, petites et fines, presque immédiatement suivie de l’estomac d’où partait un œsophage long et simple qui allait jusqu’à l’hépatopancréas logé au fond de la coquille et prolongé par un intestin aboutissant à l’orifice anal…
Au menu des Européens il y a 30 000 ans !
Aujourd’hui, il se ramasse de moins en moins d’escargots en France et en Suisse. En Bourgogne, par exemple, la cueillette ne représente plus que 1 % de la population, le reste est importé de Grèce et des pays de l’Est. Chez les héliciculteurs (producteurs d’escargots), on souligne toujours le succès culinaire de l’Helix pomatia (escargot de Bourgogne) que les Anglais appellent « escargot romain » ou « escargot des vignes ». Introduit en Angleterre à l’époque romaine, et en France probablement à la même époque, il représente environ les trois cinquièmes des consommateurs de gastéropodes terrestres. Mais le petit-gris (Cornu aspersum) - que les Anglais qualifient d’« escargot commun » ou d’« escargot des jardins » - est parfois jugé bien meilleur que le « gros blanc ».
L’an dernier, sur le site de Cova de la Barriada, dans la province d’Alicante (sud-est de l’Espagne), des scientifiques de l’Institut catalan de paléoécologie humaine et d’évolution sociale de Tarragone ont découvert dans des abris calcaires, sur les pentes montagneuses de la Sierra Helada, près de 1 500 coquilles d’Iberisus alonensis. Les chercheurs ont été convaincus que ce gros colimaçon (de 3 centimètres de diamètre pour une hauteur de 2 centimètres) était cuit en grandes quantités avant d’être consommé par les Homo sapiens autochtones au début du paléolithique supérieur (entre 35 000 et 10 000 ans avant notre ère). 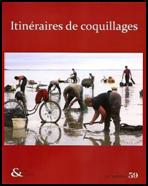 Au cours de leurs investigations, en plus de fragments fossiles de vertébrés (aurochs, cheval sauvage, bouquetin, cerf élaphe, lièvre), d’outils lithiques et de charbons de bois d’essences diverses (romarin, ciste, genévrier, pin noir), ils ont mis au jour des foyers dont une fosse de cuisson remplie de coquilles. Soumises à la cristallographie par diffraction de rayons X, ces coquilles ont montré que le carbonate de calcium passait de l’état d’aragonite à celui de calcite lorsqu’il est chauffé à plus de 375 ° C, preuve que les gastéropodes étaient cuits selon une température déterminée avant d’être consommés. Aujourd’hui encore, dans la péninsule Ibérique, Iberisus alonensis figure au menu des gourmets tout en étant classé sur la liste des espèces menacées d’extinction. Au cours de leurs investigations, en plus de fragments fossiles de vertébrés (aurochs, cheval sauvage, bouquetin, cerf élaphe, lièvre), d’outils lithiques et de charbons de bois d’essences diverses (romarin, ciste, genévrier, pin noir), ils ont mis au jour des foyers dont une fosse de cuisson remplie de coquilles. Soumises à la cristallographie par diffraction de rayons X, ces coquilles ont montré que le carbonate de calcium passait de l’état d’aragonite à celui de calcite lorsqu’il est chauffé à plus de 375 ° C, preuve que les gastéropodes étaient cuits selon une température déterminée avant d’être consommés. Aujourd’hui encore, dans la péninsule Ibérique, Iberisus alonensis figure au menu des gourmets tout en étant classé sur la liste des espèces menacées d’extinction.
L’escargot est droitier…
« Par frottement, l’escargot dissipe deux fois plus d’énergie qu’un animal au pas, nous apprend Julien Perrot. Et sa vitesse de pointe ne dépasse pas 9 mètres à l’heure. N’empêche qu’aujourd’hui, au lieu de railler son rythme tranquille, des chercheurs du monde entier s’intéressent à son mode de locomotion unique. Il y en a qui rêvent de s’en inspirer pour concevoir des petits robots un peu lents mais complètement tout-terrain. » […]
Nous découvrons dans la revue Salamandre que « l’escargot épaissit et agrandit simplement sa coquille en continu. Grâce à sa forme spiralée, celle-ci suit élégamment la croissance de son propriétaire dans des proportions qui obéissent au fameux nombre d’or. […] Les escargots sont presque toujours droitiers avec une spirale qui s’enroule dans le sens des aiguilles d’une montre. Vue de côté, l’ouverture se trouve en bas à droite. On dit que ces coquilles sont dextres. Les individus gauchers à spirale sénestre sont extrêmement rares. Les collectionneurs se les arrachent à prix d’or. Quelques excentriques comme la physe des fontaines font exception. Leur plan de base est sénestre. Dans ce cas, ce sont les droitiers qui sont rarissimes. […] Et où le mollusque trouve-t-il le calcium nécessaire à ce chantier perpétuel ? Dans les plantes dont il se nourrit, voire en raclant la roche avec sa langue abrasive. Puis il stocke ce calcium dans des cellules spécialisées et surtout dans son sang. Il doit en effet avoir des réserves immédiatement disponibles au cas où un accident nécessiterait une réparation d’urgence. Sinon, c’est la mort assurée. » Une mort qui peut aussi être causée par les prédateurs de l’escargot, grives, hérissons, taupes et quatre redoutables coléoptères noctambules, le carabe doré, le petit silphe noir, la drile jaunâtre et le ver luisant.
Il faut savoir, lit-on encore dans la même revue que « l’apparition du soleil provoque chez les escargots une panique lente mais certaine. Ils se cachent n’importe où pour ne pas rester à découvert. Car le sol (la terre) est un four qui absorbe la chaleur et peut atteindre une température de plus de 50° C. Cuisson assurée ! Alors, les mollusques se réfugient aussi vite que possible entre deux racines, sous une feuille ou même dans un petit trou creusé d’urgence dans l’humus. Puis ils se recroquevillent dans leur coquille étanche et sécrètent un voile de mucus en travers de l’entrée. En quelques minutes, celui-ci se transforme en un film transparent qui laisse passer l’air mais pas l’eau. Si l’attente se prolonge au-delà de quelques jours et que la concentration de liquide dans leur corps chute au-dessous de 80 %, les escargots réduisent leur activité au strict minimum. Ils rentrent dans une espèce d’hibernation en plein été : c’est l’estivation, un sommeil profond qui peut durer très longtemps. »
« Les comportements réciproques de l’homme et des escargots sont à l’origine des processus de dispersion des gastéropodes les plus efficaces, localement et au niveau planétaire, observent dans la revue Techniques & Culture Frédéric Magnin (IMBE-Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale, CNRS, université d’Aix-Marseille) et Sophie Martin (INRAP-Institut national de recherches archéologiques préventives, CNRS Montpellier-Lattes). Créature à la fois étrange et familière, à la frontière discutée du domestique, et même de l’animalité, l’escargot entretient avec l’homme des rapports variés. Encore faudrait-il parler "des escargots", tant sont pluriels la taille, la forme, la physiologie, les traits d’histoire de vie, l’écologie et le comportement des gastéropodes terrestres. »
- Salamandre, la revue des curieux de nature, n° 221, avril-mai 2014, dossier « Un alien au jardin », 66 pages, Neuchâtel
- Techniques & Culture, Itinéraires de coquillages, dirigé par Elsa Faugère et Ingrid Sénépart, n° 59, 2nd semestre 2012, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 368 pages, 2013
- Le Courrier de la nature, « Dans l’intimité des gastéropodes : regards sur l’hermaphrodisme », par Yves Thonnérieux, n° 265, 50 pages, novembre-décembre 2011
Varia : menaces sur les broméliacées-citerne, plantes tropicales…
 « Les broméliacées sont une famille de plantes à fleurs (angiospermes) comprenant près de 3 200 espèces. La plupart vivent dans les régions tropicales et subtropicales d’Amérique centrale et du Sud où elles se distribuent depuis les zones côtières jusqu’à plus de 4 000 mètres d’altitude dans la partie centrale de la Cordillère des Andes. La plus connue de ces plantes est l’ananas qui fut "découvert" par Christophe Colomb lors de son second voyage, en 1493. L’ananas a été la première broméliacée cultivée sous serre, dès le XVIIe siècle en Hollande, et demeure un fruit exotique hautement apprécié dans le monde entier. Avec le développement de l’horticulture, de nombreuses broméliacées sont actuellement vendues dans les jardineries comme plantes ornementales, le plus souvent sous leur nom de genres Bromelia, Guzmania, Tillandsia ou encore Vriesea. Robustes, faciles à cultiver du fait de leur multiplication végétative par rejets, et présentant une floraison souvent spectaculaire, les broméliacées sont à la mode, comme l’avait prédit il y a vingt ans le botaniste américain David Benzing, spécialiste mondial de cette famille. « Les broméliacées sont une famille de plantes à fleurs (angiospermes) comprenant près de 3 200 espèces. La plupart vivent dans les régions tropicales et subtropicales d’Amérique centrale et du Sud où elles se distribuent depuis les zones côtières jusqu’à plus de 4 000 mètres d’altitude dans la partie centrale de la Cordillère des Andes. La plus connue de ces plantes est l’ananas qui fut "découvert" par Christophe Colomb lors de son second voyage, en 1493. L’ananas a été la première broméliacée cultivée sous serre, dès le XVIIe siècle en Hollande, et demeure un fruit exotique hautement apprécié dans le monde entier. Avec le développement de l’horticulture, de nombreuses broméliacées sont actuellement vendues dans les jardineries comme plantes ornementales, le plus souvent sous leur nom de genres Bromelia, Guzmania, Tillandsia ou encore Vriesea. Robustes, faciles à cultiver du fait de leur multiplication végétative par rejets, et présentant une floraison souvent spectaculaire, les broméliacées sont à la mode, comme l’avait prédit il y a vingt ans le botaniste américain David Benzing, spécialiste mondial de cette famille.
« En milieu naturel, beaucoup de broméliacées vivent en épiphytes (Note du rédacteur : qui croît sur d’autres plantes sans en tirer sa nourriture), ce qui permet à cette importante famille de monocotylédones d’occuper tous les étages de la forêt tropicale, depuis le sol jusqu’aux plus hauts arbres de la canopée. Les broméliacées constituent ainsi les plantes épiphytes les plus communes des forêts chaudes néotropicales.
« Beaucoup de représentants de la famille des broméliacées sont capables de retenir de l’eau et font ainsi partie des plantes-citerne ou plantes à phytotelme (Note : réservoir d’eau de petit volume formé par des feuilles ou des fleurs de végétaux ou encore par des cavités naturelles au niveau des parties ligneuses d’arbres). […] En Guyane française, certaines Pitcairnia renferment seulement quelques millilitres d’eau, alors que l’une des espèces les plus grosses, Aechmea aquilega, peut en contenir jusqu’à trois litres. […] Certaines broméliacées-citerne sont insectivores, attirant les insectes qui le plus souvent vont glisser sur les feuilles et se noyer dans le réservoir. […] Des recherches entreprises en Guyane française ont permis de montrer qu’une seule espèce de broméliacée sur un seul site peut renfermer environ 30 espèces d’insectes et près de 300 souches de microorganismes cultivables (essentiellement bactéries et champignons microscopiques). […]
« La plus grande menace pour les broméliacées est bien évidemment la destruction de la forêt tropicale. […] 150 espèces de broméliacées auraient déjà disparu et près d’une dizaine serait en cours d’extinction. Sur les 3 200 espèces répertoriées, 152 figurent sur la liste rouge de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) dont sept sont classées en danger critique d’extinction. »
Extraits de « Des plantes tropicales qui forment des mares : les broméliacées-citerne », enquête collective issue de la revue « Le Courrier de la Nature », n° 261, mai-juin 2011
Carnet : duo miaulé
Fantaisie lyrique en deux parties, sur un livret de Colette et une musique de Maurice Ravel, « L’Enfant et les Sortilèges » a été créé à Monte Carlo, le 21 mars 1925, sous la direction de Victor de Sabata. Le petit opéra-comique s’intitulait autrefois Divertissement pour ma fille : j’en ai toujours apprécié le désopilant duo « miaulé ».
À propos de la télévision
Tout est spectacle. Tout est divertissement. Et le sociologue américain Neil Postman le dit : « On voit tout, on n’apprend rien. »
(Martin Gray, « Entre la haine et l’amour », éd. Robert Laffont, 1990)
L’ancêtre du béton
La grande innovation, dont les débuts datent du IIe siècle avant J.-C., c’est la technique du béton. À l’origine simple mélange de sable, de chaux et de débris de pierre, l’opus caementicium emploie souvent par la suite, au lieu de chaux, la pouzzolane (cendre volcanique extraite près de Pouzzoles et qui donne un bon béton hydraulique), ou la brique pilée : c’est le mortier rougeâtre caractéristique de tant de constructions impériales.
(Dimanche 8 février 2015)
Nostalgie
Un copain m’envoie une vieille photographie du lycée François-Auguste Mignet, à Aix-en-Provence. Le soir, six pensionnaires dont je suis conversent sous le préau, vêtus d’une blouse grise, les manches retroussées. Uniforme suranné qui fait rassembler les internes à des commis de quincaillerie.
Le muet bavard
Dans la rue, deux muets dont l’un n’arrête pas de mimer avec une rapidité déroutante, sans laisser au second le temps de placer un geste. C’est un muet bavard.
(Gilbert Cesbron, « Journal sans date », éd. Robert Laffont, 1963/1967/1973)
Vocabulaire naturaliste
Qui sait encore que la mésange charbonnière s’appelle aussi croque-abeilles ?
(Lundi 16 février 2015)
Service de presse
La première chose que Blaise Cendrars dit à Ludovic Massé en le voyant occupé par les envois de services de presse : « Allez-y ! Et souvenez-vous qu’il faut tutoyer les gens de lettres au même titre que les putains ! ».
Balance
À la pharmacie, près d’une balance automatique, un sexagénaire myope tend la monture de ses lunettes à la pharmacienne avant de se peser.
(Mardi 17 février 2015)
|
Billet d’humeur
Concordance des Essais
Professeur à l’université d’Indiana à Bloomington, Roy E. Leake, a publié chez Droz à Genève en 1981 la « Concordance des Essais de Montaigne » avec le concours de David B. Leake et Alice Elder Leake. En deux tomes et selon 1 442 pages, il a établi la liste alphabétique complète des 57 781 mots différents que contiennent les « Essais » de Michel de Montaigne (1533-1592), dont de multiples fantaisies orthographiques dont il a précisé le contexte de chaque emploi. Le lecteur apprend ainsi que le mot « de » est cité 25 653 fois, et qu’au total près de 435 000 mots composent les fameux Essais. Plusieurs programmes informatiques ont été mis en œuvre ; plus de 25 000 000 de caractères ont été insérés sur bande magnétique pour composer les feuilles aptes à être photographiées pour la production des clichés.
|
Lecture critique
L’accent n’est pas le style selon Philippe Boula de Mareüil
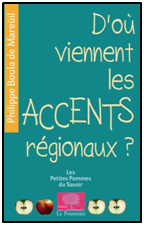 L’Europe des XIXe et XXe siècles connaît de nombreux mouvements de purification linguistique. Ainsi, en Italie, au XIXe siècle, le romancier Alessandro Manzoni, originaire de Milan, décide de séjourner à Florence pour débarrasser son style de toute trace de dialecte lombard ou, comme il le dit lui-même, pour « nettoyer ses vêtements dans l’Arno ». Chez nous, en 1964, René Étiemble dénonce le franglais, tandis qu’en 1966 De Gaulle met en place un Comité de défense de la langue française. On trouvera bien d’autres exemples de pareilles initiatives en Allemagne, en Angleterre ou en Grèce. « Déjà, au XVIe siècle, argumente le linguiste Philippe Boula de Mareüil, directeur de recherches au CNRS, le grammairien anglais Jehan Palsgrave décrétait que la forme de français la plus pure était celle qui était parlée sur les bords de la Loire, en Touraine, où les rois de France aimaient aller chasser. Trois siècles plus tard, Alfred de Vigny écrira, à propos des Tourangeaux : "Leur langage est le plus pur français, sans lenteur, sans vitesse, sans accent ; le berceau de la langue est là, près du berceau de la monarchie." De là provient le mythe selon lequel le français de Touraine serait le plus "correct". » L’Europe des XIXe et XXe siècles connaît de nombreux mouvements de purification linguistique. Ainsi, en Italie, au XIXe siècle, le romancier Alessandro Manzoni, originaire de Milan, décide de séjourner à Florence pour débarrasser son style de toute trace de dialecte lombard ou, comme il le dit lui-même, pour « nettoyer ses vêtements dans l’Arno ». Chez nous, en 1964, René Étiemble dénonce le franglais, tandis qu’en 1966 De Gaulle met en place un Comité de défense de la langue française. On trouvera bien d’autres exemples de pareilles initiatives en Allemagne, en Angleterre ou en Grèce. « Déjà, au XVIe siècle, argumente le linguiste Philippe Boula de Mareüil, directeur de recherches au CNRS, le grammairien anglais Jehan Palsgrave décrétait que la forme de français la plus pure était celle qui était parlée sur les bords de la Loire, en Touraine, où les rois de France aimaient aller chasser. Trois siècles plus tard, Alfred de Vigny écrira, à propos des Tourangeaux : "Leur langage est le plus pur français, sans lenteur, sans vitesse, sans accent ; le berceau de la langue est là, près du berceau de la monarchie." De là provient le mythe selon lequel le français de Touraine serait le plus "correct". »
Si le langage n’est pas le style, il n’est pas non plus l’accent, même s’il procède comme eux, selon les neurologues, du cerveau gauche. Dans son livre « D’où viennent les accents régionaux ? », Philippe Boula de Mareüil répond à la question éponyme en inventoriant les caractéristiques des accents qui distinguent les populations de certaines régions ou villes comme Le Havre, Lyon, Marseille, Paris, Obernai ou Valenciennes. « Si l’école de la République, écrit-il, est presque parvenue à éradiquer les langues régionales et a en partie homogénéisé les accents régionaux, elle se heurte toujours à une difficile réussite des populations socialement défavorisées. Les inégalités demeurent, si bien que le plus important actuellement, dans ce qui détermine les variétés de langue dénigrées, fustigées, serait davantage le milieu social que la région d’origine. À défaut de phénomène nouveau, un terme a émergé et s’est imposé, c’est celui d’"accent de banlieue". » « Dans les représentations les plus répandues, observe-t-il encore, l’accent de banlieue est associé au verlan ("z’y-vas"), à l’argot, aux emprunts (notamment à l’arabe comme "kiffer") et aux insultes rituelles (variations sur les "ta mère" et autres "ta race"). […] On pourrait ainsi parler de trois accents marseillais : celui des "quartiers nord" (correspondant à la façon de parler dans les quartiers difficiles), celui des "vrais" Marseillais (renvoyant à l’imaginaire pagnolesque) et celui de la "bourgeoisie marseillaise" (plus léger). » « La norme acceptée pour l’oral, avance le "chercheur d’accents", serait aujourd’hui incarnée et véhiculée par les "professionnels de la parole", plus particulièrement par la télévision, plus que par l’école. »
Intonation mélodieuse, phrasé tonique, tonalité gouailleuse, chantante ou sensuelle, les mots paraissent manquer pour qualifier l’accent, un accent qui définit, caractérise, révèle et trahit parfois ceux qui en sont dotés, pour le meilleur et pour le pire.
- D’où viennent les accents régionaux ? par Philippe Boula de Mareüil, éditions Le Pommier, collection Les Petites Pommes du savoir, 64 pages, 2010
- Les accents participent à la richesse de notre langue, propos de l’auteur recueillis par Jean-Baptiste de Montvallon, journal Le Monde, samedi 27 décembre 2014.
Portrait
André Gayraud, le biographe des cornouillers
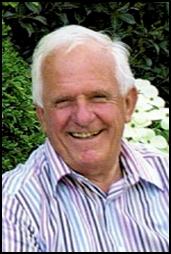 Le coup de foudre l’a frappé en 1956. Cet été-là, dans les jardins botaniques de la villa Taranto, à Pallanza, sur la rive occidentale du lac Majeur, l’apprenti horticulteur tombe en arrêt devant un arbre fleuri de quelque huit mètres de haut qui étage sa ramure en plateaux superposés sur un tronc très droit qui le fait ressembler à une pagode du Guangxi en Chine. Le feuillage est panaché de vert et de blanc et sa floraison d’un blanc pur en corymbe ajoute à la beauté majestueuse du monument végétal. André Gayraud (1938, Le Creusot, Saône-et-Loire) interroge son guide qui révèle : « C’est un Cornus controversa "Variegata", le plus grand de tous les cornouillers de l’hémisphère nord ». Selon le dendrologue allemand Gerd Krussman, cette espèce spectaculaire, originaire du continent asiatique, aurait été introduite en France dès 1896 par le pépiniériste orléanais Albert Barbier. Pépiniériste lui-même à Sennecey-le-Grand, Louis Blanchard a proposé à son ami et client Henri Gayraud d’emmener son fils André en Italie afin d’élargir son horizon floristique cantonné jusque-là aux magnolias, ginkgos et autres liquidambars de l’entreprise paternelle sise à Bourg-en-Bresse. À l’exemple de Philibert Lacour, grand-père du jeune creusotin, le pépiniériste bourguignon s’est rendu compte des aptitudes naturelles et de l’inventivité du jeune jardinier au point de vouloir soutenir les premiers effets de sa vocation. Au lendemain du séjour dans le Piémont, son poulain introduit les premiers Cornus dans les serres du magasin familial où il a initié un département « Parcs et jardins ». Mais c’est seul que le tenant de la quatrième génération des horticulteurs Gayraud poursuivra l’aventure en 1965, à la tête de sa propre société, inaugurée dans la cité bressane, moins d’un mois avant de se marier à Yvette. Communes de l’Ain, Viriat et Hautecourt-Romanèche accueillent successivement les pépinières Rhône-Alpes du couple qui se spécialise d’emblée dans les arbres et végétaux de collection tout en prolongeant avec un égal bonheur la création artistique de parcs et de jardins. Le coup de foudre l’a frappé en 1956. Cet été-là, dans les jardins botaniques de la villa Taranto, à Pallanza, sur la rive occidentale du lac Majeur, l’apprenti horticulteur tombe en arrêt devant un arbre fleuri de quelque huit mètres de haut qui étage sa ramure en plateaux superposés sur un tronc très droit qui le fait ressembler à une pagode du Guangxi en Chine. Le feuillage est panaché de vert et de blanc et sa floraison d’un blanc pur en corymbe ajoute à la beauté majestueuse du monument végétal. André Gayraud (1938, Le Creusot, Saône-et-Loire) interroge son guide qui révèle : « C’est un Cornus controversa "Variegata", le plus grand de tous les cornouillers de l’hémisphère nord ». Selon le dendrologue allemand Gerd Krussman, cette espèce spectaculaire, originaire du continent asiatique, aurait été introduite en France dès 1896 par le pépiniériste orléanais Albert Barbier. Pépiniériste lui-même à Sennecey-le-Grand, Louis Blanchard a proposé à son ami et client Henri Gayraud d’emmener son fils André en Italie afin d’élargir son horizon floristique cantonné jusque-là aux magnolias, ginkgos et autres liquidambars de l’entreprise paternelle sise à Bourg-en-Bresse. À l’exemple de Philibert Lacour, grand-père du jeune creusotin, le pépiniériste bourguignon s’est rendu compte des aptitudes naturelles et de l’inventivité du jeune jardinier au point de vouloir soutenir les premiers effets de sa vocation. Au lendemain du séjour dans le Piémont, son poulain introduit les premiers Cornus dans les serres du magasin familial où il a initié un département « Parcs et jardins ». Mais c’est seul que le tenant de la quatrième génération des horticulteurs Gayraud poursuivra l’aventure en 1965, à la tête de sa propre société, inaugurée dans la cité bressane, moins d’un mois avant de se marier à Yvette. Communes de l’Ain, Viriat et Hautecourt-Romanèche accueillent successivement les pépinières Rhône-Alpes du couple qui se spécialise d’emblée dans les arbres et végétaux de collection tout en prolongeant avec un égal bonheur la création artistique de parcs et de jardins.
Giscard d’Estaing et Catherine Deneuve parmi sa clientèle
Le septuagénaire est débonnaire et passionné. Infatigable et intarissable quand on le presse de raconter comment il est devenu un des jardiniers-paysagistes les plus en vue de l’hexagone. « Je suis issu d’une famille de huit enfants, quatre filles et quatre garçons, explique-t-il. Ma mère a eu la bonne idée de m’inscrire, à l’âge de onze ans, à la section botanique des Naturalistes et archéologues de l’Ain. Avec eux, jusqu’à mes dix-huit ans, j’ai pu herboriser aux quatre coins du département. À quinze ans, je réalisais mon premier jardin floral. Aujourd’hui, j’ai dû en créer un millier en un peu plus de soixante années ! »
Côté jardins, une activité qui commence véritablement en 1974, il signe quelques réalisations prestigieuses dont les parcs de châteaux du Bordelais (les Châteaux Canon, Figeac et Lynch-Bages, entre autres) ainsi que les jardins du président de la République Valéry Giscard d’Estaing, de l’actrice Catherine Deneuve et de l’industriel le baron Bruno Bich. Ce sont « des jardins pas comme les autres », comme le clame un slogan de la société, des jardins d’intérêt botanique, historique et paysager où il est question de palettes horticoles et d’introduction d’espèces méconnues. Côté botanique, il est le premier européen à pratiquer la taille arbustive en nuage comme lui ont appris les maîtres nord-coréens. Avec la complicité des rosiéristes Georges et François Dorieux, de Montagny (Loire), il créé des variétés de roses au bénéfice des mêmes châteaux du Bordelais et de Saint-Émilion et de quelques célébrités. En outre, le praticien ne dédaigne pas de transmettre ses connaissances à travers des sessions de cours de taille ou de botanique dispensés dans diverses écoles et institutions.
Cinq ans pour réaliser la monographie des Cornus
Mais la grande affaire de sa vie demeure l’introduction et l’acclimatation accrues des cornouillers dans les jardins de 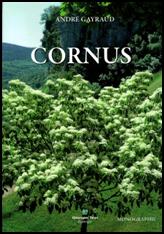 France et d’Europe ainsi que l’étude complète et détaillée de ces végétaux ligneux, arbres, arbustes ou plantes herbacées, nommés Cornus. Le naturaliste suédois Carl von Linné les range dans l’embranchement des phanérogames (plantes à graines), le sous-embranchement des angiospermes (plantes à fleurs) et la classe de dicotylédones. « La famille des cornacées réunit dix genres, souligne André Gayraud dans sa monographie des Cornus, dix genres qui rassemblent un peu moins de mille taxons pour seulement quelques centaines d’espèces botaniques. Il a été dénombré environ 728 espèces du genre Cornus sur le globe terrestre, sans prendre en compte les hybrides et les cultivars qui s’ajoutent par centaines. » Édité et financé par son vieil ami Fabrizio Tesi, du groupe Giorgio Tesi, pépiniériste toscan de Pistoia, le bel ouvrage comporte la description de 620 variétés de Cornus dont il est loisible de découvrir l’incroyable diversité de formes, de caractères et d’espèces sur les cinq continents, une multiplicité végétale servie par une abondance d’informations et un luxe d’illustrations, inédites pour la plupart. Pour mener à bien l’énorme inventaire, cinq ans de patients travaux, recherches et voyages ont été nécessaires à son auteur ainsi que la collaboration de nombreux pépiniéristes, scientifiques et pédagogues dont le professeur Elwin Orton, de l’université Rutgers, université de l’État du New Jersey (États-Unis), la professeure Sveltana Klymenko, de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine à Kiev, Paul Cappiello et Don Shadow, jardiniers américains, et l’horticulteur italien Danilo Bonacchi. France et d’Europe ainsi que l’étude complète et détaillée de ces végétaux ligneux, arbres, arbustes ou plantes herbacées, nommés Cornus. Le naturaliste suédois Carl von Linné les range dans l’embranchement des phanérogames (plantes à graines), le sous-embranchement des angiospermes (plantes à fleurs) et la classe de dicotylédones. « La famille des cornacées réunit dix genres, souligne André Gayraud dans sa monographie des Cornus, dix genres qui rassemblent un peu moins de mille taxons pour seulement quelques centaines d’espèces botaniques. Il a été dénombré environ 728 espèces du genre Cornus sur le globe terrestre, sans prendre en compte les hybrides et les cultivars qui s’ajoutent par centaines. » Édité et financé par son vieil ami Fabrizio Tesi, du groupe Giorgio Tesi, pépiniériste toscan de Pistoia, le bel ouvrage comporte la description de 620 variétés de Cornus dont il est loisible de découvrir l’incroyable diversité de formes, de caractères et d’espèces sur les cinq continents, une multiplicité végétale servie par une abondance d’informations et un luxe d’illustrations, inédites pour la plupart. Pour mener à bien l’énorme inventaire, cinq ans de patients travaux, recherches et voyages ont été nécessaires à son auteur ainsi que la collaboration de nombreux pépiniéristes, scientifiques et pédagogues dont le professeur Elwin Orton, de l’université Rutgers, université de l’État du New Jersey (États-Unis), la professeure Sveltana Klymenko, de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine à Kiev, Paul Cappiello et Don Shadow, jardiniers américains, et l’horticulteur italien Danilo Bonacchi.
Un livre d’histoires
Au-delà de l’intérêt scientifique majeur de l’ouvrage, la monographie des Cornus foisonne d’histoires les unes plus intéressantes que les autres. On apprend ainsi que Linné lui-même a nommé Cornus ce genre végétal  dans sa nomenclature en référence au fourchon à deux dents fabriqué en bois de cornouiller, un outil que les paysans utilisaient en Europe pour manipuler les pailles de céréales et les fenaisons. Outre les cornes à fourrage, le bois de Cornus mas L. (cornouiller mâle) ou Cornus sanguinea L. (cornouiller sanguin) dit aussi olivier de Normandie sert à la fabrication de divers matériaux : barreaux d’échelles, râteliers, tonneaux, jouets, articles de vannerie, manches de parapluie et d’ombrelle, boiseries, tabletterie, dents d’engrenages de moulins et hélices d’avions. Dans l’Antiquité, les Romains en faisaient des flèches, des piques et des javelots. Et si les Américains ont traduit le vocable par dogwood, littéralement "bois à dagues", c’est parce que ce bois dur comme de la corne animale servait autrefois à confectionner des fourreaux pour les épées. dans sa nomenclature en référence au fourchon à deux dents fabriqué en bois de cornouiller, un outil que les paysans utilisaient en Europe pour manipuler les pailles de céréales et les fenaisons. Outre les cornes à fourrage, le bois de Cornus mas L. (cornouiller mâle) ou Cornus sanguinea L. (cornouiller sanguin) dit aussi olivier de Normandie sert à la fabrication de divers matériaux : barreaux d’échelles, râteliers, tonneaux, jouets, articles de vannerie, manches de parapluie et d’ombrelle, boiseries, tabletterie, dents d’engrenages de moulins et hélices d’avions. Dans l’Antiquité, les Romains en faisaient des flèches, des piques et des javelots. Et si les Américains ont traduit le vocable par dogwood, littéralement "bois à dagues", c’est parce que ce bois dur comme de la corne animale servait autrefois à confectionner des fourreaux pour les épées.
Appelé cornelle (semblable à de la cornaline) ou cornouille, de couleur rouge orangé ou noir bleuté, plus rarement rose, jaune ou blanc, le fruit du cornouiller pèse en moyenne 5 à 8 grammes, mais il peut atteindre 10 gr avec un noyau représentant 7 à 12 % du volume du fruit. Drupe ovoïde ou sphérique, le fruit a la forme d’un grain de poivre, d’une olive, d’une framboise ou d’une groseille à maquereau. Les fruits sont parfois comestibles et transformés en : bonbons, confitures, compotes, jus de fruits, sirops, fruits confits et pastilles. À l’occasion de la publication de la monographie des Cornus, le chef et pionnier de la nouvelle cuisine Michel Guérard, d’Eugénie-les-Bains, a imaginé quatre préparations inédites de desserts à base de cornouilles. Avec une bonne variété, un plant de Cornus de 5 à 10 ans d’âge produit 25 kilos de fruits, un plant de 15 à 20 ans 40 à 60 kg de fruits, un plant de 25 à 40 ans 80 à 100 kg de fruits. Des huiles sont extraites des cornelles pour les besoins de l’éclairage et de la fabrication du savon.
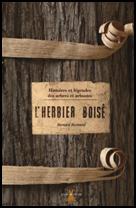 Au nombre des espèces, hybrides et cultivars recensés et commentés dans la monographie, nous découvrons Cornus suecica ou cornouiller de Suède, originaire de l’Europe arctique, qui est la plus nordique de toutes les espèces du genre. Le plant original de Cornus kousa "Beni Fuji" ® provient de graines collectées en 1970 sur les pentes sud-est du mont Fuji, au Japon, à 1000 mètres d’altitude. Cornus mas "Grovemas" a été sélectionné à partir de sujets prélevés dans un… cimetière de Cincinnati (Ohio). Les qualités olfactives ont valu à Cornus florida "Fragrant Cloud" (Nuage parfumé) d’être retenu, car les Cornus florida sont par nature dénués de parfum. Le plant original de Cornus florida "Pink sachet" ® a été débusqué parmi des Cornus florida "Cherokee Chief" d’une pépinière de Raleigh, en Caroline du Nord, dont le terrain avait été traité au phosphore radioactif dix ans plus tôt ! La radioactivité serait à l’origine de la mutation du plant qui a donné naissance à un arbuste au feuillage bronze, coloration jamais vue chez cette espèce, et des bractées d’un rose intense et très parfumées. Dans la région des Grands Lacs, en Amérique du Nord, les tribus indigènes mélangent l’écorce du Cornus stolonifera avec leur tabac qu’ils fument les jours de fête.
Au Costa-Rica, dans la cordillère de Talamanca, les taxinomistes ont dégoté un grand nombre de Au nombre des espèces, hybrides et cultivars recensés et commentés dans la monographie, nous découvrons Cornus suecica ou cornouiller de Suède, originaire de l’Europe arctique, qui est la plus nordique de toutes les espèces du genre. Le plant original de Cornus kousa "Beni Fuji" ® provient de graines collectées en 1970 sur les pentes sud-est du mont Fuji, au Japon, à 1000 mètres d’altitude. Cornus mas "Grovemas" a été sélectionné à partir de sujets prélevés dans un… cimetière de Cincinnati (Ohio). Les qualités olfactives ont valu à Cornus florida "Fragrant Cloud" (Nuage parfumé) d’être retenu, car les Cornus florida sont par nature dénués de parfum. Le plant original de Cornus florida "Pink sachet" ® a été débusqué parmi des Cornus florida "Cherokee Chief" d’une pépinière de Raleigh, en Caroline du Nord, dont le terrain avait été traité au phosphore radioactif dix ans plus tôt ! La radioactivité serait à l’origine de la mutation du plant qui a donné naissance à un arbuste au feuillage bronze, coloration jamais vue chez cette espèce, et des bractées d’un rose intense et très parfumées. Dans la région des Grands Lacs, en Amérique du Nord, les tribus indigènes mélangent l’écorce du Cornus stolonifera avec leur tabac qu’ils fument les jours de fête.
Au Costa-Rica, dans la cordillère de Talamanca, les taxinomistes ont dégoté un grand nombre de  Cornus disciflora forestiers qui affectionnent les sols volcaniques et la haute altitude, entre 1400 et 3200 mètres ! Cornus disciflora était considéré le plus grand de tous les Cornus, avec une hauteur maximale de 30 m (et un tronc de 50 à 60 cm de diamètre), avant que des naturalistes ne découvrent dans les forêts du sud-est de la Chine des Cornus wilsoniana ou cornouillers de Wilson mesurant 40 m ! À l’opposé, il existe des cornouillers nains, tel Cornus pumila, d’origine nord-américaine, dont la taille moyenne est de 60 centimètres et qui arrive difficilement à 1,20 m quand il est très vieux. Les plus âgés des Cornus vivent jusqu’à trois cents ans. L’auteur se plaît à répéter la sentence selon laquelle Cornus kousa est au continent asiatique ce que Cornus florida est au continent américain : ils sont les rois de leur catégorie. Dans un jardin, dit-il, quand le roi Cornus florida s’éteint, c’est le monarque Cornus kousa qui prend le relais et qui s’enflamme. Cornus disciflora forestiers qui affectionnent les sols volcaniques et la haute altitude, entre 1400 et 3200 mètres ! Cornus disciflora était considéré le plus grand de tous les Cornus, avec une hauteur maximale de 30 m (et un tronc de 50 à 60 cm de diamètre), avant que des naturalistes ne découvrent dans les forêts du sud-est de la Chine des Cornus wilsoniana ou cornouillers de Wilson mesurant 40 m ! À l’opposé, il existe des cornouillers nains, tel Cornus pumila, d’origine nord-américaine, dont la taille moyenne est de 60 centimètres et qui arrive difficilement à 1,20 m quand il est très vieux. Les plus âgés des Cornus vivent jusqu’à trois cents ans. L’auteur se plaît à répéter la sentence selon laquelle Cornus kousa est au continent asiatique ce que Cornus florida est au continent américain : ils sont les rois de leur catégorie. Dans un jardin, dit-il, quand le roi Cornus florida s’éteint, c’est le monarque Cornus kousa qui prend le relais et qui s’enflamme.
Il rêve de donner corps au "Jardin extraordinaire" de Charles Trenet
Entré dans sa soixante-dix-septième année en 2015, André Gayraud nourrit toujours la même passion pour l’art des jardins, dans l’acception donnée à la discipline au XVIIIe siècle. Mais sa réussite ne sera vraiment complète que le jour où il aura réalisé un ultime rêve : donner corps au "Jardin extraordinaire" du chanteur Charles Trenet, son idole. De quelle manière parviendra-t-il à faire danser les statues du parc ombragé de cornouillers, régler le bal des primevères au milieu des bruyères, diriger le chœur des grenouilles au gré d’une valse brune ? Faisons-lui confiance, le poète jardinier a plus d’une corde à son luth !
André Gayraud © Photo X droits réservés
- Cornus, monographie des Cornus, par André Gayraud, avec la participation d’Annie-Claude Bolomier, botaniste, Giorgio Tesi, éditeur à Pistoia, 224 pages, 2013.
Bibliographie complémentaire
- Flore forestière française, par Jean-Claude Rameau †, Dominique Mansion, Gérard Dumé et Christian Gauberville, guide écologique illustré en trois tomes, tome 1, Plaines et collines, 1792 pages, tome 2, Montagnes, 2432 pages, tome 3, Région méditerranéenne, 2432 pages, éditions de l’Institut pour le développement forestier, 2008
- Les familles des Plantes à fleurs d’Europe - Botanique systématique et utilitaire, par Philippe Martin, Presses universitaires de Namur, 290 pages, 2e édition revue et corrigée, 2014
- L’Herbier boisé - Histoires et légendes des arbres et arbustes, par Bernard Bertrand, éditions Plume de carotte, 192 pages, 2014.
Varia : la route de la soie entre Rome et la Chine
 « De nombreuses marchandises voyagèrent entre les deux empires sur les différents itinéraires de la route de la soie. Certains produits ne faisaient qu’une partie du chemin. « De nombreuses marchandises voyagèrent entre les deux empires sur les différents itinéraires de la route de la soie. Certains produits ne faisaient qu’une partie du chemin.
« En Occident, depuis l’époque romaine, c’est la soie qui marqua l’imaginaire collectif. La route qu’elle empruntait prit même le nom du célèbre tissu oriental. La soie voyagea vers l’Occident comme l’attestent plusieurs témoignages antiques (Lucain, Flavius Josèphe, Tacite, Sénèque, Pausanias, Quintilien…). Mais il ne faut pas réduire ces échanges à ce produit de luxe.
« Les Romains importaient aussi de la cannelle et des pierres précieuses. Les anciennes fondations d’Alexandre en Asie centrale et l’ouverture de la route maritime vers l’Inde sous les Ptolémées permirent d’intensifier ces échanges. Des contacts directs entre Chinois et Romains eurent même lieu sur l’île de Ceylan. Les archéologues ont en effet mis au jour des monnaies romaines au Viêt-Nam, en Inde et à Ceylan qui attestent l’essor du commerce à cette époque. Quant à la soie, même si Tibère ne l’appréciait guère, elle devint un signe de puissance et de faste. Caligula portait des vêtements en soie d’après Suétone et Dion Caccius. Flavius Josèphe révèle que Vespasien se para de soie lors de la célébration de son triomphe sur les juifs. Enfin, Quintilien mentionne la présence de soie dans la fabrication de certaines toges. En 408, Alaric exigea 4000 vêtements de soie lorsqu’il menaça Rome. En 448, les Byzantins offrirent à Attila de riches vêtements de soie. Le tissu était devenu un signe de pouvoir et de prestige ! » Extrait de « Les produits échangés entre Rome et la Chine », de Sébastien Polet, doctorant en archéologie romaine, université catholique de Louvain, dans la revue « Archéothéma - Histoire et archéologie » (n° 19, 100 pages, mars-avril 2012), dossier sur le thème « Rome et la Chine ».
Carnet : de l’art abstrait
« Art abstrait », contradiction dans les termes ou redondance ?
(Daniel Blanchard, Vide-poches, éditions Sens et Tonka, 2003)
À la baguette !
Les hommes appellent des fées les femmes qui les mènent à la baguette, prétend l’auteur dramatique Adrien Decourcelle (1821-1892).
(Jeudi 26 février 2015)
|
Billet d’humeur
Langages
Avez-vous lu « Le Sandwich » (Julliard, 1974) ou « La Langue maternelle » (Fayard, 1995), de Vassilis Alexakis (né à Athènes en 1943) ? Romancier, dessinateur et critique littéraire, il ne cesse de naviguer entre la Grèce et la France, utilisant alternativement l’une et l’autre langue des deux pays. Parfois, il cherche ses mots dans sa langue maternelle et « souvent, confie-t-il, le premier mot qui me venait à l’esprit était français » (« Paris-Athènes », Seuil, 1989). « Comment aurais-je pu écrire en français si la langue ne m’avait pas accepté tel que je suis ? s’interroge-t-il dans « Les Mots étrangers » (Stock, 2002). Les mots étrangers ont du cœur. Ils sont émus par la plus modeste phrase que vous écrivez dans leur langue, et tant pis si elle est pleine de fautes. » L’écrivain qui ne manque pas de drôlerie se souvient des Vietnamiens qui avaient occupé le studio voisin de son appartement parisien : « Ils parlaient en vietnamien entre eux, mais au chat de gouttière qu’ils avaient adopté, ils s’adressaient en français ».
|
Lecture critique
Hervé Jaouen, à la manière des ethnologues
 Nous connaissons beaucoup mieux la Bretagne depuis que Anatole Le Braz, Henri Queffélec, Pierre-Jakez Hélias et Jean Markale nous la racontent un peu à la manière des ethnologues. Hervé Jaouen (1946, Quimper) a rejoint ces illustres disparus. Romans, nouvelles, correspondance, polars, récits de voyages, livres pour la jeunesse, scénarios de longs-métrages, l’œuvre littéraire bouillonne de profusion et d’éclectisme. Dotés d’une force et d’une ambition exceptionnelles, les récits assemblent la chronique d’une Bretagne intime et véridique à travers une famille rurale de la fin du XIXe siècle à nos jours. Sept à huit décennies d’ancêtres et de traditions, d’amours et de morts, de révoltes et de festivités convergent ainsi vers la fresque des Scouarnec-Gwenan dont « Eux autres, de Goarem-Treuz » est le sixième volet. Minutieusement documentée et recomposée, l’histoire a le goût des galettes de blé noir, l’odeur du bois de châtaignier et le souffle de la galerne qui épèle en breton tous les oiseaux de l’Argoat. Nous connaissons beaucoup mieux la Bretagne depuis que Anatole Le Braz, Henri Queffélec, Pierre-Jakez Hélias et Jean Markale nous la racontent un peu à la manière des ethnologues. Hervé Jaouen (1946, Quimper) a rejoint ces illustres disparus. Romans, nouvelles, correspondance, polars, récits de voyages, livres pour la jeunesse, scénarios de longs-métrages, l’œuvre littéraire bouillonne de profusion et d’éclectisme. Dotés d’une force et d’une ambition exceptionnelles, les récits assemblent la chronique d’une Bretagne intime et véridique à travers une famille rurale de la fin du XIXe siècle à nos jours. Sept à huit décennies d’ancêtres et de traditions, d’amours et de morts, de révoltes et de festivités convergent ainsi vers la fresque des Scouarnec-Gwenan dont « Eux autres, de Goarem-Treuz » est le sixième volet. Minutieusement documentée et recomposée, l’histoire a le goût des galettes de blé noir, l’odeur du bois de châtaignier et le souffle de la galerne qui épèle en breton tous les oiseaux de l’Argoat.
Dans leur ferme de Goarem-Treuz, ancienne métairie du château de Traezhennou, une cité maraîchère au sud de Quimper, Marjañ et Jean-Louis Squirou, un poilu gravement blessé au champ d’honneur, ont accueilli, en 1936, le jeune couple de Tréphine et Nicolas Scouarnec comme leurs propres enfants. Surnommé Gwaz-Ru (l’homme rouge), en raison de son inclination pour le parti communiste, l’ancien maçon s’est ainsi reconverti dans l’agriculture et Tréphine lui a donné sept enfants, nés entre 1928 et 1943, Nicolas, Angèle, Maurice, Monique, Julienne, Irène et Étienne. Le livre déroule les destins croisés des sept enfants, destinées dont ils sont à la fois les comptables et les victimes au gré des aléas de l’existence. Grande histoire de France et petites histoires du Finistère scandent les moments de vie, heureux et tragiques, de la parentèle des Scouarnec. Le cri de l’abbé Pierre en faveur des sans-abri, l’envoi du contingent en Algérie, les barricades des étudiants en mai 1968, la victoire de François Mitterrand à l’élection présidentielle alternent avec les rites du répertoire celtique, les délices du pain cuit à l’ancienne, la pêche à la mouche du castillon, ce saumon de première remontée, l’instruction en catimini du breton à l’école de Menez-Bily, l’ouverture du premier hypermarché Rallye sur la route de Bénodet et l’avènement du congélateur dans les foyers bretons.
Orfèvre du ressort et du rebondissement propres à l’intrigue policière, l’auteur ajoute à l’inventaire des brumes de Cornouaille et de la planète quimpéroise la conviction du conteur. Le lecteur y lira aussi une exploration sociale, non pas une excursion nostalgique, mais à la fois une visite dans l’imaginaire et un reportage dans le réel, à travers espoirs et drames.
- Eux autres, de Goarem-Treuz, par Hervé Jaouen, Presses de la Cité, collection Terres de France, 328 pages, octobre 2014
Les précédents titres de la saga chez le même éditeur :
- Gwaz-Ru, 336 pages, octobre 2013
- Ceux de Menglazeg, 300 pages, septembre 2011
- Les Sœurs Gwenan, 468 pages, octobre 2010
- Ceux de Ker-Askol, 360 pages, octobre 2009
- Les Filles de Roz-Kelenn, 360 pages, octobre 2007.
Portrait
Bernard Pivot, le roi Lire du gai savoir
 En visionnant les émissions Apostrophes réunies en deux coffrets par les éditions Montparnasse, je vois défiler mes propres souvenirs de téléspectateur : la maison d’Alexandre Soljenitsyne, la théière de Vladimir Nabokov - remplie, en fait, d’un whisky de 18 ans d’âge -, la robe de chambre d’Albert Cohen, la bouteille de Sancerre de Charles Bukowski, la bienveillance de Marguerite Yourcenar, l’œil aveugle de Jorge Luis Borges, la mélancolie de Georges Simenon, les bafouillages de Patrick Modiano, la verve de Marcel Jouhandeau, l’éloquence de Claude Hagège et les facéties de Raymond Devos. Le vendredi soir, après le dîner, à l’exécution par Byron Janis du concerto pour piano n° 1 en fa dièse mineur de Sergueï Rachmaninov, la famille se rassemblait face à l’écran du téléviseur afin de communier au rituel de l’émission littéraire animée sur la chaîne publique Antenne 2 par Bernard Pivot pendant 75 minutes. Une fête du cœur et de l’esprit qui n’a jamais connu le phénomène de l’érosion, selon l’appréciation des ethnologues, au point de rester gravée dans la mémoire télévisuelle au même titre que « Lectures pour tous » du trio Desgraupes-Dumayet-Max-Pol Fouchet et « Le Grand Échiquier » de Jacques Chancel. En visionnant les émissions Apostrophes réunies en deux coffrets par les éditions Montparnasse, je vois défiler mes propres souvenirs de téléspectateur : la maison d’Alexandre Soljenitsyne, la théière de Vladimir Nabokov - remplie, en fait, d’un whisky de 18 ans d’âge -, la robe de chambre d’Albert Cohen, la bouteille de Sancerre de Charles Bukowski, la bienveillance de Marguerite Yourcenar, l’œil aveugle de Jorge Luis Borges, la mélancolie de Georges Simenon, les bafouillages de Patrick Modiano, la verve de Marcel Jouhandeau, l’éloquence de Claude Hagège et les facéties de Raymond Devos. Le vendredi soir, après le dîner, à l’exécution par Byron Janis du concerto pour piano n° 1 en fa dièse mineur de Sergueï Rachmaninov, la famille se rassemblait face à l’écran du téléviseur afin de communier au rituel de l’émission littéraire animée sur la chaîne publique Antenne 2 par Bernard Pivot pendant 75 minutes. Une fête du cœur et de l’esprit qui n’a jamais connu le phénomène de l’érosion, selon l’appréciation des ethnologues, au point de rester gravée dans la mémoire télévisuelle au même titre que « Lectures pour tous » du trio Desgraupes-Dumayet-Max-Pol Fouchet et « Le Grand Échiquier » de Jacques Chancel.
Tous les genres au service de la littérature
Né le dimanche 5 mai 1935 à Lyon où ses parents tiennent l’épicerie Aux Bons Produits, 42 avenue du Maréchal-Foch, dans le VIe arrondissement, Bernard Pivot partage son enfance - avec son frère Jean-Charles - entre la capitale des Gaules et le Beaujolais de ses ancêtres. Après une scolarité médiocre en pensionnat, il monte à Paris, s’inscrit au Centre de formation des journalistes de la rue du Louvre (1955) et en sort deuxième de sa promotion. Courriériste et échotier au supplément littéraire du quotidien Le Figaro (1958), il en devient le chef du service littéraire (jusqu’en 1974) avant de pratiquer le journalisme radiophonique (Europe 1, 1970-1973, et RTL, 1983-1984) et la presse magazine (Le Point, 1974-1977). Il intègre l’ORTF (Office de radiodiffusion-télévision française) en 1973 où il produit et anime le magazine littéraire Ouvrez les guillemets (1ère chaîne, 1973-1974). Suivent Apostrophes sur Antenne 2 (1975-1990), Bouillon de culture (1991-2001) et Double je à France 2 (2002-2006). Entre-temps, le journaliste et présentateur fonde le magazine Lire (1975) qu’il dirige vingt ans durant et lance avec les Dicos d’or les championnats de France d’orthographe (1985-2005), prétexte à remettre la dictée de la IIIe République au goût du jour. Ancien membre du jury du Prix Interallié, il est désigné en octobre 2004 par les jurés du Prix Goncourt pour occuper le fauteuil d’André Stil : dix ans plus tard, à 78 ans, le journaliste et homme de télévision succède à Edmonde Charles-Roux à la tête de l’académie du restaurant Drouant qui délivre le plus prestigieux des prix littéraires français. Aujourd’hui, le critique continue d’assurer chaque semaine la chronique littéraire du JDD (Journal du dimanche).
Un homme d’influence
Il aime à rappeler ses débuts à la télévision en avril 1973. Jacqueline Baudrier le pousse à l’antenne, en direct, sans aucune répétition, pour la première 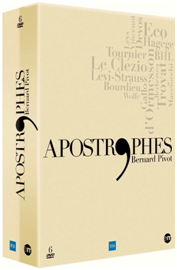 d’« Ouvrez les guillemets » où il évoque au côté de l’écrivain Roger Garaudy la disparition du peintre Pablo Picasso. Le lendemain, la directrice de la régie de la première chaîne lui téléphone en ces termes : « Je vais vous dire trois choses. Cette première émission n’était pas bonne : c’est normal parce que c’est la première. La seconde, ne remettez jamais cette veste car vous avez l’air d’un garçon de café. La troisième, c’est que vous êtes fait pour la télévision ! ». Un autre personnage aura la même intuition au lendemain de la première d’Apostrophes qui prolonge en fait Ouvrez les guillemets en 1975 : « Vous savez, lui déclare l’historien Pierre Nora, vous avez inventé un genre qui va durer ». J. Baudrier et P. Nora ne s’y sont pas trompés en présageant la réussite de cette sorte de causerie littéraire qui montre une autre manière d’appréhender le monde à travers les livres et de confronter ses idées tout en développant son imagination. Dès lors, les éditeurs n’auront de cesse d’espérer pour leurs auteurs de « passer chez Pivot » et d’affoler ainsi les boussoles des ventes. Les querelles ne manqueront pas non plus, telles la dénonciation d’une « dictature » par Régis Debray (1979) ou la désignation d’un « état culturel » par Marc Fumaroli (1992) qui sacrifie à la culture de masse les valeurs de ses élites lettrées. L’homme se défend cependant d’être devenu un homme de pouvoir : « Je n’ai jamais été un homme de pouvoir, justifie-t-il, mais un homme d’influence. L’influence est plus subtile que le pouvoir ». d’« Ouvrez les guillemets » où il évoque au côté de l’écrivain Roger Garaudy la disparition du peintre Pablo Picasso. Le lendemain, la directrice de la régie de la première chaîne lui téléphone en ces termes : « Je vais vous dire trois choses. Cette première émission n’était pas bonne : c’est normal parce que c’est la première. La seconde, ne remettez jamais cette veste car vous avez l’air d’un garçon de café. La troisième, c’est que vous êtes fait pour la télévision ! ». Un autre personnage aura la même intuition au lendemain de la première d’Apostrophes qui prolonge en fait Ouvrez les guillemets en 1975 : « Vous savez, lui déclare l’historien Pierre Nora, vous avez inventé un genre qui va durer ». J. Baudrier et P. Nora ne s’y sont pas trompés en présageant la réussite de cette sorte de causerie littéraire qui montre une autre manière d’appréhender le monde à travers les livres et de confronter ses idées tout en développant son imagination. Dès lors, les éditeurs n’auront de cesse d’espérer pour leurs auteurs de « passer chez Pivot » et d’affoler ainsi les boussoles des ventes. Les querelles ne manqueront pas non plus, telles la dénonciation d’une « dictature » par Régis Debray (1979) ou la désignation d’un « état culturel » par Marc Fumaroli (1992) qui sacrifie à la culture de masse les valeurs de ses élites lettrées. L’homme se défend cependant d’être devenu un homme de pouvoir : « Je n’ai jamais été un homme de pouvoir, justifie-t-il, mais un homme d’influence. L’influence est plus subtile que le pouvoir ».
Avocat du beaujolais
Le lecteur médiatisé qu’il est devenu, selon la formule de Sylvie Ducas (maître de conférences en littérature française à l’université Paris-Ouest Nanterre), était loin de savoir que son émission deviendrait culte. « J’ai beaucoup appris avec "Apostrophes", confie-t-il à Bertrand Guyard, du quotidien Le Figaro (24-25 janvier 2015). 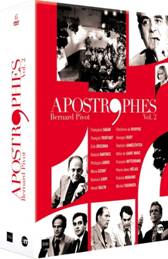 N’ayant pas effectué d’études supérieures, c’était une façon pour moi de continuer mes études. Vous n’imaginez pas le nombre de livres que j’ai lus ! J’ai été pris d’une sorte de boulimie et, fatalement, cette gourmandise se retrouvait à l’écran. » Il s’étonne encore, lui, le non-écrivain, d’avoir été porté à la présidence du jury Goncourt. « C’est un sacré mangeur, s’exclame à son propos l’académicien Didier Decoin : chez Drouant, il sauce toujours son assiette ! » N’ayant pas effectué d’études supérieures, c’était une façon pour moi de continuer mes études. Vous n’imaginez pas le nombre de livres que j’ai lus ! J’ai été pris d’une sorte de boulimie et, fatalement, cette gourmandise se retrouvait à l’écran. » Il s’étonne encore, lui, le non-écrivain, d’avoir été porté à la présidence du jury Goncourt. « C’est un sacré mangeur, s’exclame à son propos l’académicien Didier Decoin : chez Drouant, il sauce toujours son assiette ! »
Le présentateur vedette qui a reçu sur son plateau Roland Barthes, Hervé Bazin, Nina Berberova, Jacques Berque, Pierre Bourdieu, Anthony Burgess, Georges Duby, Marguerite Duras, Romain Gary, Philippe Jaccottet, Vladimir Jankélévitch, Milan Kundera, Jean-Marie-Gustave Le Clézio, Claude Lévi-Strauss, François Mitterrand, Arthur Miller, Jules Roy, Françoise Sagan, Michel Tournier et Henri Vincenot reste un homme simple et modeste qui ne se met en boule que dans les tribunes des matches de football ou lorsque le vin du Beaujolais est attaqué. Aussi aime-t-il se retirer dans sa maison de Quincié-en-Beaujolais où il élève une petite vigne d’un hectare. C’est là, au pied du mont Brouilly, qu’est né le Comité de défense du beaujolais fondé avec deux de ses frères en rabelaiseries, Christian Millau, du guide Gault et Millau, et Périco Légasse, chroniqueur gastronomique à l’hebdomadaire Marianne : le cénacle bachique vise à défendre et à illustrer ce vin du peuple, vin des ouvriers, vin festif, symbole de l’identité française.
Bernard Pivot en 1980 © Photo Gamma-Rapho droits réservés
- Apostrophes, volume 2, éditions Monparnasse, 6 DVD, 12 émissions, 15 heures 3 minutes, 2014
- Apostrophes, volume 1 éditions Montparnasse, 6 DVD, 12 émissions, 14 heures 49 minutes, 2013
- Le Métier de lire, par Bernard Pivot, réponses à Pierre Nora, d’Apostrophes à Bouillon de culture, éditions Gallimard/Folio, 351 pages, 2001.
Varia : du bois aquitain pour la galère des doges de Venise
 « Les forestiers aquitains et la ville de Bordeaux ont donné 600 chênes à la ville de Venise pour reconstruire le vaisseau d’apparat des doges, le Bucintoro. Ce sera une sorte de réparation de l’offense commise par Napoléon en 1797 qui, en mettant fin à la république de Venise, a détruit son monument le plus symbolique. Les troncs deviendront les bases d’une coque de 35 mètres de long, de 7 m de large et de 8 m de haut. Cette construction est prévue sur 4 ans dans l’Arsenal de Venise. « Les forestiers aquitains et la ville de Bordeaux ont donné 600 chênes à la ville de Venise pour reconstruire le vaisseau d’apparat des doges, le Bucintoro. Ce sera une sorte de réparation de l’offense commise par Napoléon en 1797 qui, en mettant fin à la république de Venise, a détruit son monument le plus symbolique. Les troncs deviendront les bases d’une coque de 35 mètres de long, de 7 m de large et de 8 m de haut. Cette construction est prévue sur 4 ans dans l’Arsenal de Venise.
« Trois départements sont concernés par l’approvisionnement en bois : la Dordogne pour ses chênes centenaires ; les Pyrénées-Atlantiques pour leurs futaies de sapins et d’épicéas ; le Massif landais pour ses pins maritimes dont les premières générations remontent à la destruction du Bucintoro.
« C’est la Maison de la forêt d’Aquitaine qui porte le projet avec l’appui des collectivités territoriales et la collaboration de la scierie Patrick Delord. Le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) assure le portage technique et l’Union des syndicats de sylviculteurs d’Aquitaine le portage financier.
« Outre la fourniture du bois de la coque, cette collaboration vise à établir des liens sur le plan de la formation et sur celui des métiers d’art et du patrimoine immatériel. L’enjeu est tourné vers la jeunesse et le lien entre les peuples. »
Article de Geneviève Bérelle paru dans la revue « Forêts de France », n° 572, avril 2014. La revue est publiée sous l’égide de Forestiers privés de France.
Note du rédacteur : le quotidien régional Sud Ouest nous apprend que « Le "Bucintoro", emblématique de Venise au point que, dit-on, tous les gâteaux de mariage sont coiffés de sa reproduction en miniature, était le bateau d’apparat des doges. Mue à l’énergie de 168 rameurs tirant 42 rames, la galère était le clou des fêtes de l’Ascension, quand la Sérénissime célébrait ses noces avec la mer. » « Le projet de construction navale, d’un coût de 12 millions d’euros, vise à donner à l’embarcation tous les attributs de sa magnificence. Patrick Brunie, producteur et réalisateur français de cinéma qui réside à Venise, a commencé sur place le tournage d’un film qui retracera l’aventure jusqu’à son terme, long-métrage produit par Alain Depardieu (le frère de Gérard)… »
Carnet : la petite sardine du Mékong
Au marché de Remoulins (Gard), le commerçant, d’origine vietnamienne, me vend des nems délicieux. Son grand-père était pêcheur dans les bouches du Mékong. Il pêchait le ca linh, vous savez, il s’agit de la petite sardine de laquelle on extrait le meilleur nuoc-mam.
(Lundi 9 mars 2015)
|





